L’instruction « Universae Ecclesiae » : ut unum sint ? (13/05/2011)
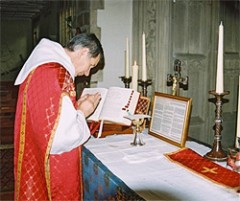 L’instruction « Universae Ecclesiae » sur l’application du motu proprio « Summorum Pontificum », rendue publique ce vendredi 13 mai 2011, a été approuvée par le pape le 8 avril dernier. Le Cardinal Levada et Mgr Pozzo, président et secrétaire de la Commission Ecclesia Dei chargée de sa mise en œuvre, l’ont signée le 30 avril, en la fête de saint Pie V.
L’instruction « Universae Ecclesiae » sur l’application du motu proprio « Summorum Pontificum », rendue publique ce vendredi 13 mai 2011, a été approuvée par le pape le 8 avril dernier. Le Cardinal Levada et Mgr Pozzo, président et secrétaire de la Commission Ecclesia Dei chargée de sa mise en œuvre, l’ont signée le 30 avril, en la fête de saint Pie V.
Saint Pie V a-t-il de quoi se réjouir ? La rigueur et la cohérence ne paraissent malheureusement pas être le fort de ce texte, dont la gestation semble avoir été quelque peu laborieuse.
Rappelons que, suivant l’article 34 du code de droit canonique, une instruction a pour objet d’expliciter la loi (en l’occurrence le motu proprio) sans jamais pouvoir y déroger et de fixer les règles d’application de celle-ci. . / .
« Universae Ecclesiae » comporte trois parties : une introduction, suivie de deux sections : l’une consacrée aux pouvoirs de la Commission pontificale « Ecclesia Dei », l’autre à préciser (dans le meilleur des cas) certaines normes spécifiques du motu proprio qui feraient difficulté.
Le (trop ?) long texte introductif confirme le principe fondamental déjà très clairement énoncé à l’article 1er de « Summorum Pontificum » : le missel de Paul VI et le missel dit de Jean XXIII sont les deux expressions légitimes actuelles du rite romain et l’usus antiquior (version Jean XXIII) doit être conservé pour trois raisons : sa valeur intrinsèque offerte à tous les catholiques, le bien des fidèles qui le demandent, la réconciliation au sein de l’Église. C’est une gageure difficile à relever.
La deuxième section de ce document explicite les pouvoirs de la Commission « Ecclesia Dei » sur deux points dont la portée est inégale :
- la Commission a le droit, en tant que supérieur hiérarchique, d’exprimer une décision au sujet des recours qui lui sont légitimement présentés contre l’acte administratif d’un évêque qui semblerait contraire au motu proprio : ce qui pouvait sembler une lapalissade à la lecture rapide de l’article 7 (par exemple) du motu proprio va semble-t-il beaucoup mieux en le disant. Les décisions de la Commission seront exprimées dans des « decrets » qui pourront eux-mêmes faire l’objet d’un recours devant le tribunal suprême de la signature apostolique. Le principe même de cette judiciarisation de l’activité de la Commission est important, même si le mode d’exercice des recours n’est pas (encore) précisé.
- par ailleurs, la Commission est chargée de l’édition (éventuelle) de (nouveaux) textes liturgiques relatifs à la forme extraordinaire (usus antiquior) du rite romain, après qu’ils eussent été approuvés par la Congrégation du Culte divin.
La troisième section traite d’un ensemble disparate de points qui ont fait l’objet d’incompréhension ou de contestation depuis l’entrée en vigueur du motu proprio (le 15 septembre 2007) :
- s’agissant de la mise en œuvre du motu proprio, les évêques sont confirmés dans les pouvoirs que leur attribue l’article 392 du code de droit canon en matière de discipline des sacrements, mais avec cette précision qui a son poids de sous-entendus : " toujours en accord avec la mens du pontife romain clairement exprimée par le motu proprio et, en cas de litige ou de doute fondé au sujet de la célébration de la forme extraordinaire, la Commission "Ecclesia Dei" jugera " ;
- autre objet de controverses, la composition du groupe stable susceptible de bénéficier d’une célébration habituelle selon l’usage ancien : aucun nombre précis de membres n’est requis et l'instruction précise que ce groupe peut être composé de personnes provenant de différentes paroisses et même de différents diocèses ;
- au sujet de l’accueil dans les églises paroissiales, sanctuaires et lieux de pèlerinage, de groupes occasionnels, de prêtres et de fidèles désireux de célébrer selon la forme extraordinaire, l’instruction « recommande » pieusement au clergé d’être généreux ;
- pour être apte à célébrer la messe selon la forme extraordinaire, un prêtre doit être exempt de censures canoniques et avoir une connaissance « minimale » du latin (celle du rite sera supposée): dans cet esprit, les évêques sont « invités » à organiser des formations à la liturgie traditionnelle, y compris dans les séminaires « si les exigences pastorales le suggèrent »; on ne peut être moins directif ;
- curieusement, l’instruction éprouve le besoin de réitérer la faculté donnée, de plein droit, à tout prêtre de « célébrer la messe traditionnelle sine populo », formule moins heureuse que celle du motu proprio, qui a le mérite de préciser (art.4) qu’à de telles célébrations privées peuvent être aussi admis, en observant les règles du droit, les fidèles qui le demandent spontanément ;
- suivent une série de précisions liturgiques relatives, notamment, aux nouveaux saints et aux nouvelles préfaces qui « pourront et devront » être inclus dans le missel de 1962, à la possibilité d’utiliser la langue vernaculaire pour les lectures, en complément de la langue latine, ou comme alternative à celle-ci dans les messes lues, à la possibilité (déjà clairement concédé dans le motu proprio) donnée aux prêtres d’utiliser l’ancien bréviaire ou à la possibilité pour les groupes stables de célébrer selon l’usus antiquior aussi le triduum pascal (clairement, l’article 2 du motu proprio ne le refuse que pour les messes privées ou « sine populo ») de même que le rite de la confirmation (c’est une redite, moins précise que le texte de l’article 9§2 du motu proprio) ;
- une restriction claire pour terminer : en ce qui concerne les ordinations sacrées, l’usage des livres liturgiques anciens est seulement permis dans les instituts « Ecclesia Dei » et l’ordination de prêtres diocésains pour la forme extraordinaire est ainsi découragée, favorisant cette ghettoïsation que le motu proprio a précisément pour objet avoué de combattre…
JPS
18:54 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Commentaires
Je conteste totalement ceux qui contestent!Me JPS vous ètes professeur de droit certes,mais pas de droit canonique!
Écrit par : Thierry | 15/05/2011
Thierry,
Je ne conteste absolument pas l'instruction "Ecclesiae Universae": elle est approuvée par le pape et signée par les autorités romaines compétentes. J'en reconnais donc parfaitement la légitimité.
Ce n'est cependant pas un décret divin. Il est toujours possible d'utiliser sa raison pour faire l'analyse critique d'un document humain, fut-il canonique.
Mon analyse n'est d'ailleurs pas globalement négative. Selon moi, le principal mérite de cette instruction est d'affirmer clairement que la Commission "Ecclesia Dei" a le droit de prendre des décisions et de statuer sur les plaintes, même contre une décision épiscopale, qui lui sont soumises (certains l'ont contesté). Ceci va permettre de débloquer, du moins je l'espère, un certain nombre de dossiers en souffrance devant cette Commission.
Écrit par : JPS | 16/05/2011