Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est et spécialiste de l’histoire des religions, Guillaume Cuchet défend la thèse selon laquelle la crise du catholicisme a des racines profondes, bien antérieures au concile Vatican II, même si celui-ci fut un déclencheur. Dans son nouveau livre, Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ?, il explore les effets de la déchristianisation sur la société. Pour lui, l’avenir du catholicisme passe par une prise de conscience, « la responsabilité de chacun », et par la culture.
Aleteia : Votre livre précédent, Comment notre monde a cessé d’être chrétien ?, exposait les causes lointaines de la déchristianisation de notre société. Dans Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ?, voulez-vous montrer qu’il n’y a rien d’irréversible à cette évolution ?
Guillaume Cuchet : J’ai cherché à prolonger mes courbes pour rejoindre la situation que nous avons sous les yeux, avec toutes les incertitudes que comporte l’exercice, parce qu’à mesure que l’historien se rapproche du présent, il perd évidemment son principal outil de travail qui est le recul. Il y a une tendance lourde à la déchristianisation qui remonte au XVIIIe siècle, même si elle n’est pas linéaire et qu’elle est passée par des phases, tantôt ascendantes, tantôt descendantes. L’Église était plus en forme en 1860 qu’en 1810, par exemple. Il y a aussi des scénarios plus probables que d’autres. Mais, en dernière analyse, l’avenir du catholicisme est une question posée à notre liberté, individuellement et collectivement. Il aura l’avenir qu’on voudra bien lui donner. Donc je propose d’y réfléchir un peu froidement tant qu’il en est encore temps : on peut vouloir laisser filer les choses mais autant savoir ce qu’on fait.
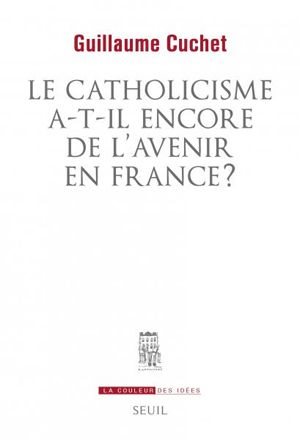
 Imprimer
Imprimer