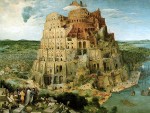 Sur le blog du Cercle Thémis Cercle jusnaturaliste d'étudiants de la faculté de droit de Montpellier, on trouve cette réflexion :
Sur le blog du Cercle Thémis Cercle jusnaturaliste d'étudiants de la faculté de droit de Montpellier, on trouve cette réflexion :
« Tout se vaut », « à chacun son opinion », « chacun pense comme il veut ». Toutes ces expressions font désormais partie du credo post moderne qui s’empare de la pensée occidentale. En effet notre époque se caractérise depuis la fin des grandes idéologies à partir des années quatre-vingt, par une peur viscérale de l’engagement et des convictions. Avec l’effondrement du communisme, des sentiments religieux de masse et la victoire rampante du « je » sur le « nous », force est de constater que les idées fortes n’ont plus tellement le vent en poupe. Il est alors de bon ton d’être « consensuel », agréable à entendre mais aussi et surtout parfaitement creux sur le fond.
Il serait devenu dangereux voire d’une rigidité suspecte d’avoir des projets, des idées claires et de vouloir prendre position. L’heure serait plutôt au dialogue sans fin – sans fond ? – qui mènerait à la seule conclusion que, de toute façon, « chacun est libre de penser ce qu’il veut ». En fin de compte le débat est inutile puisque l’opinion de l’autre ne saurait passer au crible du jugement ou de la critique. Le « moi » est érigé en maître suprême et exige de l’autre l’absence de toute critique vexatoire.
Pourtant le cercle Thémis a fait un choix : celui d’assumer une ligne de réflexion jusnaturaliste. Ce choix audacieux pourrait être discutable lorsque les indécis préfèrent repousser aux calendes grecques le moment de prendre position.
Le droit naturel surgit alors, dans cet environnement qui estime que la loi de la majorité arithmétique est la seule à pouvoir déterminer le juste de l’injuste, comme une curiosité qui fait peur. Le droit naturel dérange parce qu’il renvoie l’homme à lui même ; ce qu’il est et ce qu’il est appelé à faire ici-bas. En définitive il veut resituer l’être humain dans l’espace d’une création qui lui impose des limites physiques voire même surnaturelles.
On peut le dire, il y a quasiment une dimension eschatologique dans le droit naturel. Il y a la recherche de la Vérité qui veut mener l’homme vers le bonheur et modérer les errements de l’homme à travers ses passions. En effet tandis que les siècles et les hommes passent, le droit naturel, lui, a vocation à rester. Il propose d’offrir aux législateurs comme aux citoyens une interrogation permanente sur le juste et l’injuste : jusqu’où puis je aller dans ma liberté ? A partir de quel moment dois-je m’arrêter d’agir ?
C’est ainsi que dans le relativisme ambiant où tout est sujet à débat et remis en question, le droit naturel s’impose comme le fil d’Ariane rassurant et protecteur d’une société qui sait où elle va. Cela rejoint en définitive l’interrogation actuelle sur l’écologie : l’homme peut aller très loin dans la technique, mais doit-il pour autant tout faire s’il risque de se détruire lui-même ?
L’interrogation juridique pourrait être la suivante : le droit peut désormais changer juridiquement un homme en femme ou encore construire des raisonnements juridiques particulièrement poussés. Pourtant le droit n’est pas toujours juste ni même conforme au réel. Le droit disait-il la vérité lorsqu’il traitait par exemple du statut juridique des esclaves qualifiés de choses ? Assurément non.
Dans ces conditions, le droit naturel donne à la société le moyen sûr de se penser elle-même, de savoir vers où elle veut aller pour garder un visage humain sans se couvrir du voile de la barbarie. Une interrogation particulièrement utile lorsque le législateur est appelé à penser l’homme face aux progrès de la science dans les révisions des lois bioéthiques ou encore dans la protection de la dignité. Le droit naturel apparaît alors comme une méthode et un cadre de réflexion qui propose de transcender le seul droit positif pour s’extraire et penser de façon plus globale la vie humaine.
Si le droit naturel invite à prendre un peu de hauteur avec le droit, sommes-nous pour autant prêts à accomplir un tel voyage qui nous emmène jusqu’à l’interrogation du sens de notre propre existence ? Naturellement cela supposera de prendre un risque, de prendre position et d’aller contre le siècle qui pense que « tout se vaut ». Sommes-nous prêts à dépasser ce confortable relativisme au nom d’une certaine idée de la vie ?
J’ignore si l’on enseigne toujours le droit naturel à la Faculté de droit de Montpellier. A l’Université de Liège, le cours existait encore à la fin des années 1960, sous la houlette du professeur René Clemens. Il a aujourd’hui disparu. Avec ses collègues Jean Paulus (psychologie) et Marcel De Corte (philosophie) René Clemens défendait au sein de l’Alma Mater liégeoise une certaine idée de l’homme qu’on aurait sans doute beaucoup de peine à y retrouver aujourd’hui. Il y a là une lacune que l’Union des Etudiants Catholiques de Liège devrait chercher à combler, fût-ce sous la forme de séminaires ou de symposiums libres s’adressant au personnel académique comme aux étudiants. Entre-temps, on peut toujours inviter ses membres à nouer des liens avec le cercle Thémis de Montpellier…
JPS
Commentaires
Bonjour
Merci beaucoup pour la mise en valeur de notre initiative de Montpellier ! Nous serions très heureux d'avoir des échanges avec nos voisins belges.
Vous avez notre mail. N'hésitez pas à nous écrire !
Bien à vous
Le Cercle Thémis