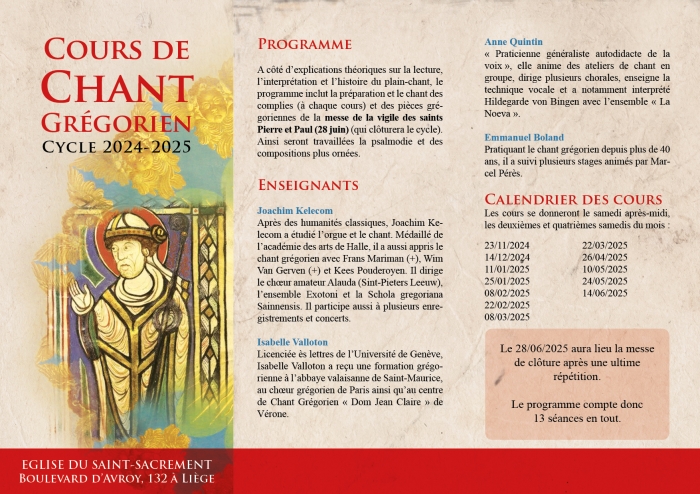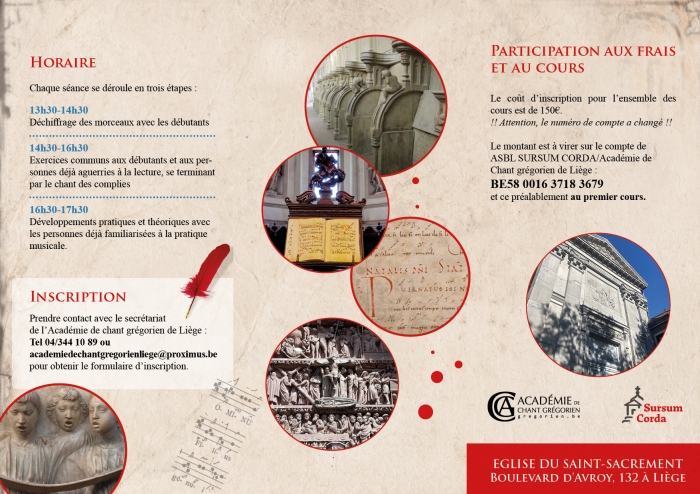De "Signo" sur le Forum Catholique :
La galaxie traditionaliste, pour critiquer la révolution liturgique de 1969, n'a pas énormément renouvelé ses références, qui demeurent, pour l'essentiel, le fameux Bref examen critique des cardinaux Ottaviani et Bacci, le témoignage de Mgr Lefebvre, ainsi que les ouvrages de l'abbé Barthe. Ces angles d'analyses ont, à mon sens, tendance à tourner un peu en rond. Le Bref examen quand à lui me paraît un texte aujourd'hui daté et même contestable sur certaines de ses affirmations.
Il existe pourtant un témoignage plus direct qui à mon avis mériterait d'être plus largement connu et diffusé. Il s'agit de celui de Louis Bouyer, ancien pasteur protestant devenu prêtre catholique, liturgiste et théologien de confiance de Paul VI. Il possède comme caractéristique, outre celle d'avoir été le directeur de thèse d'Hans Kung, celle d'avoir été nommé comme membre de la commission chargée de la conception de la réforme de 1969, sous la supervision de Bugnini qu'il a cotoyé de près et qu'il a donc connu personnellement. Son témoignage est d'autant plus intéressant que, loin d'être lefebvriste, il s'est montré un critique acerbe du traditionalisme catholique, notamment dans son pamphlet La décomposition du catholicisme, paru en 1968.
Or il s'avère que dans ses Mémoires, parues à titre posthume en 2014 aux éditions du Cerf, il dresse dans de nombreux passages ce qui constitue une critique d'une rare virulence des dérives du mouvement liturgique tardif, mais aussi de la réforme liturgique elle-même.
Démentant la réputation qu'on lui a faite d'être un maniaque des nouveautés en liturgie, il écrit, page 147:
Je dois ajouter d'ailleurs que ceux qui ne sont pas dupes de cette réputation, ne m'en tenant pas moins pour un liturgiste, au sens où ils l'entendent, verront aussi bien en moi, particulièrement mais pas seulement chez les disciples de Mgr Lefebvre, un des premiers responsables des misérables chienlits qu'on décore aujourd'hui du nom de «nouvelle liturgie», et contre lesquels j'ai été en fait un des premiers à m'élever, parfaitement en vain, bien entendu!
Témoignant toujours de ce qu'était devenu le mouvement liturgique à la fin des années 1950, il ajoute page 150:
Il était donc déjà bien clair que la majorité des prêtres s'intéressant au nouveau mouvement [liturgique] n'y venaient nullement dans la perspective de rendre à la liturgie traditionnelle toute sa signification obscurcie, toute sa réalité de vie, mais de lui substituer peu à peu une autre liturgie, ou, comme on disait alors, une «paraliturgie», plus conforme aux goûts, aux habitudes d'esprit de ce que les braves gens appelaient l'«homme d'aujourd'hui», mais qui représentait surtout un homo clericalis plus ou moins coupé de ses propres sources, bien avant que ce qu'on appellerait l'«ouverture au monde» eût été opposée à la conversion à l'Evangile.
Mais le témoignage le plus intéressant porte sur les conditions d'élaboration de la réforme liturgique elle-même, à laquelle le théologien a directement participé, sur demande expresse de Paul VI, comme membre du consilium chargé de la réforme des livres liturgiques. C'est un démontage en règle, probablement la critique la plus virulente de la réforme que j'ai eu l'occasion de lire, d'autant plus intéressante qu'elle provient de l'intérieur du cénacle qui l'a conçue. Le portrait qui y est fait de Bugnini et de son rôle est saisissant, et confirme les impressions qu'avait eu Mgr Lefebvre en côtoyant ce bien étrange personnage. Ainsi, parlant des membres de la commission, page 198:
Dans d'autres conditions, ils auraient pu accomplir un excellent travail. Malheureusement, d'une part, une fatale erreur de jugement plaça la direction théorique de ce comité entre les mains d'un homme généreux et courageux, mais peu instruit, le cardinal Lercaro. Il fut complètement incapable de résister aux manoeuvres du scélérat doucereux qui ne tarda pas à se révéler en la personne du lazariste napolitain, aussi dépourvu de culture que de simple honnêteté, qu'était Bugnini.
Plus loin:
Le pire fut un invraisemblable offertoire, de style Action catholique sentimentalo-ouvriériste, oeuvre de l'abbé Cellier, qui manipula par des arguments à sa portée le méprisable Bugnini, de manière à faire passer son produit en dépit d'une opposition presque unanime.
Et le reste du texte est du même acabit. Bouyer ne mâche pas ses mots. Qualifiée de «réforme à la sauvette», d'«invraisemblable composition», de «messe bâclée», par des «fanatiques archéologisant à tort et à travers», la réforme ne trouve guère de vertu à ses yeux. La narration des circonstances de rédaction de la deuxième prière eucharistique, terminée à la sauvette sur la table d'une terrasse du Trastevere juste avant de rendre la copie, est particulièrement consternante. La mention de la réforme du calendrier vaut la peine d'être intégralement citée:
Je préfère ne rien dire ou si peu que rien du nouveau calendrier, oeuvre d'un trio de maniaques, supprimant sans aucun motif sérieux la Septuagésime et l'octave de Pentecôte, et balançant les trois quarts des saints n'importe où, en fonction d'idées à eux! [...] Après tout cela, il ne faut pas trop s'étonner si, par ses invraisemblables faiblesses, l'avorton que nous produisîmes devait susciter la risée ou l'indignation... au point de faire oublier nombre d'éléments excellents qu'il n'en charrie pas moins, et qu'il serait dommage que la révision qui s'imposera tôt ou tard ne sauvât pas au moins, comme des perles égarées...
Puis vient le récit détaillé de la manière dont Bugnini (à propos duquel Bouyer évoque de mystérieux «commanditaires»... sans en dire plus) a manipulé et la commission et le pape en s'appuyant sur l'un contre l'autre, et inversement, pour faire passer des réformes objectivement indéfendables. Un dernier passage mérite d'être cité, car il montre le rôle qu'a joué la papolâtrie dans cette lamentable histoire:
A différentes reprises, soit à propos du sabordage de la liturgie des défunts, soit encore dans cette incroyable entreprise d'expurger les psaumes en vue de leur utilisation dans l'Office, Bugnini se heurta à une opposition non seulement massive, mais on peut dire à peu près unanime. Dans de tels cas, il n'hésita pas à nous dire: «Mais le pape le veut!...». Après cela, bien sûr, il ne fut plus question de discuter.
Je ne peux que conseiller à tous ceux que le sujet intéresse de se procurer et lire cet ouvrage qui vient compléter de manière plus qu'instructive ce que l'on savait déjà sur cette bien étrange réforme...