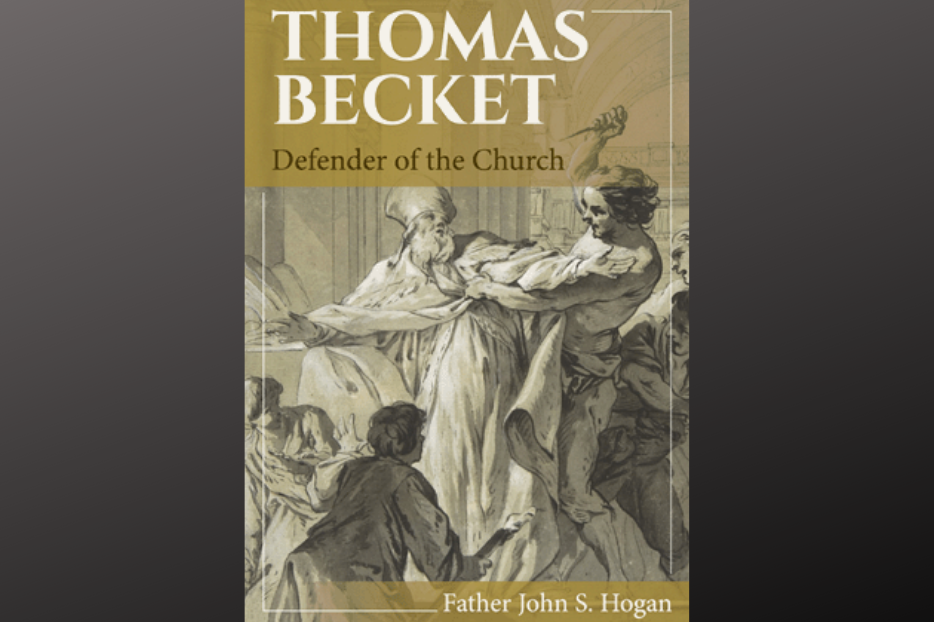27 décembre 2025
Dans une interview exclusive accordée en 2024 à Goya Producciones pour le documentaire « Valientes » (Les Courageux), le président élu du Chili, José Antonio Kast, a abordé des sujets tels que la défense de la vie, son histoire familiale et le problème de l'imposition idéologique de gauche sur la société.
Évoquant son parcours personnel et sa carrière politique, Kast a affirmé que les jeunes « ont le pouvoir d’apporter le changement » et de mettre fin aux sociétés individualistes qui mènent à la solitude.
La décision qui lui a permis de naître
Fervent défenseur de la vie dès la conception, Kast — le benjamin d'une fratrie de dix enfants — a partagé une histoire personnelle « très importante » qui a façonné l'avenir de sa famille : « Lorsque ma mère a eu son deuxième enfant, elle a souffert d'éclampsie [une grave complication de grossesse], et on a évoqué la possibilité qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants », a-t-il raconté.
Son père estimait que ce n'était pas juste et, malgré le danger pour la vie de sa femme, il lui dit : « Je crois que Dieu ne veut pas cela pour nous. » Cette détermination leur permit d'avoir huit autres enfants, dont Kast. Sans cette décision, « je ne serais pas né », a-t-il souligné.
« Mes parents sont des immigrants allemands, et nous avons une famille nombreuse de près de 200 personnes. Les deux premiers enfants de ma mère sont décédés. Par conséquent, rien de tout cela n'aurait été possible, et cela marque profondément dès le plus jeune âge », a-t-il souligné.
« Grâce à cette décision, je suis là aujourd'hui ; grâce à cette décision, j'ai rencontré ma femme. Grâce à cette décision, nous avons pu avoir neuf enfants. Grâce à elle, nous attendons aujourd'hui notre troisième petit-enfant », a-t-il commenté.
« C’est incroyable de voir comment une seule décision peut affecter la vie de tant de personnes », a-t-il réfléchi.
Avec son épouse, María Pía Adriasola, il a neuf enfants, nés de la conviction d’« être ouvert à la vie ». « Dieu nous a accompagnés dans cette décision, et aujourd'hui nous sommes les heureux parents de neuf enfants », a-t-il déclaré, « et nous ne pourrions imaginer la vie sans aucun d'eux. »
trajectoire politique
À ses débuts en politique, se souvient-il, il n'était pas « un grand communicateur », mais grâce à un travail acharné, il est devenu membre du Congrès, chef de parti et candidat à la présidence, « toujours très clair sur les choses, sans jamais tromper les gens, sans jamais falsifier ma position », et dans le but de « gagner le cœur des gens, quel que soit le résultat ».
Son engagement continu en politique était une décision familiale qu'il avait discutée avec sa femme et ses enfants, fondée sur le principe que « celui qui a une mission doit l'accomplir ».
En analysant le paysage sociopolitique chilien de l'époque (avant les élections de 2025), Kast a souligné que « l'idéologie de gauche gagnait une influence croissante au sein des gouvernements, promouvant des lois qui vont à l'encontre de la vie et de la famille telle que constituée par un homme et une femme ».
Il a mis en garde contre l'imposition d'un programme qui, dans le cas du Chili, a légalisé l'avortement pour trois motifs et « vise à modifier la constitution » en dépénalisant l'avortement jusqu'au neuvième mois, en se fondant sur une interprétation erronée du concept d'autonomie de la femme sur son propre corps. « Elle n'est pas propriétaire du corps d'un autre être qui se trouve en elle », a expliqué Kast.
« D’une manière générale, je n’utilise pas d’arguments religieux pour défendre la position pro-vie, car il existe de nombreuses preuves tirées de la nature humaine, de la science et du fait que la vie commence dès la conception », a-t-il déclaré, exprimant l’espoir que « l’avenir dépend de nous » car « la nature humaine est de notre côté ».
Dans ce contexte, Kast a été confronté à la violence, à l'intolérance et à la censure de la part de ceux qui pensent différemment. « Au début de ma carrière politique, j'étais surtout victime de violence verbale de la part de ceux qui pensaient différemment », se souvient-il.
« Certains ont fait des confusions en disant : “Non, vous parlez d’un point de vue religieux.” Et je leur répondais : “Je ne parle pas d’un point de vue religieux ; je parle d’un point de vue scientifique, de la nature humaine, car dès votre conception, à cet instant précis, les caractéristiques que vous présentez aujourd’hui à la société étaient déjà présentes.” » Il se souvient que cela « a suscité une vive polémique au Parlement. »
« Par la suite, ils ont commencé à étendre leur influence à d’autres milieux. Et à certaines occasions, j’ai subi de graves violences physiques », a-t-il raconté, détaillant des situations où il a eu des fractures et a dû être placé sous protection policière. « On a toujours peur, mais je n’ai jamais eu l’intention de céder. »
Kast déplorait que les jeunes qui commettent ces actes d'agression « soient des instruments entre les mains d'un idéologue ». Par conséquent, disait-il, « je ne ressens ni ressentiment, ni haine ; je ressens parfois de la frustration de ne pas pouvoir être avec ces personnes individuellement pour leur expliquer la joie que l'on éprouve à se donner pour sauver autrui, et qu'elles ressentiraient la même chose si elles avaient l'occasion de faire l'expérience de la richesse qui existe dans la nature humaine. »
Reconnaître la lutte entre le bien et le mal
Kast a ensuite dénoncé « une sorte d’empire qui commence à dominer les actions de la société », coordonné avec de vastes ressources financières, de sorte que « la violence est utilisée pour créer un nouveau type d’être humain ».
Bien qu’il ait constaté un « totalitarisme idéologique » visant à anéantir l’individu, Kast a fait remarquer que l’idéologie « ne pourra jamais vaincre la nature de l’être humain, qui aspire à la liberté, à la transcendance, à la préservation de la vie et à l’amour entre les personnes ».
« Nous n’avons pas les ressources, mais nous avons une voix, nous avons du cœur… et cette force est plus puissante que l’argent », a-t-il souligné, souhaitant ardemment que les gens se réveillent et « réalisent que nous devons occuper tous les espaces où nous pouvons agir, qu’avec la puissance de l’Esprit, on peut vaincre l’esprit du mal, car en fin de compte, il s’agit d’une lutte entre le bien et le mal. »
Les preuves sont bien plus convaincantes que l'idéologie.
« Il n’existe aucune valeur louable qui prône la mort d’autrui. Il n’existe aucune valeur louable qui prône la désintégration de la famille, noyau fondamental de la société », a souligné Kast. « Deux femmes peuvent s’aimer. Deux femmes peuvent vivre ensemble. Deux femmes peuvent travailler ensemble. Mais deux femmes seules ne peuvent procréer. Il en va de même pour deux hommes », a-t-il expliqué.
« Ce que je propose et que j’essaie de promouvoir, c’est que les gens prennent en compte les preuves. Et ces preuves sont bien plus convaincantes que l’idéologie », a-t-il indiqué.
La gauche a été « très habile » pour s'approprier des causes.
Kast a reconnu que la gauche avait fait preuve d'une grande habileté en s'appropriant des causes comme l'environnement, les droits des femmes et la santé, et en les utilisant à son avantage. Il a toutefois demandé : « Qui se soucie le plus de l'environnement ? L'idéologie de gauche ou ceux d'entre nous qui croient en la vie ? Nous. »
« Qui défend le mieux les personnes handicapées ? Qui se soucie vraiment d'elles ? Ceux d'entre nous qui croient en la vie. Les autres instrumentalisent leurs souffrances pour dire : "Ils sont victimes de discrimination" », a-t-il déclaré.
« La cause autochtone est instrumentalisée par la gauche idéologique pour prétendre avoir été opprimée et réprimée, ce qui était peut-être vrai il y a 100, 200 ou 300 ans, mais aujourd'hui, nous appartenons tous à la même nation. Nous avons tous la même valeur. Aujourd'hui, il y a plus d'esclaves dans le monde qu'à l'époque où l'esclavage était légal. Qui lutte contre l'esclavage de ces enfants dont les droits sont bafoués ? Qui lutte contre l'esclavage des femmes victimes de la traite des êtres humains ? Nous, car nous croyons en la vie et en la liberté. »
« N’attendez pas que quelqu’un d’autre fasse ce que vous pouvez faire. »
À ceux qui, bien à l'abri chez eux, déclarent « Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose », le dirigeant chilien a répondu : « N'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse ce que vous pouvez faire. Que faites-vous de vos enfants ? Leur consacrez-vous du temps, ou êtes-vous toujours occupés ? Car le fond du problème se trouve au sein de la famille », a-t-il souligné, exhortant chacun à réserver du temps exclusivement à son conjoint et à ses enfants.
Dans ce contexte, il a mis en lumière une tradition chilienne appelée « rendez-vous amoureux du mardi », qu’il pratique lui-même avec sa femme chaque semaine, et qui consiste en « deux heures par semaine de conversation directe, face à face, en se regardant dans les yeux, sans personne d’autre autour ».
Ainsi, « on construit des bases solides pour ce qui est au cœur de la famille : l’union du couple. Si le couple est épanoui, il est plus probable que les enfants et leur environnement le soient également », a-t-il résumé. « Et il est alors plus facile d’inspirer les autres, car on ne peut donner ce que l’on ne possède pas », a-t-il ajouté.
« L’avortement, c’est assassiner une personne innocente. »
« Au Chili, on voit bien que ce que je disais il y a 20 ans est toujours d'actualité », a déclaré Kast. « Je maintiens ce point de vue. Et c'est pourquoi je parviens plus facilement à convaincre les gens aujourd'hui. »
« Dans les années à venir, combien de personnes réaliseront que l'avortement est un meurtre ? Combien, dans 20 ans, diront : « Qu'avons-nous fait à ces enfants en les confiant à l'adoption à des couples de même sexe ? » Ces enfants ont le droit de connaître leur identité. »
« De même que la gauche radicale, par son idéologie, séduit souvent les jeunes, nous, sans chercher à les contrôler, mais en faisant appel à leur liberté, sommes convaincus qu’ils seront le moteur du changement. Car ces sociétés individualistes mènent à la solitude. Or, l’homme est un être social qui aspire au lien social, qui aspire à la joie », a souligné Kast.
« Ce sont les jeunes qui se rebellent les premiers contre le totalitarisme d'État. Ce sont eux qui, les premiers, prennent conscience que les systèmes de protection sociale modernes, ces gouvernements qui s'emparent progressivement du pouvoir absolu, transforment leurs citoyens en esclaves de l'État-providence », a-t-il affirmé. Il a donc exprimé l'espoir « que ce soient les jeunes qui inverseront la situation actuelle ».
Cet article a été initialement publié par ACI Prensa, partenaire hispanophone de CNA. Il a été traduit et adapté par CNA.
 C’est le mardi 6 janvier que tombe la fête de l’Épiphanie. Dans les églises, elle est pourtant célébrée ce dimanche 4 janvier. Trois questions pour mieux pour comprendre.
C’est le mardi 6 janvier que tombe la fête de l’Épiphanie. Dans les églises, elle est pourtant célébrée ce dimanche 4 janvier. Trois questions pour mieux pour comprendre.