De Paolo Gulisano sur la NBQ :
Chesterton fête ses 150 ans, un antidote au mal ambiant
Le 29 mai 1874 naissait à Londres Gilbert Keith Chesterton, le grand écrivain catholique qui a écrit les raisons de la foi dans ses romans. Et qui est plus que jamais d'actualité.
29_05_2024
Il y a cent cinquante ans, le 29 mai 1874, naissait à Londres Gilbert Keith Chesterton, un auteur génial dont on n'a pas assez parlé.
Un siècle et demi après sa naissance, Chesterton est plus que jamais d'actualité, avec sa défense de la raison, avec cet usage magistral du paradoxe qui l'a toujours caractérisé. Un paradoxe qui n'est jamais une fin en soi, pas un jeu intellectuel, mais une méthode pour éveiller l'esprit et la conscience. Chesterton a défendu la beauté de la Foi, de l'annonce du Salut qui est une personne : Jésus-Christ. Et il l'a fait avec passion, avec décision, avec sympathie même. Il était vraiment un homme vivant, comme le dit le titre de l'un de ses célèbres romans. Un chrétien à contre-courant. Et c'est pourquoi, après tant d'années, il est toujours d'actualité : parce que le conflit entre l'Église et le monde prend - ces derniers temps - des dimensions dramatiques. Lorsque Chesterton y est né, le 29 mai 1874, Londres était la ville la plus grande, la plus peuplée et la plus importante du monde : le cœur et l'esprit de la civilisation occidentale et de l'ordre qu'elle avait établi. L'adolescence de Chesterton correspond aux années désespérées et crépusculaires du symbolisme et du décadentisme, des nationalismes qui ont conduit à la tragédie de la Première Guerre mondiale et aux totalitarismes du XXe siècle.
Face à l'expansion du mal, l'œuvre de Chesterton est une sorte de médecine de l'âme, ou plus exactement, elle peut être qualifiée d'antidote. L'écrivain lui-même avait d'ailleurs utilisé la métaphore de l'antidote pour indiquer l'effet de la sainteté sur le monde : le saint est censé être un signe de contradiction et rétablir la raison dans un monde devenu fou. Chaque génération cherche instinctivement son saint", avait-il dit, “et il n'est pas ce que les gens veulent, mais plutôt celui dont les gens ont besoin... D'où le paradoxe de l'histoire qui veut que chaque génération soit convertie par le saint qui la contredit le plus”. La façon dont Chesterton a réussi à contredire la génération de son temps a été d'être heureux. Un bonheur authentique qui, pour être tel, n'exclut nullement la douleur, le labeur et les larmes.
La lecture de Chesterton, en abrégé GKC, qu'il s'agisse de romans ou d'essais, laisse toujours au lecteur une grande sérénité et un sentiment d'espérance qui naissent non pas d'une vision iréniste et mondaine optimiste de la vie (ce qui est en fait le plus éloigné de la pensée de Chesterton, qui dénonce en détail toutes les aberrations de la modernité), mais de la force d'âme chrétienne et virile de l'expérience religieuse. La proposition de Chesterton est de prendre au sérieux la réalité dans sa totalité, en commençant par la réalité intérieure de l'homme, et d'utiliser avec confiance l'intellect - c'est-à-dire le bon sens - dans sa santé originelle, purifiée de toute incrustation idéologique.
Il est rare de lire des pages comme les siennes, dans lesquelles il parle de foi, de conversion, de doctrine, aussi claires et incisives que dépourvues de tout excès sentimental et moralisateur. Cela découle de la lecture attentive de la réalité par Chesterton, qui sait que la conséquence la plus délétère de la déchristianisation n'a pas été la grave perte éthique, mais la perte de la raison, que l'on peut résumer par ce jugement : « Le monde moderne a subi un effondrement mental, bien plus conséquent que l'effondrement moral ». Face à ce scénario, Chesterton choisit le catholicisme et affirme qu'il existe au moins dix mille raisons pour justifier ce choix, toutes valables et fondées, mais toutes ramenées à une seule raison : le catholicisme est vrai, la responsabilité et la tâche de l'Église consistent donc en ceci : le courage de croire, tout d'abord, et ensuite d'indiquer les chemins qui mènent au néant ou à la destruction, à un mur aveugle ou à un préjugé. « L'Église, dit Chesterton, défend l'humanité contre ses pires ennemis, ces monstres anciens, ces hideux dévoreurs que sont les vieilles erreurs.

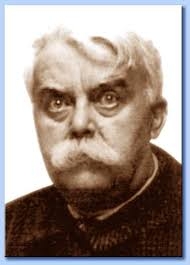 « Figure souvent méconnue de nos jours, Léon Bloy fut pourtant une figure flamboyante de la littérature française du XIXe siècle. Profondément catholique, ne vivant que pour l'absolu et détestant le « Bourgeois » - ce « cochon qui voudrait mourir de vieillesse » - son oeuvre est marquée par un style violent, éclatant, volontiers pamphlétaire. On ne saurait, toutefois, minimiser l'incroyable drôlerie qui se dégage des critiques de ses congénères. « Dans son rapport à l'absolu et à la foi, Bloy s'est rendu insupportable à ses contemporains, avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétence. Mais, Bloy, au fond, c'est un peu le sel. S'il n'y a pas de Léon Bloy, avec quoi salera-t-on ? », s'amuse François Angelier, auteur et producteur de l'émission « Mauvais genre » sur
« Figure souvent méconnue de nos jours, Léon Bloy fut pourtant une figure flamboyante de la littérature française du XIXe siècle. Profondément catholique, ne vivant que pour l'absolu et détestant le « Bourgeois » - ce « cochon qui voudrait mourir de vieillesse » - son oeuvre est marquée par un style violent, éclatant, volontiers pamphlétaire. On ne saurait, toutefois, minimiser l'incroyable drôlerie qui se dégage des critiques de ses congénères. « Dans son rapport à l'absolu et à la foi, Bloy s'est rendu insupportable à ses contemporains, avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétence. Mais, Bloy, au fond, c'est un peu le sel. S'il n'y a pas de Léon Bloy, avec quoi salera-t-on ? », s'amuse François Angelier, auteur et producteur de l'émission « Mauvais genre » sur