De sur le CWR :
Un historien français se penche sur l'histoire tumultueuse du traditionalisme
Une critique de l'ouvrage d'Yves Chiron Entre Rome et la rébellion : une histoire du traditionalisme catholique avec une attention particulière à la France .
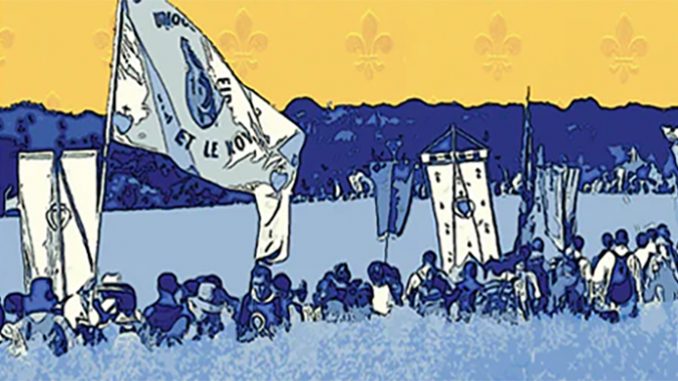
« …l’Église, par son enseignement, sa vie et son culte, perpétue et transmet à toutes les générations tout ce qu’elle est elle-même, tout ce qu’elle croit. » — Dei Verbum, 8
En 1993, du 10 au 15 août, les Journées mondiales de la jeunesse se sont tenues à Denver, dans le Colorado. Cet événement, comme l'a souligné George Weigel, a été l'un des catalyseurs de la naissance de ce que l'on a appelé la génération Jean-Paul II, ou « JPII », dans le catholicisme américain. Avant l'arrivée de Jean-Paul II, l'Église en Amérique était marquée par deux piliers distincts. Le premier était le résidu du catholicisme immigré, le catholicisme des Américains « catholiques irlandais » ou « catholiques polonais » (ou italiens, tchèques, allemands, etc.). Ces catholiques perpétuaient la foi de leurs ancêtres immigrés, assistant à la messe, rejoignant les Chevaliers de Colomb, portant la médaille de Saint-Antoine et enseignaient leurs enfants dans des écoles paroissiales.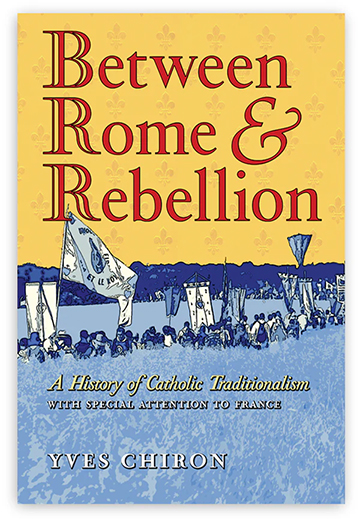
La deuxième force majeure du catholicisme américain à cette époque était ce que l'on a appelé le catholicisme « vieux libéral ». Les vieux libéraux étaient largement en phase avec les courants intellectuels de la Nouvelle Gauche et du mouvement contre-culturel des années 1960. S'il serait injuste de qualifier tous les vieux libéraux d'« hérétiques », il est vrai que certaines de leurs figures majeures professaient des opinions qui semblaient (et parfois, de fait, étaient) hérétiques.
À cette époque, un petit groupe de catholiques, regroupé autour d'ETWN, d'Ignatius Press et d'établissements d'enseignement supérieur « Newman Guide » en plein essor, comme l'Université franciscaine de Steubenville et le Christendom College, pouvait être qualifié de « conservateur ». Cependant, ces conservateurs étaient largement minoritaires. Si catholiques conservateurs et libéraux s'opposaient, les deux groupes reconnaissaient la légitimité du Concile Vatican II et du Novus Ordo Missae de 1970. Cependant, l'interprétation du Concile par les deux groupes, ainsi que la manière dont le Novus Ordo devait être récité et célébré, pouvaient varier considérablement.
Conservateurs, traditionalistes et la situation actuelle
L'arrivée de Jean-Paul II en 1993 a contribué à dynamiser le mouvement conservateur catholique, le transformant en force culturelle dominante du catholicisme américain et inspirant de nombreuses initiatives éducatives ainsi que la naissance de nouveaux ordres religieux. Bien qu'il soit difficile de définir succinctement la génération Jean-Paul II, une description générale peut être donnée. La génération Jean-Paul II était principalement composée de baby-boomers, de la génération X et de la première génération du millénaire qui ont grandi, atteint l'âge adulte ou ont eu une conversation (ou une réversion) sous le pontificat de Jean-Paul II (1978-2005). Intellectuellement, ils étaient façonnés par l'existentialisme et la phénoménologie chrétiens et lisaient largement la tradition intellectuelle thomiste de l'Église à travers ces prismes. Ils suivaient un Novus Ordo Missae empreint de révérence. Contrairement à une « mentalité de forteresse », qui cherchait à se couper du monde, ils s'efforçaient d'évangéliser la culture populaire et étaient largement immergés dans le monde. Ils ont accepté Vatican II et ont été influencés par les mouvements démocrates-chrétiens d’Europe ainsi que par le mouvement néoconservateur aux États-Unis.
Aux États-Unis, avant et immédiatement après l'émergence de la génération Jean-Paul II, le traditionalisme était largement considéré comme un phénomène marginal. Le missel de 1962 était perçu comme une préférence esthétique par les membres de la Fraternité Saint-Pierre ou ceux qui assistaient à la messe d'indult, autorisant sa célébration. Certes, des monarchistes, divers chestertoniens, et des jeunes et vieux schnocks souhaitaient un retour à l'« ancien monde » des coutumes aristocratiques et de la culture populaire, mais il s'agissait là de phénomènes largement marginaux. Les groupes dissidents comme la FSSPX et les sédévacantistes étaient considérés comme des mouvements schismatiques extérieurs au groupe, et ils n'eurent que très peu d'influence sur le discours catholique dominant.
Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Le catholicisme dit traditionaliste est une voix forte, voire dominante, dans le discours catholique conservateur américain. Des opinions autrefois considérées comme interdites, comme le sédévacantisme ; l'illégitimité non seulement du concile Vatican II, mais même du concile Vatican I ; l'illégitimité non seulement du missel de 1970, mais aussi de celui de 1962 ; et le rejet des Lumières, du libéralisme et même de la modernité en général, sont désormais des opinions acceptables, non seulement parmi les catholiques américains, mais aussi parmi les protestants et même les conservateurs laïcs, qui s'inscrivent dans l'orbite du discours traditionaliste.
Le traditionalisme a été alimenté par divers facteurs, dont l'un des plus marquants est l'essor de la culture du complot sur Internet. Ce complot traditionaliste prévaut sur l'idée qu'une collaboration entre communistes, francs-maçons, juifs, agences de renseignement occidentales, banquiers et autres sociétés secrètes a infiltré l'Église et imposé ses idées fondamentalement anticatholiques dans la liturgie et la doctrine de l'Église catholique. Jusqu'aux révélations plus récentes d'abus horribles dans certaines communautés traditionalistes, l'argument avancé était que les scandales d'abus sexuels dans l'Église catholique étaient liés aux changements apparents de la doctrine et de la liturgie, et que les prêtres, bons et saints, qui affirmaient qu'une version de la liturgie catholique d'avant 1970 était à l'abri de telles erreurs.
Un historien sympathique mais critique
L'historien français Yves Chiron (né en 1960) a exploré dans ses ouvrages récents certains des piliers fondamentaux de la pensée traditionaliste, proposant une analyse objective qui bouleverse certains des dogmes centraux du traditionalisme. Parallèlement, ses œuvres témoignent d'une profonde sympathie pour le mouvement traditionaliste. Sa biographie du pape saint Paul VI (« le pape divisé ») dépeint un pape bien intentionné, quoique libéral, qui a tenté d'enrayer le déclin du catholicisme en Europe en modernisant le message de l'Église. Chiron met également fin à l'une des principales conspirations du traditionalisme concernant la vie personnelle de Paul VI en soulignant que cette allégation néfaste est dénuée de fondement et a été inventée par un tabloïd italien. La biographie d'Annibale Bugnini par Chiron souligne également que, malgré les affirmations traditionalistes, l'archevêque n'était même pas le principal artisan du missel des années 1970, et qu'il n'existe aucune preuve qu'il ait été franc-maçon, contrairement à ce que prétendent certains traditionalistes.
Dans son ouvrage le plus récent, Entre Rome et la rébellion : une histoire du traditionalisme catholique avec une attention particulière à la France , Chiron présente un portrait complet et sympathique du mouvement traditionaliste tout en apportant, comme il le fait dans d'autres ouvrages, quelques éclaircissements majeurs.
La première précision est que la lutte entre traditionalistes et modernistes est antérieure au Concile Vatican II. Ce point est bien connu dans les milieux traditionalistes et non traditionalistes. Elle débute en France avec la Contre-Révolution française, qui débute avec la condamnation par Pie VI de la Déclaration des droits de l'homme et de la Constitution civile du clergé de 1791, et se poursuit avec les encycliques Mirari vos (1832) et Singulari nos (1834) de Grégoire XVI, ainsi que Quanta cura et le Syllabus Errorum (1864) de Pie IX .
Le traditionalisme, en France au XIXe siècle, était à l'origine un mouvement qui mettait l'accent sur la tradition face aux explications rationalistes de la religion. L'intégralisme est né en Espagne dans les années 1880, comme mouvement politique antilibéral sous la direction de Ramón Nocedal Romea (1842-1907). À la fin du XIXe siècle en France, le traditionalisme a pris une tournure plus théologique, étant utilisé par les catholiques qui voulaient défendre la théologie catholique contre les modernistes qui voulaient la modifier.
Le pape Pie X a condamné le modernisme comme une synthèse de toutes les hérésies, par opposition à une méthode critique. Benoît XV a réitéré cette condamnation dans Ad Beatissimi . Il a toutefois noté : « Non nova, sed noviter » (Des choses anciennes, mais d’une manière nouvelle). De plus, afin d’éliminer « dissensions et conflits », il a soutenu qu’« aucun individu, que ce soit dans les livres, la presse ou les discours publics, ne s’arroge la position d’un enseignant faisant autorité dans l’Église ». Ceci est remarquable à l’ère actuelle du magistère sur les réseaux sociaux, où des laïcs semblent prétendre pouvoir anathématiser les papes et rejeter la canonisation des saints.
Un autre ouvrage important du cardinal Suhard est Essor ou déclin de l'Église (1947). En préambule à Vatican II, à l'aggiornamento de Jean XXIII et à la tentative de Paul VI de libéraliser la présentation de l'Église, le cardinal Suhard a constaté que le monde contemporain avait changé et laissait l'Église derrière lui. Il a condamné aussi bien les innovateurs que ceux qui refusaient toute forme d'adaptation au monde moderne. Il a condamné le modernisme et l'intégrisme. Il a également souligné que le thomisme est l'enseignement officiel de l'Église, mais que Thomas n'a pas tout dit sur la philosophie.
Curieusement, Suhard a condamné l'intégralisme, le qualifiant d'entreprise laïque et humaine. Il est intéressant de noter qu'il condamne également les intégristes, dits « chrétiens de l'Apocalypse et de la Parousie », qui défendent une vision du monde influencée par les apparitions mariales, la mystique et les révélations privées. Il qualifie cela de traditionalisme excessif, qui tient pour éternel ce qui ne l'est pas. Cet ouvrage est crucial, car certains traditionalistes affirment aujourd'hui s'appuyer sur les apparitions mariales et d'autres formes de révélations privées pour étayer leurs positions.
Le cas de Mgr Lefebvre
Mgr Lefebvre, qui apparaît dans le chapitre « Mgr Lefebvre, une âme douce mais inflexible », est l'un des personnages clés du livre que les lecteurs américains connaissent le mieux. Bien que Chiron lui témoigne de la sympathie, il formule des critiques claires, dont certaines sont choquantes. Lefebvre, par exemple, prétendait avoir reçu une vision dans la cathédrale de Dakar afin de fonder un séminaire international pour transmettre la pureté doctrinale de l'Église et transmettre le sacerdoce catholique. Ce rêve fut ensuite confirmé par la mystique Marthe Robin.
C'est un point essentiel que Chiron aborde avec sympathie et tact : certains traditionalistes s'appuient sur des révélations privées pour se guider. Pourtant, la tradition de l'Église, incarnée par les deux grands maîtres spirituels, sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix, veut qu'on ne se fie pas aux révélations et aux visions. Mgr Lefebvre obtint de l'évêque Adam de Sion, le 19 mai 1970, l'autorisation de suivre une année de spiritualité à Écône ; l'évêque accorda l'autorisation d'un séminaire en décembre 1970. Cependant, ce n'est que le 9 juin 1971 que Lefebvre décida de rejeter publiquement la nouvelle messe. Comme le note Chiron, Lefebvre plaida d'abord pour que les fidèles assistent à la nouvelle messe, affirmant même qu'elle n'était ni « invalide ni hérétique ». Cependant, il refusa plus tard de laisser ses fidèles assister au Novus Ordo.
Mgr Lefebvre ordonna deux prêtres en 1971 et reçut l'autorisation de les ordonner tous les deux. Malgré des conflits avec l'épiscopat français dès 1961, en raison de ses convictions « intégristes », on ne pouvait affirmer que Lefebvre désobéissait alors directement à l'Église. Cependant, les évêques commencèrent bientôt à retirer leurs séminaristes du cœnobium de l'archevêque. Chiron note que, tandis que les séminaires français diminuaient, celui de Lefebvre se développait (son séminaire n'était cependant pas le seul traditionaliste créé à cette époque).
La première critique publique du séminaire de Lefebvre est apparue en 1972, lorsque la presse française a condamné le séminaire, le qualifiant de « séminaire sauvage », terme initialement inventé par le Père Marcus, supérieur du séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Le Père Marcus a tenu des propos étranges mais importants, qui illustrent le paradoxe de la vie catholique dans l'Église post-Vatican II. Il a accusé Mgr Lefebvre de former des séminaristes « méconnaissables » pour l'Église. Si Lefebvre dispensait effectivement une formation traditionnelle de prêtres avec une discipline catholique traditionnelle, cela signifie que la tradition de l'Église avant Vatican II est « méconnaissable » ; c'est un point que Benoît XVI clarifiera plus tard avec son herméneutique de la continuité.
D'une certaine manière, Chiron dépeint Lefebvre comme une figure sympathique, pointée du doigt par la conférence des évêques français, qui refusait de traiter avec lui ou de dialoguer avec lui. En réponse à cette première mise à l'écart, Mgr Lefebvre adressa en 1972 une lettre aux évêques français, soulignant qu'il avait reçu l'approbation de son travail de la part de Mgr Adam de Sion et de Mgr Charrière de Fribourg. Ce point est crucial, car à cette époque, Lefebvre considérait encore son œuvre comme faisant partie intégrante de la structure canonique de l'Église. Chiron note également que les évêques français avaient condamné l'œuvre de Lefebvre avant même qu'il n'attaque publiquement le Novus Ordo Missae ou Vatican II.
Ce point est également crucial, car Chiron, tout au long de Entre Rome et la Rébellion, ainsi que d’autres ouvrages, note que les traditionalistes ont été attaqués et condamnés même lorsqu’ils n’étaient pas en rébellion ouverte.
Le séminaire de Lefebvre à Écône continua de se développer malgré les attaques de l'épiscopat français et de la presse laïque. De plus, malgré la croyance actuelle de certains traditionalistes selon laquelle Mgr Lefebvre était le « chef » du mouvement traditionaliste, il ne se considérait pas comme tel et, du moins au début, ne souhaitait être que le chef de son séminaire. Néanmoins, les attaques de plus en plus virulentes de Lefebvre contre le Novus Ordo Missae, ainsi que Vatican II, suscitèrent encore plus de colère chez les évêques européens. La FSSPX, qui avait fondé une maison près de Rome en 1974, bénéficiait encore de l'approbation de certains évêques et opérait largement dans le cadre canonique de l'Église.
Mgr Lefebvre reçut la désormais célèbre visite apostolique des cardinaux Garonne, Wright et Tabera en novembre 1974. Lefebvre et certains séminaristes affirmèrent plus tard que certains visiteurs avaient tenu des propos hérétiques lors de leurs visites, notamment en exprimant des doutes sur la résurrection du Christ. Chiron, cependant, affirme avec sagesse qu'il ne connaît qu'une seule version des faits.
La rupture majeure eut lieu avec la « Déclaration » de Mgr Lefebvre du 21 novembre 1974, qui opposait la « Rome éternelle » au « magistère pérenne de tous les temps » et à la Rome « néo-moderniste ». Il s'agissait d'une rupture publique majeure, dans laquelle Lefebvre laissait entendre que l'Église de Rome n'était pas la véritable Église, ou du moins qu'elle avait été corrompue et se tenait à l'écart de la véritable Église. Comme le note Chiron, Mgr Lefebvre dira plus tard que la « Déclaration » avait été rédigée avec une « indignation excessive ». De plus, même certains professeurs du séminaire s'inquiétaient de cette Déclaration, qui, selon Chiron, était perçue comme une « déclaration de guerre ». Parallèlement, note Chrion, Lefebvre souhaitait également rester uni au pape.
Lefebvre fut convoqué à Rome en février et mars 1975. Lors de la seconde de ces deux rencontres, le cardinal Garrone l'accusa d'enseigner à ses séminaristes à se fier à leur « jugement personnel » et de tenter de former une « nouvelle Église ». L'évêque Mamie de Fribourg retira l'approbation de la FSSPX, et une commission de cardinaux, avec l'approbation de Paul VI, retira l'approbation canonique de la FSSPX. Chiron cite un article de Louis Salleron paru dans Le Monde , qui soutient que la décision de retirer le statut canonique de la FSSPX n'était pas due à son adhésion à la messe latine, mais à son mépris de la Déclaration.
C'est l'un des points clés de l'œuvre de Chiron : les traditionalistes ont pu être traités injustement à divers moments du développement de leur mouvement, mais il arrive généralement un moment où un acte de défiance facilite une rupture avec l'Église. En juin 1975, Paul VI demanda à Mgr Lefebvre un acte public de soumission.
Défi plutôt qu'obéissance
L'une des autres révélations clés d' Entre Rome et la Rébellion est la croyance, chez certains traditionalistes, qu'un changement notable s'est produit vers la fin de l'année 1976 dans les déclarations publiques de Mgr Lefebvre, ainsi que dans son caractère et même sa santé mentale. Chiron traite cette affaire avec tact, mais aussi avec honnêteté. Dom Roy a fait ce commentaire, et le cardinal Siri aurait également prévu de faire appel à Paul VI en faveur de Mgr Lefebvre, affirmant que celui-ci souffrait d'artériosclérose, ce qui altérait son jugement. L'abbé de Fontgombault a également écrit à Paul VI, affirmant que Lefebvre souffrait de problèmes de santé affectant ses fonctions cognitives. Les amis de Lefebvre l'ont ensuite encouragé à écrire une lettre à Paul VI, affirmant son obéissance.
Ayant reçu l'ordre explicite d'accepter Vatican II et de proclamer le Novus Ordo, Mgr Lefebvre refusa et ordonna 13 prêtres le 29 juin 1976 ; il fut ensuite suspendu a divinis le 22 juillet. Ainsi, la FSSPX continua de fonctionner en dehors de la structure canonique de l'Église, même aujourd'hui. Sous Jean-Paul II et Benoît XVI, cependant, les fidèles du missel de 1962 bénéficièrent de plus grandes libertés, et Chiron laisse entendre que si la FSSPX n'avait pas fait preuve de défiance et avait plutôt fait preuve de patience, la situation se serait améliorée.
Lyndon LaRouche, théoricien du complot de gauche (devenu plus tard théoricien du complot de droite), qui s'est mêlé aux catholiques traditionalistes de Virginie du Nord, a un jour qualifié le catholicisme traditionnel de « secte gnostique n'ayant rien à voir avec le christianisme authentique ». Cette affirmation est injuste pour le laïc catholique moyen. Cependant, l'affirmation de LaRouche a un certain mérite dans la mesure où elle vise certaines expressions culturelles du catholicisme traditionnel. Au cœur du catholicisme traditionaliste devrait résider la volonté de préserver l'enseignement authentique de l'Église catholique.
Cela inclut le désir de suivre l'enseignement politique authentique de l'Église. Trop souvent, cependant, diverses organisations politiques et de renseignement ont exploité ce désir à leurs propres fins. De plus, comme l'a démontré Yves Chiron, au moins certaines (sinon toutes) des théories du complot traditionnelles sont fausses, et des problèmes majeurs et des comportements pathologiques ont été observés chez certains traditionalistes depuis le début. Se prétendre catholique « traditionaliste » peut même être une diversion. Si quelqu'un ne cherche pas à suivre l'enseignement authentique de l'Église, quel genre de catholique est-il ? Ce qu'il faut, ce sont ceux qui ne privilégient pas les idéologies ni ne poursuivent les théories du complot, mais qui cherchent avant tout à être simplement catholiques et disciples de Jésus-Christ.