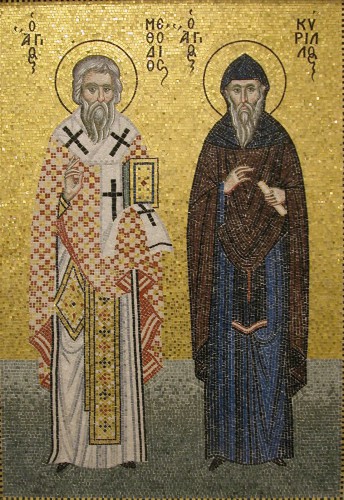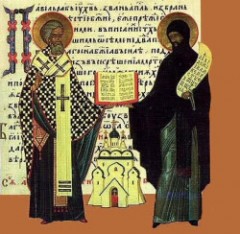De Kristina Millare pour EWTN News (CWR) :
Le pape Léon XIV marquera le début du Carême par une procession historique sur une ancienne colline romaine.
Le pape Léon XIV présidera la procession et la messe traditionnelles du mercredi des Cendres, le 18 février, sur la colline de l'Aventin à Rome, un important lieu de pèlerinage chrétien depuis plus de 1 500 ans.
Le pape Léon XIV présidera la procession et la messe traditionnelles du mercredi des Cendres sur la colline de l'Aventin à Rome, un lieu important de vénération et de pèlerinage chrétien depuis plus de 1 500 ans.
Pour les ordres religieux dominicains et bénédictins, dont les communautés ont une présence historique importante sur l'Aventin, la visite du Saint-Père le 18 février sera une occasion spéciale pour commencer le temps liturgique de l'Église consacré à la prière et au jeûne avant Pâques.
Le premier jour du pèlerinage de 40 jours du Carême — institué officiellement au VIe siècle par le pape Grégoire le Grand et rétabli par le pape Jean XXIII en 1959 —, le pape conduit une procession pénitentielle de l'église bénédictine Sant'Anselmo jusqu'à la basilique dominicaine Santa Sabina, située à proximité.
« Marcher avec le pape Léon XIV lors de ce pèlerinage depuis l’église Sant’Anselmo toute proche sera pour nous tous un signe, un symbole du travail spirituel qui s’accomplit dans nos cœurs pendant le Carême », a déclaré à EWTN News le père Patrick Briscoe, OP, habitant de Santa Sabina. « Nous serons tous ensemble en pèlerinage. »
Cette année, le pape Léon présidera une courte prière l'après-midi au monastère bénédictin, puis célébrera la messe du mercredi des Cendres à Santa Sabina, une basilique du IVe siècle offerte à saint Dominique et à l'Ordre des Prêcheurs en 1219 par le pape Honorius III.

« Le pape lui-même impose les cendres aux cardinaux pendant la messe », a ajouté Briscoe. « Les cardinaux représentent toute l’Église et symbolisent notre union et notre respect de l’exemple du pape. »
Dans le cadre de la tradition du Carême, le pape conduit la procession à travers les portes principales de Santa Sabina, qui abrite la plus ancienne représentation artistique connue de Jésus-Christ crucifié.
« Sur la porte, nous avons un symbole chrétien très important… Il nous permet de réfléchir au sens du Carême et d’embrasser les souffrances du Christ », a déclaré Briscoe.
« Si l’on considère la situation d’un point de vue historique et l’évolution de la compréhension chrétienne, on ne savait pas vraiment comment aborder la question de la croix », a-t-il expliqué. « Il nous a fallu un siècle pour la représenter. »
« Cela nous invite tous, à l’aube du Carême, à redécouvrir le sens de nos souffrances et comment les faire transformer par le sacrifice même du Christ », a-t-il déclaré.
Le père Eusebius Martis, OSB, professeur de théologie sacramentelle à l'Athénée pontifical de Sant'Anselmo, a déclaré à EWTN News que l'Aventin est un lieu idéal pour la prière et le pèlerinage.
« C'est vraiment un endroit idéal car c'est calme et un peu à l'écart, mais pas trop loin [du centre-ville] », a-t-il déclaré.
Selon Martis, la nature de l'Aventin a inspiré, à travers les siècles, artistes et pèlerins, les incitant à contempler la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
« Dans quelques semaines, elle commencera à fleurir, ce qui représente une floraison aux alentours de Pâques », a-t-il déclaré.
Montrant du doigt les reliefs de feuilles d'acanthe ornant les colonnes corinthiennes à l'intérieur de la basilique Sant'Anselmo, Martis a expliqué que plusieurs églises de Rome représentaient délibérément cette feuille pour symboliser la croyance de l'Église en la victoire de Jésus sur le péché et la mort.
« Les architectes voulaient que nous nous souvenions que, chaque fois que nous sommes à l’autel, nous sommes à Pâques », a déclaré le père bénédictin.