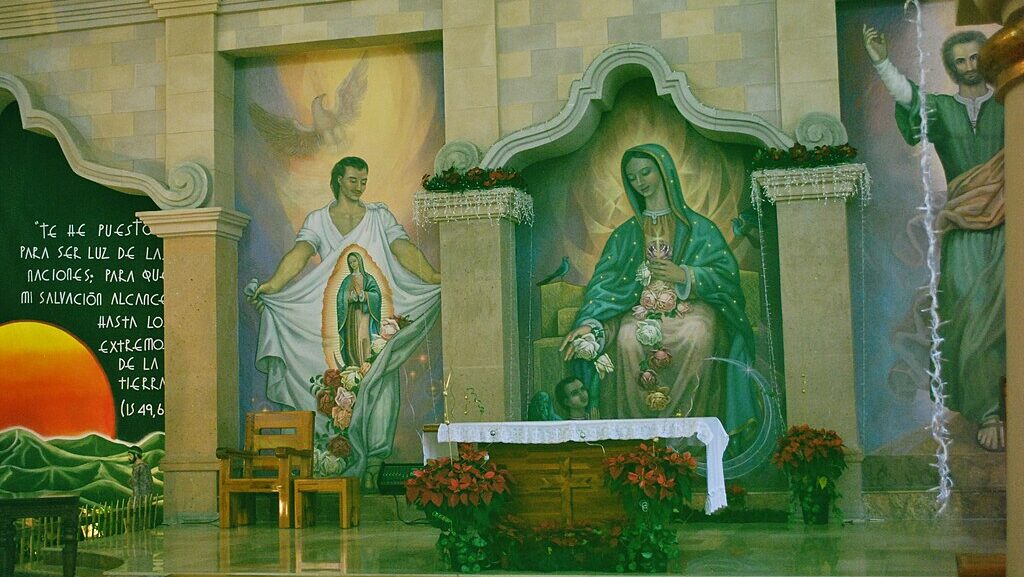Vendredi soir à Rome, à la Domus Australia, une messe de requiem a été célébrée en son honneur.
Pell fut le premier préfet du Secrétariat pour l'Économie, nommé à ce poste par le pape François en 2014, avant de le quitter trois ans plus tard pour faire face à des accusations d'abus dans son pays d'origine, qu'il a niées et dont il a finalement été acquitté.
Après sa mort à l'âge de 81 ans, il a été révélé qu'il était l'homme derrière le pseudonyme « Demos », sous lequel il avait rédigé un mémorandum l'année précédente, condamnant le pontificat du pape François comme une « catastrophe ».
Le communiqué dénonçait des problèmes tels que la nomination de fonctionnaires qu'il considérait comme hérétiques, la statue de la « Pachamama » et l'adoucissement de l'attitude envers les homosexuels.
Pell est décédé avant l'élection du pape Léon XIV, mais il est intéressant d'examiner ce que le cardinal a écrit au sujet du « prochain conclave » – celui qui élirait le successeur de François – qui a justement choisi le cardinal Robert Francis Prevost comme pape Léon XIV.
L’Australien a noté que les cardinaux se réunissaient rarement sous François, et que beaucoup d’entre eux ne se connaissaient pas, ajoutant une nouvelle dimension d’imprévisibilité au conclave suivant (ce qui s’est avéré être une hypothèse correcte après l’élection du prévost américano-péruvien).
De nombreux cardinaux ont lu le document « Demos », surtout après qu'il est devenu connu que Pell, qui était non seulement une figure de proue de l'aile « conservatrice » de l'Église catholique mondiale mais aussi l'un des leurs, en était l'auteur.
On peut se demander : « Demos » a-t-il eu une quelconque influence sur la réflexion des cardinaux – sinon directement sur leur choix – lors du conclave de mai 2025 ?
« Après Vatican II », écrivait Pell (sous le pseudonyme de Demos), « les autorités catholiques ont souvent sous-estimé le pouvoir hostile de la sécularisation, du monde, de la chair et du diable, surtout dans le monde occidental, et surestimé l’influence et la force de l’Église catholique. »
« Nous sommes plus faibles qu’il y a 50 ans et de nombreux facteurs échappent à notre contrôle, du moins à court terme, comme par exemple le déclin du nombre de croyants, la fréquence de la fréquentation des messes, la disparition ou l’extinction de nombreux ordres religieux », a-t-il ajouté.
Le cardinal a déclaré que le pape n'a pas besoin d'être le meilleur évangéliste du monde, ni une force politique.
« Le nouveau pape doit comprendre que le secret de la vitalité chrétienne et catholique réside dans la fidélité aux enseignements du Christ et aux pratiques catholiques. Il ne provient ni de l’adaptation au monde ni de l’argent », a-t-il écrit.
Si l'on examine les premiers mois du pontificat du pape Léon XIV, on constate que cette approche de l'évangélisation est centrale.
« Puisque nous vivons dans une société bruyante et confuse », a déclaré le pape Léon XIV le 12 décembre, « nous avons aujourd’hui plus que jamais besoin de serviteurs et de disciples qui proclament la primauté absolue du Christ et qui gardent sa voix clairement dans leurs oreilles et dans leurs cœurs. »
C'est un point que le document Demos soulignait.
« Les premières tâches du nouveau pape seront de rétablir la normalité, de clarifier la doctrine en matière de foi et de morale, de restaurer le respect dû à la loi et de veiller à ce que le premier critère de nomination des évêques soit l’adhésion à la tradition apostolique. L’expertise et le savoir théologiques sont un atout, et non un obstacle, pour tous les évêques, et en particulier pour les archevêques », a déclaré Pell dans le document Demos.
Il s'est également plaint des rassemblements synodaux apparemment interminables à travers le monde, affirmant qu'ils « consommeront beaucoup de temps et d'argent, détournant probablement l'énergie de l'évangélisation et du service plutôt que d'approfondir ces activités essentielles ».
Dans sa lettre, Pell se plaignait également de la voie synodale allemande, qui, selon lui, promouvait l'homosexualité, les femmes prêtres et la communion pour les divorcés.
« Sans correction romaine de cette hérésie, l’Église se réduirait à une fédération lâche d’Églises locales, aux opinions différentes, probablement plus proches d’un modèle anglican ou protestant que d’un modèle orthodoxe », écrivait le cardinal australien.
« L’une des premières priorités du prochain pape devra être d’enrayer et de prévenir une telle évolution menaçante, en exigeant l’unité sur les points essentiels et en ne tolérant aucune divergence doctrinale inacceptable. La question morale de l’homosexualité sera l’un de ces points de friction majeurs », a déclaré Pell.
Le document Demos notait également que les jeunes membres du clergé et les séminaristes sont presque entièrement orthodoxes, et même parfois assez conservateurs – et la plupart des données le confirment certainement – mais indiquait que le prochain pape « devra être conscient des changements substantiels intervenus dans la direction de l'Église depuis 2013, peut-être particulièrement en Amérique du Sud et en Amérique centrale », ajoutant qu'il y a « un nouveau souffle dans l'élan des libéraux protestants au sein de l'Église catholique ».
Pell a reconnu qu'un schisme est peu probable au sein de la gauche, « qui aborde souvent les questions doctrinales avec légèreté ».
« Le schisme a plus de chances de venir de la droite et est toujours possible lorsque les tensions liturgiques sont exacerbées et non apaisées », a écrit le cardinal.
Durant ces premiers mois de son pontificat, le pape Léon XIV a assurément mis l'accent sur l'unité de l'Église catholique.
Il a également fait part de son intention de travailler à la résolution des conflits qui couvent – et qui, parfois, dégénèrent – depuis l’ère conciliaire et post-conciliaire des années 1960.
Mercredi, lors de l'ouverture de son consistoire extraordinaire du collège des cardinaux, le pontife a placé le pape Paul VI avec le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI avec le pape François – associant ainsi des papes alors même qu'ils étaient perçus comme des opposés polaires dans les médias.
Léon a également établi un lien entre tous les papes post-Vatican II, tous profondément attachés au dernier concile œcuménique.
Il convient également de mentionner que le document Demos abordait les questions plus « terrestres » auxquelles le Saint-Siège était confronté.
Évoquant son précédent poste au Vatican, Pell a déclaré qu'il restait beaucoup à faire en matière de réformes financières au Vatican, « mais cela ne devrait pas être le critère le plus important dans le choix du prochain pape ».
« Le Vatican n’a pas de dettes importantes », écrivait Pell dans Demos, « mais des déficits annuels continus finiront par conduire à la faillite. »
« De toute évidence, » a-t-il écrit, « des mesures seront prises pour remédier à cela, pour dissocier le Vatican de ses complices criminels et pour équilibrer les recettes et les dépenses. »
« Le Vatican devra faire preuve de compétence et d’intégrité pour attirer des dons substantiels afin de contribuer à la résolution de ce problème », a également écrit Pell dans le document Demos.
L'un des premiers actes majeurs du pape Léon XIV a été d'abolir la Commission pour les dons au Saint-Siège, créée par le pape François en février 2025. Léon a également envoyé son chef, Monseigneur Roberto Campisi, en France, en tant qu'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO.
Campisi avait fait ses armes dans le corps diplomatique, et la commission des dons fut créée à la hâte durant ce qui s'avéra être les derniers jours du pontificat de François. La suppression de cette commission ne fut pas un événement majeur, et la nomination de Campisi se justifiait par une certaine logique.
Néanmoins, c'était un signe de la volonté de Léon de rompre avec son prédécesseur et de son souci pour ce qui s'est avéré être un problème épineux sous plusieurs pontificats.
Une autre mesure fut l'abrogation par Léon d'une loi de l'ère François qui plaçait la gestion des biens du Saint-Siège sous la « responsabilité exclusive » de l'Institut pour les Œuvres de Religion, l'IOR ou « Banque du Vatican », comme on l'appelle communément.
Les observateurs ont interprété ces mesures comme une indication que Léon prenait la réforme financière au sérieux, même s'il a minimisé les prédictions alarmistes concernant la stabilité financière du Vatican.
Bien que le cardinal Pell ait troqué le temps contre l'éternité il y a trois ans, il y a lieu de penser que l'Église – le Vatican, du moins – ressent encore son influence.