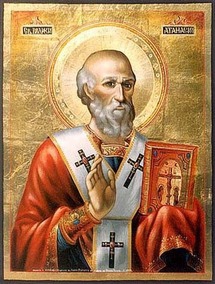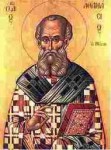De John L. Allen Jr. sur Crux :
« Papabile » du jour : le cardinal Anders Arborelius

Cardinal Anders Arborelius. (Crédit : Médias du Vatican.)
D'ici le conclave du 7 mai destiné à élire le successeur du pape François, John Allen dresse chaque jour le portrait d'un papabile différent, terme italien désignant un homme susceptible de devenir pape. Il n'existe aucun moyen scientifique d'identifier ces prétendants ; il s'agit principalement d'évaluer leur réputation, leurs fonctions et leur influence au fil des ans. Il n'y a également aucune garantie que l'un de ces candidats en sortira vêtu de blanc ; comme le dit un vieux dicton romain : « Qui entre dans un conclave en tant que pape en sort cardinal. » Ce sont pourtant les noms les plus en vue à Rome en ce moment, ce qui garantit au moins qu'ils seront remarqués. Connaître ces hommes permet également de se faire une idée des enjeux et des qualités que d'autres cardinaux jugent souhaitables à l'approche de l'élection.
ROME – La Suède est largement considérée comme l'une des sociétés les plus sécularisées de la planète. Un sondage Gallup de 2016 révèle que près de 20 % des Suédois s'identifient comme athées et 55 % se disent non religieux, tandis qu'une enquête officielle du gouvernement de 2015 révèle que seulement un Suédois sur dix pense que la religion est importante dans la vie quotidienne.
Dans une certaine mesure, l’Église en Suède aujourd’hui est l’Église mondiale tout entière en miniature, un mélange cosmopolite de convertis suédois, de Polonais et de Français, gonflé par des immigrants récents venus d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, y compris une importante cohorte de catholiques chaldéens d’Irak.
Né à Sorengo, en Suède, en 1949, Arborelius grandit dans une famille luthérienne, peu pratiquante. Pourtant, le jeune Arborelius, de toute évidence, possédait un sens religieux aigu, se sentant attiré par une vie de prière et de contemplation. À 20 ans, il se convertit au catholicisme à Malmö.
À ce stade, il était tout naturel pour Arborelius de se sentir attiré par le sacerdoce. Après avoir lu l'autobiographie de sainte Thérèse de Lisieux, il décida de rejoindre l'ordre des Carmes Déchaux. Il étudia ensuite à l'Institut pontifical thérésien de Rome, où il apprit l'italien, tout en obtenant une licence en langues modernes (anglais, espagnol et français) à l'Université suédoise de Lund.
Au fil des années, Arborelius acquit une réputation de pasteur et de penseur efficace, ce qui attira l'attention du Vatican. En 1998, le pape Jean-Paul II le nomma évêque de Stockholm, faisant de lui le premier évêque catholique suédois du pays, et seulement le deuxième évêque scandinave d'origine, depuis l'époque de la Réforme protestante.
Dès le début, Arborelius a décidé que, malgré sa petite taille et la position historiquement dominante de l'Église luthérienne en Suède, le catholicisme sous sa direction ne resterait pas à l'écart des événements culturels. Il s'est engagé activement dans la promotion des mouvements pro-vie et a défendu ouvertement la population croissante de migrants et de réfugiés dans le pays. Il a activement contribué à la promotion des organisations et mouvements de jeunesse au sein de l'Église, tout en écrivant plusieurs ouvrages sur des thèmes religieux.
Pendant une décennie, de 2005 à 2015, Arborelius a présidé la Conférence épiscopale de Scandinavie. En octobre 2016, il a accueilli le pape François en Suède, dont le point culminant était une commémoration conjointe catholique et luthérienne du 500e anniversaire de la Réforme.
Ce rapprochement était particulièrement marquant compte tenu des tensions historiques entre les deux confessions chrétiennes du pays : dès le XVIe siècle, les catholiques furent persécutés, voire mis à mort, en Suède, et, encore en 1951, il leur était interdit de devenir médecins, enseignants et infirmiers. Les couvents et monastères catholiques, comme celui où Arborelius lui-même avait vécu, furent interdits jusque dans les années 1970.
À la suite de ce voyage, le pape François a nommé Arborelius cardinal en 2017, faisant de lui le premier cardinal suédois. Cette élévation a renforcé la réputation d'Arborelius dans son pays d'origine : en juin 2022, par exemple, le roi de Suède lui a décerné une médaille pour sa contribution à la vie nationale.
Quant à son orientation idéologique, Arborelius est notoirement difficile à cerner. Il est résolument traditionaliste en matière de morale sexuelle ; il a notamment supervisé la publication de l'encyclique Humanae Vitae de saint Paul VI en Suède en 2007, à l'approche du 40e anniversaire du document l'année suivante, louant son « respect de la nature » également dans le domaine de la « sexualité et de la reproduction ». Il s'est prononcé contre l'ordination des femmes, le célibat facultatif des prêtres et la « voie synodale » allemande, ouverte à tous.
Pourtant, Arborelius a également des opinions traditionnellement considérées comme plus progressistes sur des questions telles que l'œcuménisme et le dialogue interreligieux (y compris avec l'islam), l'immigration, le changement climatique et l'appel du pape François à un style de prise de décision plus « synodal » dans l'Église, ainsi que les restrictions imposées par le défunt pape sur la célébration de l'ancienne messe latine.
Sur le plan personnel, il est presque impossible de trouver quelqu'un qui n'apprécie pas Arborelius. Il est perçu comme un homme ouvert, généreux et affable, enclin au dialogue sincère et s'intéressant vivement aux autres, ainsi que comme un homme d'une grande profondeur spirituelle. Certains se demandent même s'il n'est pas presque trop gentil, suggérant que son penchant à éviter les conflits a parfois engendré une approche faible et hésitante de la gouvernance dans son propre diocèse.
Le pour...
Si l'une des exigences fondamentales du poste de pape est d'être l'évangéliste en chef de l'Église catholique, Arborelius correspond sans doute à ce profil. Il est considéré comme un missionnaire particulièrement doué dans les régions les plus laïques d'Europe, là où les feux de la foi semblent les plus menacés. Malgré le dynamisme actuel de l'Église dans le monde développé, personne n'est prêt à faire une croix sur l'Europe, et Arborelius pourrait être considéré comme particulièrement capable de relancer l'Église sur le Vieux Continent.
De plus, son mélange intrigant de positions conservatrices sur certains sujets et progressistes sur d'autres pourrait faire de lui un candidat idéal pour un compromis entre ceux qui recherchent la continuité avec le pape François et ceux qui aspirent à une plus grande stabilité et clarté doctrinales. Chacun obtiendrait au moins une partie de ce qu'il souhaite avec Arborelius, ainsi que l'assurance que le nouveau pape sera quelqu'un qui écoutera au moins leurs préoccupations et les prendra au sérieux.
En termes de logique conventionnelle du handicap de conclave, Arborelius coche un certain nombre de cases habituelles.
Il maîtrise sans aucun doute les langues traditionnellement considérées comme souhaitables et, à 75 ans, il se situe dans la tranche d'âge idéale (les deux derniers papes, Benoît XVI et François, ont été élus respectivement à 78 et 76 ans). Bien qu'il ne possède pas une grande expérience internationale en matière de service à l'étranger, il a beaucoup voyagé au fil des ans et, quoi qu'il en soit, le monde est venu à lui en Suède, au sein de l'Église multiethnique et multilingue qu'il préside.
Les arguments contre ?
La réputation d'Arborelius en tant qu'administrateur indécis et parfois faible n'aide pas, surtout à un moment où la plupart des cardinaux pensent que terminer la réforme du Vatican commencée sous le pape François (ou la corriger, selon votre point de vue) va nécessiter une main ferme à la barre.
De plus, la façon dont Arborelius mélange continuité et rupture avec l’héritage du pape François pourrait nuire à ses chances plus qu’elle ne les aide, le laissant effectivement comme un homme sans pays, c’est-à-dire sans base de soutien solide dans aucun camp.
De plus, Arborelius lui-même a admis qu'il n'avait pas encore développé le vaste réseau de relations parmi ses collègues cardinaux qui serait utile en termes de calcul électoral du conclave, déclarant récemment qu'il ne connaissait personnellement qu'environ 20 ou 30 de ses collègues électeurs - loin des 89 voix nécessaires pour franchir le seuil des deux tiers.
Dans une récente interview avec Our Sunday Visitor , Arborelius a proposé un profil du prochain pape.
« C’est ce dont les gens ont vraiment besoin dans une période comme celle-ci : que nous trouvions quelqu’un qui puisse les aider à se libérer du péché, de la haine, de la violence, pour parvenir à la réconciliation et à une rencontre plus profonde », a-t-il déclaré.
Le temps nous dira si ses frères cardinaux sont d’accord avec cette évaluation… et s’ils voient en Arborelius lui-même l’homme qui peut le faire.