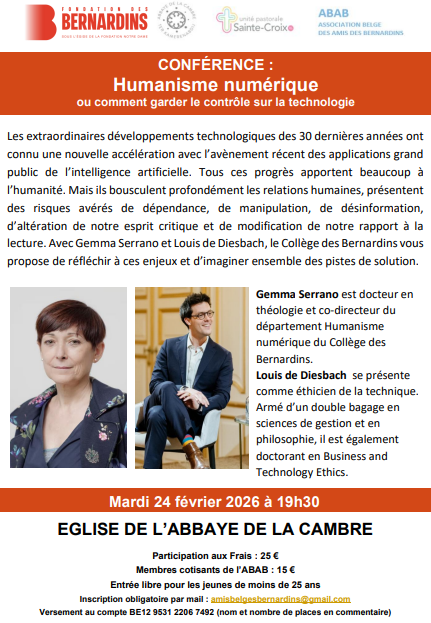De sur le NCR :
L'évêque qui a prédit la culture de mort d'aujourd'hui — il y a 50 ans
COMMENTAIRE : L’archevêque gallois John Murphy savait que le monde séculier fonde ses espoirs sur la carrière, le confort et l’argent. La vie, lorsqu’elle ne correspond pas à ces critères, est considérée comme superflue.
L'archevêque John Aloysius Murphy (1905-1995), dont la vie, comme celle de saint John Henry Newman (1801-1890), a couvert la majeure partie du siècle dans lequel il a vécu, est un homme digne d'être rappelé pour plusieurs raisons.
Durant son mandat d'archevêque de Cardiff, au Pays de Galles, de 1961 à 1983, il fut justement surnommé « Le Bâtisseur ». À son arrivée à Cardiff, il n'y avait que deux écoles secondaires catholiques dans tout le sud du Pays de Galles.
Avant la fin de la décennie, l'archidiocèse avait créé 14 écoles polyvalentes pour répondre aux besoins des milliers d'enfants catholiques de la région. Entre 1960 et 1980, l'archevêque Murphy supervisa la construction de 39 églises, 14 nouveaux collèges et lycées et 33 nouvelles écoles primaires. Son œuvre fut à la fois exceptionnelle et historique. Son engagement dans ce programme de construction pour l'Église ne l'empêcha cependant pas d'apporter une contribution significative au Concile Vatican II.
Il était bien connu dans tout son diocèse, non seulement pour ses visites aux paroisses, mais aussi pour ses lettres pastorales, qui révélaient son talent d'écriture. Il affirmait que s'il n'était pas devenu prêtre, il aurait aimé faire carrière dans le journalisme.
Tous ses propos ne sont pas tombés dans l'oubli. Sensible à son époque, il prédit que, « dans un avenir laïque et humaniste, où le seul péché sera la souffrance, le seul mal la maladie ; où les enfants seront considérés comme une maladie, et les maladies incurables intolérables ; où il est tout à fait possible que les êtres humains libres se voient interdire d'avoir un enfant ; ... dans cet avenir froid et clinique, vous chercherez en vain les rebelles ailleurs que dans les rangs de l'Église catholique. »
Si les paroles de l'archevêque n'étaient pas une prédiction, elles n'en constituaient pas moins un avertissement. Il avait pressenti la pandémie d'avortements et la prolifération de l'euthanasie. Mais il avait aussi perçu les tendances inhérentes à un monde séculier et sans Dieu, incapable de se corriger. Seule l'Église catholique pouvait sauver le monde. Seuls les catholiques prêts à se rebeller pouvaient le ramener sur le chemin de la guérison.
Si les catholiques du monde actuel prenaient au sérieux l'avertissement de l'archevêque Murphy, ils se rebelleraient contre un monde qui idolâtre le confort et qui trouve intolérables la douleur de l'accouchement et la solitude des personnes âgées.
L’humanisme séculier porte en lui les germes de sa propre destruction. C’est ce que l’archevêque Murphy avait compris. Et c’est pourquoi il a perçu l’impérieuse nécessité pour les catholiques (et sans doute aussi pour d’autres évêques) de se rebeller contre un ennemi de la vie.
Ceux qui défendent la vie ne doivent pas se laisser intimider par les hautes sphères du pouvoir. Dans l'affaire Beal c. Doe (1977), le juge Thurgood Marshall de la Cour suprême a exprimé son mépris pour les défenseurs de la vie. « Je suis consterné », a-t-il écrit, « par la faillite morale de ceux qui prônent un "droit à la vie" qui, dans le cadre des politiques sociales actuelles, se traduit par une existence misérable pour tant de pauvres et leurs enfants. »
Il est intéressant de noter que Clarence Thomas, devenu juge à la Cour suprême, est né dans la cabane en bois de ses parents à Pin Point, en Géorgie. Son enfance fut marquée par une extrême pauvreté. Après l'abandon du foyer par son père, il fut élevé par son grand-père au sein d'une communauté Gullah défavorisée. Les ancêtres les plus anciens connus de Thomas étaient des esclaves. Ce n'est qu'à l'âge de sept ans qu'il bénéficia pour la première fois de commodités telles que l'eau courante et des repas réguliers.
Poussé à son terme logique, l'argument de Marshall impliquerait que quelqu'un comme Clarence Thomas, aujourd'hui le membre le plus ancien de la Cour suprême, aurait peut-être mieux fait de ne pas naître.
Il semblerait que Marshall n'ait guère d'affection pour les chrétiens, puisque leur fondateur est né dans une crèche. Les dirigeants politiques devraient œuvrer à sortir les pauvres de la misère plutôt que de les condamner à une mort prématurée en partant du principe abusif que la pauvreté sera toujours leur fléau.
Le juge Marshall était un homme instruit, mais il n'avait peut-être pas lu « His Eye Is on the Sparrow », l'autobiographie d'Ethel Waters, conçue suite à un viol dans une banlieue misérable de Philadelphie, mais devenue par la suite une chanteuse de jazz immensément célèbre et une actrice de théâtre et de cinéma distinguée.
Il ignorait peut-être l'histoire de Wilma Rudolph, la dix-septième enfant née de parents noirs pauvres. Malgré un handicap dès son plus jeune âge, elle remporta trois médailles d'or en athlétisme aux Jeux olympiques de Rome de 1960.
Sans la foi en un Dieu bienveillant, l'espoir disparaît et le désespoir s'installe. Même les personnes en position d'autorité peuvent avoir une piètre opinion d'autrui.
Il convient de se souvenir de l'archevêque Murphy et de l'imiter comme d'un bâtisseur d'espoir et comme d'un modèle de courage pour les évêques d'aujourd'hui, sévèrement critiqués pour leur prétendue inertie morale. La foi, l'espérance et la charité ne sont pas les fondements de l'humanisme séculier. Le monde séculier fonde ses espoirs sur la carrière, le confort et l'argent. La vie, lorsqu'elle ne correspond pas à ces critères, est considérée comme négligeable.
Certains se rebellent simplement par colère contre la vie ou par oisiveté. L’archevêque Murphy appelle les catholiques à se rebeller pour une bonne raison : s’opposer à la faillite morale d’un monde indifférent au caractère sacré de la vie et qui considère ses défenseurs comme des ennemis.
Qui héritera du monde ? La réponse est : tous ceux à qui Dieu a fait don de la vie.