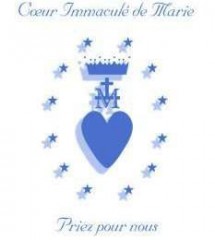Du site "Nouvelle Evangélisation" :
Né près de Barcelone, dans le château familial de Villafranca de Penades, probablement vers 1175, Raymond de Penafort était apparenté aux comtes de Barcelone et aux rois d'Aragon. Il étudia à l'école cathédrale de Barcelone où, à peine âgé de vingt ans, il enseigna la rhétorique et la logique. En 1210, il partit étudier le droit civil et le droit canonique à Bologne. En compagnie de Pierre Ruber, il fit la route à pied, par Arles et Turin ; il s’arrêtèrent quelques jours à Briançon pour constater un miracle que venait d’opérer Notre-Dame de Delbeza qui rendit les yeux et les mains à un jeune homme mutilé par des brigands. Après avoir été reçu docteur (1216), il resta à Bologne où, pendant trois ans, il enseigna le droit canonique avec tant de succès que les Bolonais lui offrirent des appointements prélevés sur les ressources de la ville ; après avoir donné le dixième de son salaire au clergé de sa paroisse, il distribuait le reste aux pauvres, ne gardant pour lui que le strict nécessaire.
L'évêque de Barcelone, Bérenguer de Palou[1], qui passait par Bologne, au retour d’un pèlerinage à Rome, entendit si fort chanter les louanges de Raymond de Penafort qu'il le recruta pour le séminaire qu'il voulait fonder dans son diocèse, et l'emmena avec lui (1219). A Viterbe où résidait le pape Honorius III, ils rencontrèrent saint Dominique qui leur donna quelques uns de ses frères. Raymond de Penafort fut nommé chanoine de la cathédrale de Barcelone, puis prévôt du chapitre, archidiacre, grand vicaire et official (1220) ; outre qu'il fit donner une grande solennité à l'Ascension, il travailla fort au soin des pauvres qu'il nommait ses créanciers.
Le Vendredi Saint 1222, il quittait le clergé séculier pour les Dominicains, sans perdre pour autant son influence sur l'évêque et le diocèse de Barcelone. Voyant que ses supérieurs ne le traitaient pas comme les autres novices, le frère Raymond de Penafort demanda qu’on lui imposât une pénitence particulière pour les fautes commises pendant sa vie séculière ; c’est pour répondre à sa demande que le provincial lui ordonna d’écrire la « Summa de pænitentia », premier ouvrage du genre, qui rassemble les cas de conscience à l'usage des confesseurs.
Lorsque Pierre Nolasque[2], ancien marchand, fonda l'Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie de la Merci pour la rédemption des captifs (1223)[3], pour le rachat des prisonniers faits par les Musulmans, c'est Raymond de Penafort qui, dans la cathédrale de Barcelone, en présence de l'évêque et du roi Jacques I° d'Aragon[4], donna l'habit et le scapulaire aux premiers mercédaires ; il rédigera aussi la règle de ce nouvel ordre pour laquelle il obtiendra l'approbation du pape Grégoire IX (1235).
Quelques années plus tard (1229), le cardinal de Sainte-Sabine, Jean d'Abbeville[5], fut envoyé comme légat en Espagne pour prêcher la Croisade[6] contre les Maures, et mettre en application les décrets du quatrième concile du Latran ; [7] il devait aussi déclarer nul le mariage de Jacques I° d’Aragon avec Eléonore de Castille. Le légat s'adjoignit Raymond de Penafort qui le précéda dans toutes ses visites canoniques et prit part à tous les actes importants de la légation. Le cardinal de Sainte-Sabine en rendant compte de sa mission au Pape (Pérouse le 25 novembre 1229), mit en avant la coopération efficace de Raymond de Penafort qui, le 28 novembre, fut chargé par Grégoire IX[8] de prêcher dans les provinces d'Arles et de Narbonne la Croisade dirigée par Jacques I° d’Aragon pour chasser les Maures de Majorque.

 C’est le mardi 6 janvier que tombe la fête de l’Épiphanie. Dans les églises, elle est pourtant célébrée ce dimanche 4 janvier. Trois questions pour mieux pour comprendre.
C’est le mardi 6 janvier que tombe la fête de l’Épiphanie. Dans les églises, elle est pourtant célébrée ce dimanche 4 janvier. Trois questions pour mieux pour comprendre.