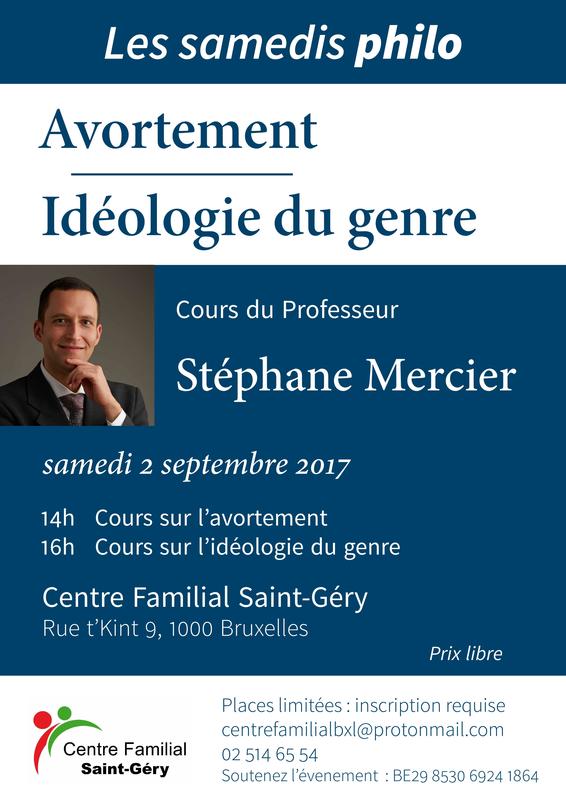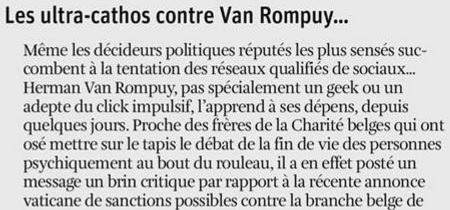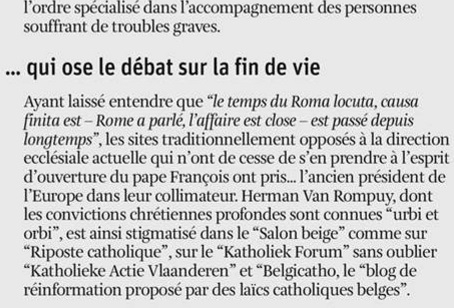De Jeanne Smits sur le site "Réinformation TV" :
L’Académie pontificale des sciences organise de nouveau une conférence sur le climat avec des partisans du contrôle de la population et de l’avortement
Perseverare diabolicum. Une nouvelle conférence sur le climat sera organisée début novembre sur le territoire du Vatican, avec une prise de parole inaugurale par le secrétaire d’Etat, le cardinal Parolin, avec – une nouvelle fois – plusieurs participants connus pour être favorables à l’avortement et au contrôle de la population. Sous prétexte de parler au monde à travers de soi-disant spécialistes, l’Académie pontificale des sciences (PAS) donne la vedette à des hommes d’influence qui œuvrent au service de la culture de mort.
Parmi ces orateurs on note la présence d’un des grands « experts » qui ont contribué à la réalisation de Laudato si’, Joachim « John » Schellnhuber, membre du très malthusien Club de Rome. Il est membre du GIEC, conseiller spécial de Merkel et Barroso, membre de nombreuses académies scientifiques parfaitement dans le vent du « changement climatique », directeur du Potsdam Institute qui travaille sur les répercussions de celui-ci. Sur le plan politique, il ne cache pas son souhait de voir l’avènement d’une « gouvernance globale », une « société démocratique globale » chapeautée par l’ONU et organisée autour d’une « Constitution de la Terre », un « Conseil global » et une « Cour planétaire ».
L’Académie pontificale des sciences invite Jeffrey Sachs, John Schellnhuber…
Schellnhuber s’est défendu d’être partisan de la « dépopulation », préférant prêcher un changement de comportement qui réduira l’empreinte carbone des hommes, spécialement dans les pays riches. Mais en tant que membre du Club de Rome qui depuis sa fondation a fait le choix malthusien de recommander une « stabilité » de la population avec limitation sévère des naissances, et décroissance économique à travers une égalisation mondiale des revenus par tête, Schellnhuber assume forcément cette idéologie de haine de l’homme. Sans quoi il irait voir ailleurs.
Sera également présent lors de la réunion de novembre Peter Raven, qui lui, était présent lors du dernier symposium de l’Académie pontificale des sciences sur l’extinction biologique, à laquelle participait par exemple Paul Ehrlich, l’auteur malthusien de The Population Bomb aux multiples affirmations démenties par la réalité (à l’en croire, sans stabilité de la population mondiale, on allait vers la famine dans de nombreux pays pas plus tard qu’en 1980). Raven, spécialiste des papillons, des plantes et de l’évolution est tout sauf un gentil entomologiste évaporé : il a déclaré en février devant la PAS que « Nous devons à un certain point avoir un nombre limité de gens, c’est pourquoi le pape François et ses trois prédécesseurs les plus récents ont toujours dit qu’il ne faut pas avoir plus d’enfants qu’on ne peut bien en élever ». Glissement décidément très rapide.
Pour la défense du « climat », la parole aux partisans du contrôle de la population
Au programme – et chargé, en outre, de la session de synthèse qui devra clore les débats – on trouve aussi Jeffrey Sachs, qui voit dans l’avortement le moyen « à moindre risque et à moindre coût » pour empêcher les naissances en cas d’échec de la contraception. « La légalisation de l’avortement réduit de manière significative le taux de natalité total d’un pays ; d’environ un demi enfant en moyenne », a-t-il pu écrire – et ce n’était pas une critique.
Celui qui avait parlé à deux voix avec Paul Ehrlich en février au Vatican, le « chercheur » Sir Partha Dasgupta, est lui aussi en vedette. Grand laudateur de la barbare politique de l’enfant unique en Chine, il est l’un des parrains de « Population Matters » (autrefois connu comme l’Optimum Population Trust » qui plaide pour l’inversion de la croissance démographique, et il a déjà fait part devant la PAS de sa volonté de « décroissance » pour la préservation de la planète.
Le symposium de novembre veut présenter une étude « holistique » des relations entre le « changement climatique », la santé de la planète et des hommes, et la pollution de l’air. Et des politiques auront la parole : le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, entré en résistance contre Donald Trump et son refus des Accords de Paris sur le climat, mais aussi Michelle Bachelet, présidente du Chili, dont l’une des grandes priorités politiques – la fin de l’interdiction de l’avortement – vient de devenir réalité dans son pays grâce au vote favorable du Sénat.
Michelle Bachelet, qui a fait légaliser l’avortement, invitée à une conférence au Vatican
On voit dans tout cela la patte du président de la PAS, Mgr Marcelo Sanchez Sorondo, qui a multiplié les mains tendues vers les ennemis de l’Eglise et de l’homme. Margaret Chan, la présidente d’origine chinoise de l’OMS – qui œuvre elle aussi pour l’avortement « sûr et légal » – n’interviendra donc pas par hasard.
La dimension spirituelle n’est pas oubliée. Sanchez Sorondo présidera, au dernier jour du symposium, l’« Appel à l’action des leaders religieux », où voisineront un rabbin, un pasteur évangélique, un évêque anglican. Mais aussi et surtout le gourou Sri Sri Ravi Shankar, grand penseur mystico-gazeux qui imagine tout pouvoir résoudre par des techniques de respiration. Son International Art of Living Foundation a obtenu le statut consultatif spécial des ONG auprès des Nations unies : elle inspire des ashrams dans de nombreux pays. Il interviendra donc comme « Leader humanitaire, maître spirituel et ambassadeur de la paix ».
Et tant pis pour Dieu, et pour le premier et le plus grand des commandements.