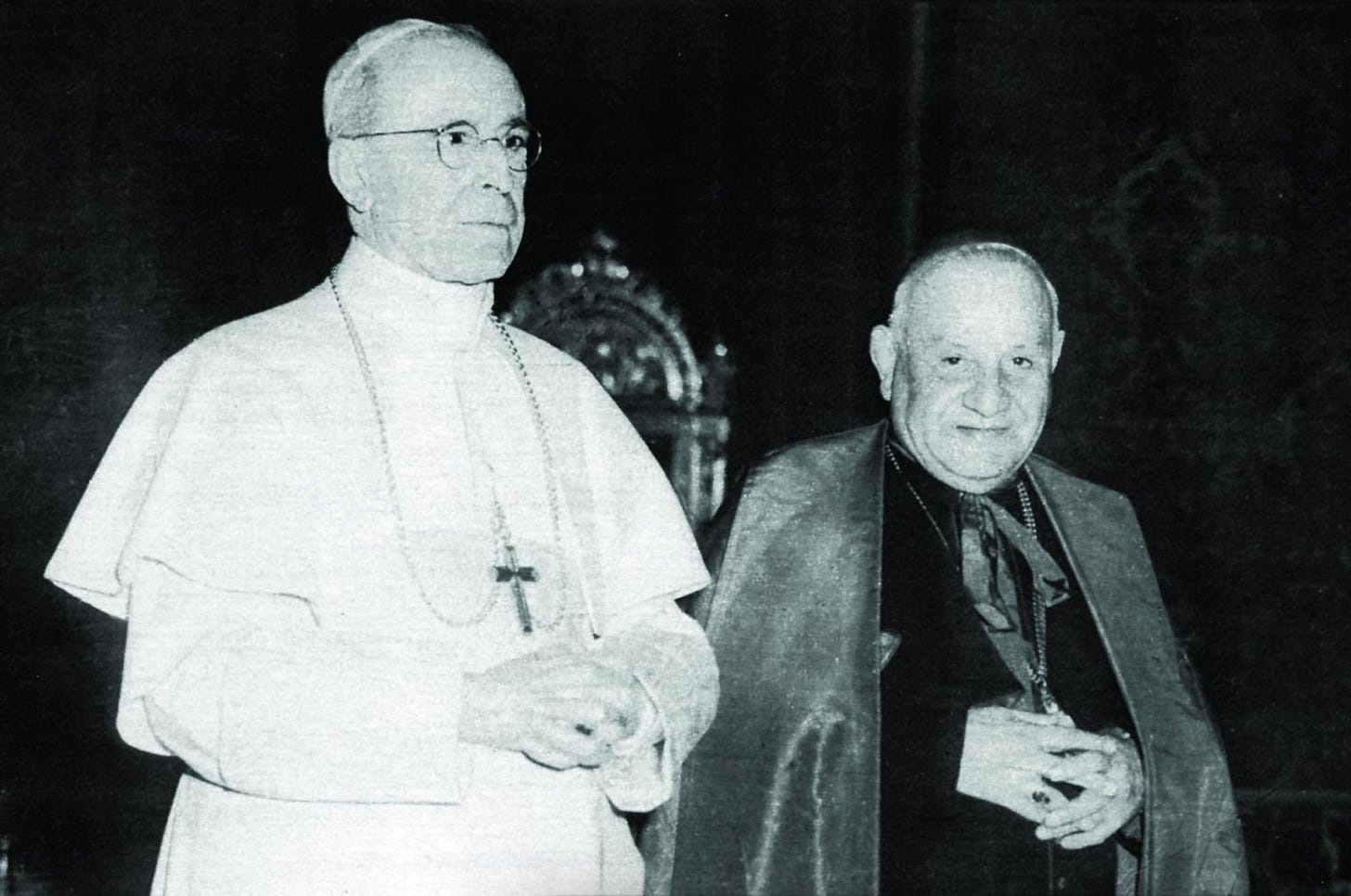(s.m.) Je reçois et je publie. L’auteur de cette note, Pietro De Marco, est expert en philosophie, théologie et histoire, il a enseigné la sociologie de la religion à l’Université de Florence et à la Faculté théologique de l’Italie centrale.
*
Le Saint-Siège et la conjoncture au Moyen-Orient
de Pietro De Marco
1. Médiation et arbitrage
La suspension des guerres en cours ne passe pas par la mise en œuvre d’un arbitrage classique. En effet, dans aucun des cas de belligérance, de l’Ukraine aux deux fronts du Proche-Orient (Israël-Hamas, Israël-Iran), il ne s’agit de guerres déclarées visant à obtenir « une solution politique par d’autres moyens » dans le but de résoudre un différend, mais bien des guerres de valeurs, qui visent à la destruction d’un ennemi moral et culturel, ou encore des guerres « asymétriques » d’un type nouveau, provoquées et menées par plusieurs sujets et avec une variété de tactiques, par définition non déclarées.
Dans le cas russo-ukrainien, le caractère idéal et les valeurs invoquées par Poutine sont fictifs et ne sont que pure propagande, et le « casus belli » n’est qu’un prétexte, mais elles demeurent un nœud autour du cou de ceux qui ont initié l’agression.
Sur la scène du Moyen-Orient, les acteurs agressifs, et par conséquent ceux qui réagissent et s’opposent à eux (Israël, et en partie les États-Unis), se positionnent d’emblée – c’est-à-dire dans la réalité quotidienne des guerres hybrides – hors de l’autorité d’arbitrage des organismes internationaux et du droit international lui-même.
Ce dernier, en fin de compte, n’est qu’un système sans pouvoir coercitif, et il n’est d’ailleurs pas en mesure de l’obtenir sinon de manière controversée et inefficace. Seul un « dominus » planétaire, seul détenteur d’une coercition légitime, pourrait juger et sanctionner, et donc peut-être prévenir, un conflit entre parties et entre États. Mais il faudrait pour cela qu’il passe d’abord sur le corps de tous les prétendants au trône. Ce qui relève davantage de la dystopie que de l’utopie.
Nous assistons donc dans les faits à des guerres hybrides de type « guerre révolutionnaire ». Les guerres hybrides sont très étudiées et ne sont pas bien difficiles à identifier ; mais l’opinion publique démocratique, encline à nier que l’Occident puisse avoir des ennemis, réagit encore en condamnant la moindre velléité de puissance de ses opposants. Pareil parmi les juristes.
L’une caractéristique des guerres hybrides sédimentées depuis longtemps est leur dimension d’endoctrinement capillaire du groupe humain à « libérer », c’est-à-dire à sacrifier en masse le jour où l’on en vient aux armes. L’endoctrinement est en fait la manipulation de l’univers imaginaire des individus pour le peupler d’ennemis moraux à haïr aujourd’hui et à éliminer demain. Un jeune participant au raid du 7 octobre a téléphoné fièrement à ses parents en disant : « Regardez ! J’ai tué pas moins de dix Juifs ! ».
C’est ainsi que tout à fait ouvertement, dans le projet d’hégémonie chiite au Moyen-Orient, Israël est d’abord et avant tout « inimicus » (l’ennemi moral) et non « hostis » (l’ennemi sur le champ de bataille, l’adversaire), pour reprendre une distinction classique et indispensable. « Inimicus » qui devient aussi « hostis » dans les conflits armés, faisant oublier à certains observateurs que, dans ces guerres atypiques, les hostilités sont en fait l’émergence contingente d’une guerre menée entre deux camps, depuis un certain temps, sous d’autres formes.
En résumé, les guerres de ces dernières années, ou de ces derniers jours, montrent aussi ce qu’est une guerre hybride « révolutionnaire ». Paradoxalement, l’artisan de paix qui obtiendrait le retrait de l’armée israélienne de Gaza devrait poursuivre à son tour (et comment ?) le travail de liquidation des milices insurgées, sinon il n’y aura pas de paix. La guerre hybride est la condition constante du Sud-Liban, que l’opinion publique ne voit que lorsque les chars israéliens se déplacent.
Il est donc difficile de se poser en arbitres entre les haines et autres pulsions culturelles non négociables, ou qui ne sont négociables et surmontables qu’entre individus (l’individu juif, l’individu palestinien, l’individu iranien, etc.). Bien sûr, sur le front iranien, il est possible de négocier des contrôles internationaux des sites d’enrichissement d’uranium et de plutonium qui seraient constants et sans entrave. Mais, avec la classe dirigeante iranienne actuelle, ce serait négocier l’impossible. Et s’il est question d’un contrôle extérieur imposé, comme il devra l’être en fin de compte, cela reviendrait à placer sous protection internationale une zone (nucléaire et militaire) de souveraineté nationale iranienne. Ce « vulnus » de souveraineté nécessaire rentrerait alors dans le domaine des interventions préventives obligatoires, relevant de la compétence de l’ONU. Mais la lenteur et la partialité de l’ONU – à tel point que l’on pourrait dire que l’ONU elle-même est partie prenante à une guerre hybride contre Israël depuis des décennies – rend cette organisation internationale peu fiable, incapable de prendre des mesures préventives efficaces, comme cela a été le cas avec le soi-disant confinement du Hezbollah au Sud-Liban.
Ce contexte confère à l’État juif une grande latitude décisionnelle. Une fois la certitude et l’imminence du risque avérés, cette latitude lui permet d’exercer légitimement la riposte préventive. Même dans le cas de Gaza, on peut soutenir qu’il faille considérer la poursuite de la guerre, après la première réponse de représailles au raid du 7 octobre, comme une prévention légitime contre toute agression analogue dans le futur.
La légalité de la guerre d’Israël est fortement débattue, particulièrement celle qu’elle vient de déclarer contre l’Iran, tout comme sa vision politique à long terme, avec deux fronts ouverts (qui sont en réalité un même front). Qui vivra verra.
Selon la doctrine actuelle, la guerre préventive en tant que telle présuppose qu’« il ne peut y avoir de réintégration du droit [dans le cadre international] à travers un processus normal ». Mais cette conviction et ses conséquences portent à légitimer une situation anti-juridique ou pré-juridique (« l’état de nature » de Kant), légalisant de facto ce qui est « ex lege ». Pourtant, il y a des situations limites que le droit reconnaît universellement et qu’il n’abandonne pas à « l’état de nature », mais plutôt à des disciplines : toutes les urgences, et le droit de la guerre tout entier. L’affirmation selon laquelle on ne peut pas être à la fois en faveur de la guerre préventive tout en restant démocratiques dans l’ordre international ne tient pas compte de l’état de nécessité.
L’action destructrice d’un danger imminent n’a pas et ne peut pas avoir de « stratégie de sortie » en soi. L’urgence étant d’anéantir le danger lui-même, c’est-à-dire l’ennemi en tant que tel. Lorsqu’une guerre hybride émerge comme un combat à proprement parler, la définition de la guerre s’y adapte pleinement. L’élaboration de l’après relève du politique. Le travail des organismes internationaux et des organes politiques devrait se concentrer sur cela, plutôt que sur le cours de la guerre, qui a sa propre logique. Mais, comme on suppose que rien de politique ne se passe à Gaza et qu’il ne s’agit que d’un drame humanitaire, personne ne travaille sérieusement à l’après.
2. Quelle activité diplomatique pour le Saint-Siège ?
Dans ce contexte, quel jugement public et quelles actions peut-on attendre du Saint-Siège ? Je parle bien du « Saint-Siège », parce qu’une action aux modalités résolument personnalistes (qui se ferait au détriment de la Secrétairerie d’état et d’autres organismes) comme le faisait le pape François n’était pas et n’est pas destinée à avoir des effets. Pour cesser, les guerres n’ont pas besoin d’une « voix autoritaire » supplémentaire pour prêcher la paix, car il n’y a pas d’énoncés performatifs sans réalités, sans forces, aptes à les mettre en œuvre. Pour cesser, les guerres ont besoin d’une véritable élimination de leurs causes, ou à tout le moins d’une partie nécessaire et suffisante d’entre elles.
En ce qui concerne le Saint-Siège, à moins d’opter pour un sage silence, la formulation publique d’un jugement « complet » serait quant à elle qualifiante. Pour me faire bien comprendre : je considère par exemple comme incomplète et en fin de compte erronée toute formulation « humanitaire » sur Gaza ne désignant pas explicitement le Hamas comme co-responsable quotidien – et premier responsable – des souffrances actuelles de la population palestinienne.
Quant au conflit israélo-iranien, on a peut-être entrevu un jugement « complet », même dans le langage de la diplomatie, lors de l’audience jubilaire du 14 juin dernier, au cours de laquelle Léon XIV a déclaré, avec la brièveté qui le caractérise et que nous espérions tant, qu’il n’est pas licite entre les peuples d’attenter à l’existence d’autrui. Dans cet appel, qu’il a intercalé dans les salutations à des groupes de pèlerins, il a déclaré ceci : « Personne ne devrait jamais menacer l’existence d’autrui. Il est du devoir de tous les pays de soutenir la cause de la paix […] en favorisant des solutions garantissant la sécurité et la dignité pour tous ».
Avec quelques paroles supplémentaires, le Saint-Siège pourrait éventuellement associer d’une manière sans équivoque cette déclaration à la pratique croissante de l’Iran de mener une guerre hybride contre Israël (et indirectement contre les pays arabes) ces vingt dernières années. Prendre position contre, ne serait-ce que par principe, donne de la force et non de la faiblesse à la tierce partie, en l’occurrence à un pape, qui ne se positionne pas en ennemi mais qui montre néanmoins qu’il dispose de critères de jugement.
Un expert allemand du Moyen-Orient aurait objecté à une observation que le chancelier Merz a laissé échapper (« Israël fait le travail à la place et dans l’intérêt d’un Occident sans défense ») qu’à ce moment-là, ce n’est pas le régime iranien qui était menaçant, mais bien des citoyens iraniens qui étaient menacés. J’ai écrit en son temps que l’intellect occidental contemporain, l’intellect moyen, est en proie à un syndrome le rendant incapable de distinguer le moment empathique du moment rationnel-analytique et qui, en tout cas, privilégie le premier sans discernement. À cause d’une « koinè » philosophique de salon qui, depuis des décennies, fait la part belle au « sentiment ».
Sinon, comment le « sentiment » de compassion pourrait-il effacer soudainement des consciences le cadre des rapports entre les puissances, les cas de destruction entre les civilisations et l’irréductibilité concrète des guerres à la piété des spectateurs ? Et c’est ce même « sentiment » qui préside chaque jour de manière irrationnelle, à de nombreuses références dilettantes au droit international ou humanitaire ; de manière irrationnelle, non pas parce que la référence à la loi ne serait pas rationnelle, mais parce qu’elle ne peut pas être pensée comme le recours à des formules incantatoires. C’est illusoire et inutile.
Puisse le Saint-Siège retrouver sa rationalité séculaire et la compassion catholique.
———
Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.
Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur diakonos.be en langue française.
Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.