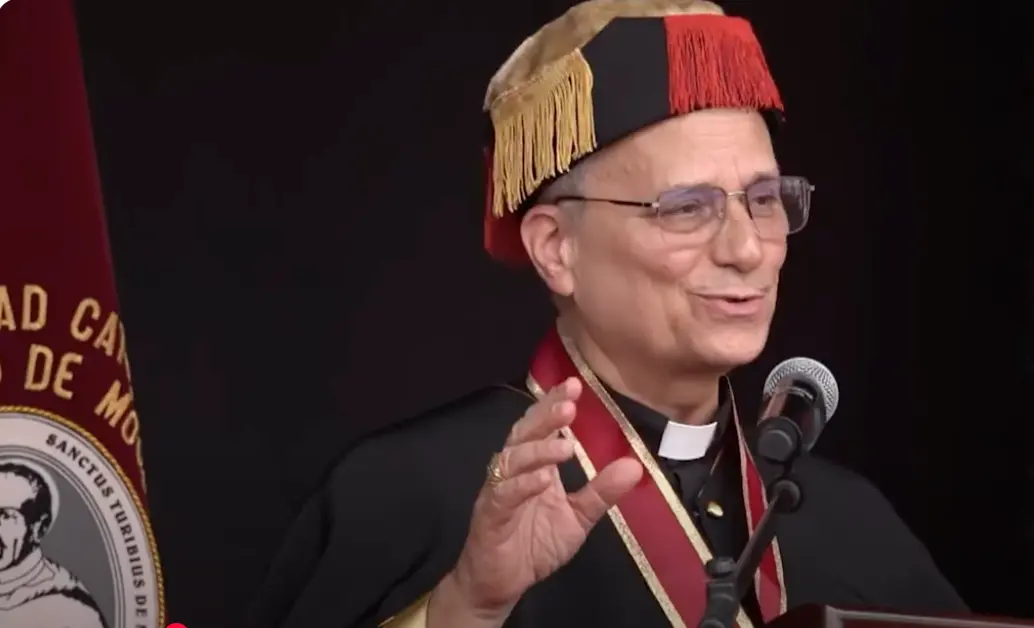A la question : "Au vu d'une conception chrétienne des relations internationales, que faut-il penser de la politique de Trump à l'égard du Venezuela et de l'exfiltration de Maduro ?", un site d'intelligence artificielle nous répond :
Principes chrétiens en relations internationales
Dans une perspective chrétienne, les relations entre nations ne sont pas régies par la seule puissance ou l'intérêt national, mais par des normes éthiques dérivées de la Bible et de la tradition chrétienne. Voici les clés pertinentes :
- Souveraineté et non-ingérence : Les nations sont vues comme des entités ordonnées par Dieu (Actes 17:26), avec un droit à l'autodétermination. L'intervention étrangère doit être exceptionnelle, justifiée par une grave menace ou une crise humanitaire, et préférablement autorisée par une instance légitime comme l'ONU (analogue à une « autorité supérieure » dans la théorie augustinienne).
- Théorie de la guerre juste : Pour qu'une action militaire soit légitime, elle doit répondre à des critères stricts :
- Cause juste (défense contre une agression ou protection des innocents).
- Autorité légitime (décision prise par une instance reconnue, non unilatérale).
- Intention droite (viser la paix et la justice, non le gain personnel ou la vengeance).
- Dernier recours (après épuisement des moyens pacifiques comme la diplomatie ou les sanctions).
- Proportionnalité (les bénéfices doivent l'emporter sur les dommages).
- Chance raisonnable de succès.
- Justice, miséricorde et humanité : Le christianisme insiste sur la protection des opprimés (Psaume 82:3-4), mais aussi sur la non-violence quand possible (Matthieu 26:52). Les actions doivent promouvoir la dignité humaine, éviter les souffrances inutiles et viser une paix durable, non une domination.
Les chrétiens sont divisés sur l'application de ces principes : certains, influencés par une vision « providentialiste » ou nationaliste, soutiennent des interventions pour « libérer » des peuples ; d'autres, plus pacifistes ou universalistes, les rejettent comme contraires à l'Évangile de paix.
La politique de Trump envers le Venezuela
Sous la première présidence de Trump (2017-2021), la politique vis-à-vis du Venezuela s'est centrée sur des sanctions économiques sévères contre le régime de Maduro, accusé de violations des droits humains, de fraude électorale et de liens avec le narcotrafic. Trump a reconnu Juan Guaidó comme président intérimaire en 2019 et a exploré des options pour un départ négocié de Maduro. Dans sa seconde présidence (à partir de 2025), cela a culminé en une escalade militaire : déploiement naval dans les Caraïbes, frappes contre des navires soupçonnés de trafic de drogue, et enfin l'opération « Absolute Resolve » le 3 janvier 2026. Cette opération, menée par des forces spéciales américaines, a consisté en une incursion nocturne à Caracas pour capturer Maduro et son épouse, Cilia Flores, les extrayant vers les États-Unis pour les juger sur des chefs d'accusation liés au narcotrafic. Trump a annoncé que les États-Unis « géreraient » le Venezuela temporairement jusqu'à une transition, en soutenant Delcy Rodríguez comme présidente intérimaire (bien qu'elle ait condamné l'action), et a évoqué l'exploitation des réserves pétrolières vénézuéliennes par des compagnies américaines.
Cette « exfiltration » – un euphémisme pour une opération d'enlèvement militaire – a été justifiée par Trump comme une action de « maintien de l'ordre » contre un « narco-terroriste », non comme une guerre, mais elle a entraîné des morts (au moins 40 Vénézuéliens selon des rapports) et a été condamnée internationalement comme une violation de la souveraineté. (En fait, cette opération américaine de capture du couple Maduro aurait fait au moins 55 morts, 23 militaires vénézuéliens et 32 cubains (n.d.B.))
Évaluation à la lumière des principes chrétiens
Du point de vue chrétien, cette politique soulève des tensions profondes. Voici une analyse équilibrée :
Aspects potentiellement positifs ou justifiables
- Protection des opprimés et justice : Le régime de Maduro a causé une crise humanitaire majeure – hyperinflation, famine, exode de millions de Vénézuéliens, répression violente des opposants. Des chrétiens vénézuéliens et évangéliques (comme certains pasteurs exilés ou Franklin Graham aux États-Unis) y voient une « intervention divine » ou une réponse à des prières pour la libération d'un « dictateur maléfique ». Cela résonne avec des passages bibliques sur la chute des tyrans (Psaume 37:35-36) et la défense des faibles. Si l'intention était purement humanitaire, cela pourrait s'aligner avec une « intervention responsable » pour restaurer la justice, comme certains théologiens chrétiens défendent dans des cas de génocide ou d'oppression extrême.
- Fin d'une menace : Les liens présumés de Maduro avec le narcotrafic affectent les États-Unis (via l'immigration et les drogues), ce qui pourrait être vu comme une cause juste de défense nationale, analogue à la protection du « prochain » (Lévitique 19:18).
Aspects critiques ou problématiques
- Violation de la souveraineté et absence d'autorité légitime : L'opération unilatérale, sans approbation du Congrès américain, de l'ONU ou d'une coalition internationale, contrevient à la Charte des Nations Unies (que des théologiens chrétiens comme Mary Ellen O'Connell de Notre-Dame considèrent inspirée de principes chrétiens de paix). Cela ressemble à une agression impérialiste, contraire à la théorie de la guerre juste, qui exige une autorité reconnue. Des leaders chrétiens modérés (comme l'Église épiscopale américaine) appellent à une enquête, craignant l'instabilité et la violence accrue, et la qualifient de contraire aux résolutions de leur convention générale sur l'usage de la force.
- Intention discutable et proportionnalité : Trump a explicitement mentionné le contrôle des réserves pétrolières (« Nous allons le gérer... et garder tout ce pétrole »), ce qui suggère des motifs économiques plutôt que purs. Cela évoque une convoitise (Exode 20:17) et une domination, non la miséricorde. L'opération, bien que rapide, a causé des morts civiles et militaires, et risque un chaos post-Maduro (luttes de factions, instabilité régionale). Était-ce un dernier recours ? Les sanctions et la diplomatie étaient en place depuis des années, mais l'escalade militaire semble précipitée, non proportionnée.
- Manque de paix et de miséricorde : Des chrétiens progressistes et catholiques (comme les évêques vénézuéliens) insistent sur la confiance en Dieu plutôt que la violence, appelant à la prière et à la calme. Ils soulignent que célébrer la « chute » d'un homme, même tyran, ignore la dignité humaine (Genèse 1:27) et risque de perpétuer un cycle de vengeance. Des voix évangéliques vénézuéliennes, tout en espérant le changement, refusent la haine et appellent à la réconciliation.
En somme, une conception chrétienne authentique tendrait à critiquer cette politique comme non conforme à la guerre juste : elle manque d'autorité légitime, d'intention pure et de dernier recours, et risque de prioriser le pouvoir sur la paix. Bien que le soulagement pour les Vénézuéliens opprimés soit compréhensible – et que certains chrétiens y voient une justice divine –, l'approche unilatérale et motivée par l'intérêt national apparaît comme une forme d'arrogance humaine, contraire à l'humilité prônée par le Christ (Philippiens 2:3-4). Au lieu d'une intervention militaire, une réponse chrétienne privilégierait la diplomatie multilatérale, l'aide humanitaire et le soutien à une transition pacifique, en priant pour la guérison du Venezuela. Les divisions parmi les chrétiens reflètent des interprétations variées, mais l'appel biblique à la paix reste central.
... et vous, qu'en pensez-vous ?