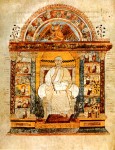De Claves.org :
Réponse aux trois (meilleurs) arguments pro-euthanasie
Face aux sirènes de l’euthanasie : répondre aux arguments de la souffrance, de l’autonomie et de la dignité
Clair, informé, rigoureusement argumenté, l’ouvrage de Matthieu Lavagna s’adresse à tous ceux qui veulent comprendre ce qui est réellement en jeu dans la légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté. Dans une société où le débat public s’enlise souvent dans l’émotionnel, l’auteur s’attelle à une tâche difficile : montrer qu’une position rationnelle et cohérente demeure possible et nécessaire. Après avoir exposé l’argument central contre l’euthanasie (voir notre article précédent) – à savoir qu’elle constitue un homicide volontaire, donc intrinsèquement immoral et incompatible avec le droit –, Lavagna entreprend de répondre aux principales objections formulées par ses défenseurs. Trois arguments en particulier, souvent invoqués par les partisans de l’euthanasie, méritent selon lui une attention sérieuse et une réponse détaillée : celui de la souffrance, celui de l’autonomie corporelle et celui de la vie prétendument « indigne d’être vécue ». À chacun, il oppose une réfutation claire, solide et décisive.
1. La souffrance : un drame humain, non une justification du meurtre
Le premier argument, sans doute le plus fréquent, consiste à invoquer la souffrance – physique ou psychique – pour justifier le recours à l’euthanasie. Il s’agit, au nom de la compassion, d’abréger une agonie jugée insupportable. Cette rhétorique, puissamment émotionnelle et souvent appuyée par l’évocation de cas particulièrement douloureux (et complexes), peut faire passer les opposants à l’euthanasie pour des êtres cruels, insensibles à la douleur humaine. Or rien n’est plus faux, rétorque Matthieu Lavagna : la véritable compassion n’est pas d’éliminer le patient, mais de soulager sa douleur. Et la médecine contemporaine dispose justement aujourd’hui de moyens puissants et efficaces pour cela : antalgiques, anesthésiques, sédatifs… Selon un consensus médical relayé par le Comité Consultatif National d’Éthique, « Les experts s’accordent pour dire que toute douleur peut aujourd’hui être soulagée » [1]. Il est donc possible, sans avoir recours à l’euthanasie, de soulager les souffrances du corps et d’accompagner le malade jusqu’au terme naturel de sa vie, dans le respect de sa dignité.
Matthieu Lavagna rappelle le principe du double effet (formulé par Jean de Saint-Thomas à partir des principes de saint Thomas d’Aquin), qui justifie moralement certaines pratiques médicales comme la sédation profonde (usage de traitements anti-douleurs dont un effet secondaire non désiré peut être d’accélérer la survenue de la mort) : on peut accepter un effet négatif (la mort anticipée) s’il n’est pas directement voulu, mais seulement toléré comme conséquence d’un acte bon (le soulagement de la douleur) qui ne peut être la conséquence de l’effet mauvais. Cette distinction est cruciale : le but du soin n’est pas de tuer, mais de soigner – tuer n’est jamais un soin.
Il faut aussi souligner, avec l’auteur, que le sous-développement des soins palliatifs est un choix politique (ou un non-choix, ce qui revient au même) : en France, la sédation profonde ne concerne aujourd’hui qu’environ 3 % des décès. En renforçant cette offre médicale, nous pourrions faire reculer de manière décisive les demandes d’euthanasie et le mal-être des personnes en fin de vie. Matthieu Lavagna regrette toutefois que la loi Claeys-Leonetti de 2016 ait introduit une ambiguïté grave : en considérant désormais l’alimentation et l’hydratation d’une personne en état de dépendance comme des traitements (et non comme des soins), autorisant leur interruption dans certaines circonstances, ouvrant ainsi la voie à une euthanasie par omission. Il plaide pour un retour aux principes plus équilibrés de la loi de 2005 (dite loi Leonetti). En somme, la souffrance est un drame, jamais un argument suffisant pour justifier l’élimination délibérée d’un être humain.
2. L’autonomie corporelle : un principe fondamental, mais non absolu
Deuxième pilier du discours pro-euthanasie : l’autonomie corporelle. Pourquoi l’État interdirait-il à une personne de disposer librement de son propre corps ? Ne sommes-nous pas maîtres de notre vie – et donc de notre mort ? Cet argument, popularisé par des penseurs comme Peter Singer ou des personnalités comme Line Renaud, repose sur une vision individualiste – et fausse – de la liberté. L’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité – principal lobby pro-euthanasie, auquel appartient Line Renaud) revendique ainsi la possibilité de choisir « le moment et les modalités » de sa mort comme l’expression ultime de l’autonomie personnelle.
Or cette conception absolutisée de la liberté ne résiste pas à l’analyse, souligne Matthieu Lavagna. D’abord, si l’on accepte ce principe, toute demande de mort devrait être recevable, y compris pour des raisons futiles : une peine de cœur, une dette, un échec professionnel… Ce que refusent tout de même les défenseurs de l’euthanasie, qui prétendent imposer des conditions, preuve qu’ils ne croient pas eux-mêmes à un droit illimité de se donner la mort.
Matthieu Lavagne observe en outre que l’État ne reconnaît déjà pas un droit absolu de disposer de son corps : la vente d’organes, la gestation pour autrui, l’usage de drogues dures ou encore l’achat de services sexuels sont encadrés, voire interdits. La liberté corporelle connaît donc des limites, dictées par le respect du bien commun et de la santé publique.
Enfin – et surtout – Matthieu Lavagna dénonce une équation fallacieuse : ce n’est pas parce qu’un patient demande à mourir que le médecin acquiert le droit de le tuer. Accepter cela reviendrait à dissoudre toute déontologie médicale : un médecin ne peut pas obéir aveuglément à des demandes objectivement contraires à la santé ou à la vie du patient, comme amputer sans raison un psychotique, ou affamer un anorexique, sous prétexte de respecter sa liberté ; certaines demandes sont moralement irrecevables. De plus, les droits fondamentaux – dont le droit à la vie – sont inaliénables : on ne peut y renoncer, même volontairement. La liberté ne consiste pas à faire ce que l’on veut, mais à choisir le bien ; l’autonomie ne saurait justifier la destruction volontaire de soi-même, encore moins impliquer autrui dans cet acte destructeur.
3. La dignité : une réalité objective, non un ressenti subjectif
Le troisième argument, plus insidieux et pourtant tellement « politiquement correct », postule qu’une vie gravement diminuée, marquée par la dépendance ou la souffrance, n’aurait plus de dignité – et qu’il serait alors plus « digne » de mourir que de vivre. Cet argument repose sur une vision subjective et utilitariste – en réalité terrible – de la dignité humaine. Pour Line Renaud, égérie de l’ADMD, « quand il n’y a plus de qualité de vie, il vaut mieux partir ». Matthieu Lavagna démasque la logique dangereuse d’une telle affirmation : si la valeur d’une vie dépend du ressenti individuel, alors il n’y a plus d’égalité entre les êtres humains. Que dire des personnes handicapées, des malades mentaux, des dépressifs ? Leur vie aurait-elle moins de valeur ? Leur droit à vivre serait-il conditionnel ? L’appréciation subjective que tout un chacun peut se faire de sa propre dignité crée-t-elle une distinction entre deux classes de personnes humaines ?
En réalité, la dignité humaine ne dépend pas de la conscience, de la santé ou de l’autonomie : elle est inscrite dans l’être même de la personne ; toute vie humaine a une valeur intrinsèque, qu’elle soit jeune ou âgée, valide ou dépendante, consciente ou non. La fragilité en particulier mérite et demande un respect et une considération particuliers. Admettre le contraire reviendrait à diviser l’humanité en deux catégories : ceux qui méritent la vie, et ceux qu’on peut éliminer. L’argument de la « dignité » conduit ainsi à une régression éthique majeure. Lavagna rappelle ici le véritable héritage des droits de l’homme : le respect de la vie humaine, en toute circonstance, est le fondement même de notre civilisation, rappelé notamment dans la Déclaration Universelle de 1948, aux termes de laquelle « tous les membres de la famille humaine » ont des « droits égaux et inaliénables » qui constituent « le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » et ont donc également « droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »[2]. L’abolir pour quelques cas-limites, aussi douloureux soient-ils, reviendrait à fragiliser la protection de tous et à introduire un terrible cheval de Troie dans l’édifice juridique dont la fonction même est la protection des personnes dans leurs droits les plus fondamentaux (le plus fondamental de tous n’est-il pas le droit à la vie, sans lequel aucun autre ne trouve de sens ?).
Un livre pour réveiller les consciences
Par son argumentation limpide, sa maîtrise des sources juridiques, médicales et philosophiques, L’euthanasie en débat s’impose comme une lecture indispensable pour tous ceux qui refusent de voir la compassion dévoyée en logique d’élimination. Matthieu Lavagna ne nie ni la complexité des situations, ni la profondeur des détresses, mais il démontre que la réponse juste ne saurait être la suppression du patient. En répondant avec clarté et précision aux trois principaux arguments pour la légalisation de l’euthanasie, il oppose un plaidoyer éclairé pour la vie, la vraie compassion, et une médecine fidèle à sa vocation première : soigner, toujours.
| ↑1 | CCNE, avis n°121, 30 juin 2013. |
|---|---|
| ↑2 | Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Préambule et Article 3. |
Lire également : L’argument majeur contre toute forme d’euthanasie