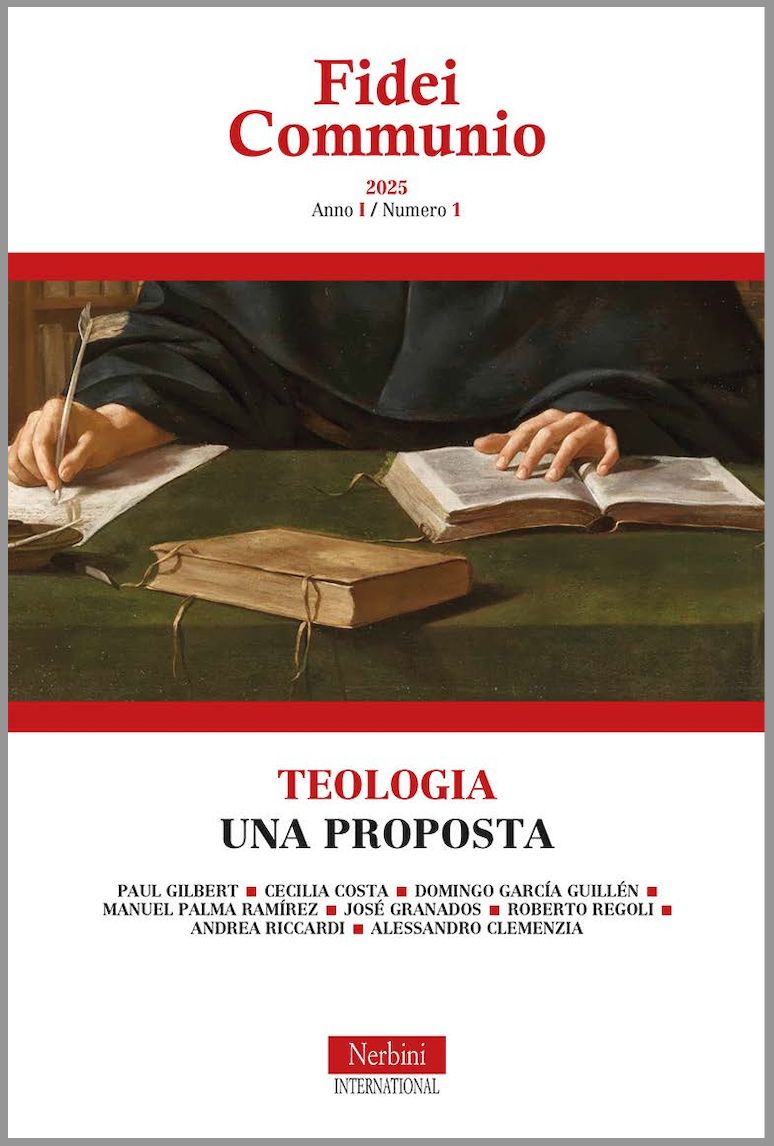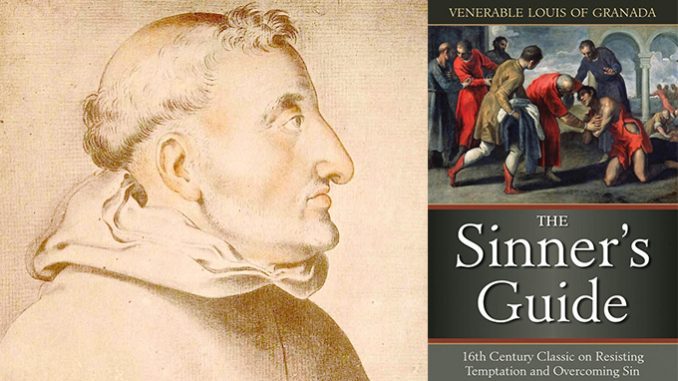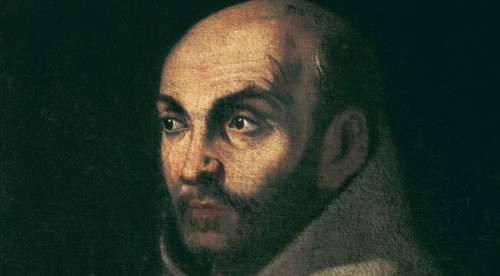Lors de l'audience générale du mercredi 3 juin 2009, le pape Benoît XVI a consacré sa catéchèse à Raban Maure, fêté aujourd'hui :
Chers frères et sœurs,
Je voudrais aujourd'hui parler d'un personnage de l'occident latin vraiment extraordinaire: le moine Raban Maure. Avec des hommes tels qu'Isidore de Séville, Bède le Vénérable, Ambroise Autpert, dont j'ai déjà parlé dans des catéchèses précédentes, il sut garder, pendant les siècles qui constituent ce qu'on appelle le Haut Moyen-âge, le contact avec la grande culture des antiques sages et des Pères chrétiens. Souvent rappelé comme "praeceptor Germaniae", Raban Maure fut d'une fécondité extraordinaire. Avec sa capacité de travail absolument exceptionnelle, il contribua peut-être plus que tout autre à garder vivante cette culture théologique, exégétique et spirituelle à laquelle les siècles suivants devaient puiser. C'est à lui que se réfèrent aussi bien des grands personnages appartenant au monde des moines comme Pier Damiani, Pierre le Vénérable et Bernard de Clairvaux, qu'également un nombre toujours plus important de "clercs" du clergé séculier, qui au cours du xii et du XIII siècles donnèrent vie à l'une des floraisons les plus belles et les plus fécondes de la pensée humaine.
Né à Mayence vers 780, Raban entra très jeune dans un monastère: on lui ajouta le nom de Maure précisément en référence au jeune Maure qui, selon le Livre ii des Dialogues de saint Grégoire le Grand, avait été confié encore enfant par ses parents eux-mêmes, nobles romains, à l'abbé Benoît de Nursie. Cette insertion précoce de Raban comme "puer oblatus" dans le monde monastique bénédictin, et les fruits qu'il en tira pour sa propre croissance humaine, culturelle et spirituelle, permettraient à eux seuls une ouverture très intéressante non seulement sur la vie des moines et de l'Eglise, mais également sur toute la société de son temps, habituellement qualifiée de "carolingienne". De ceux-ci, ou peut-être de lui-même, Raban Maure écrit: "Certains ont eu la chance d'être introduits dans la connaissance des Ecritures dès leur plus tendre enfance ("a cunabulis suis") et ont été tellement bien nourris par la nourriture qui leur a été offerte par la sainte Eglise qu'ils peuvent être promus, avec l'éducation appropriée, aux ordres sacrés les plus élevés" (PL 107, col 419 BC).
La culture extraordinaire qui caractérisait Raban Maure le fit rapidement remarquer par les grands de son temps. Il devint le conseiller de princes. Il s'engagea pour garantir l'unité de l'empire et, à un niveau culturel plus large, il ne refusa jamais à celui qui l'interrogeait une réponse modérée, qu'il tirait préférablement de la Bible et des textes des saints Pères. Tout d'abord élu abbé du célèbre monastère de Fulda, ensuite archevêque de sa ville natale, Mayence, il ne cessa pas pour autant de poursuivre ses études, démontrant par l'exemple de sa vie que l'on peut être simultanément à la disposition des autres, sans se priver pour cela d'un temps approprié pour la réflexion, l'étude et la méditation. Ainsi, Raban Maure fut exégète, philosophe, poète, pasteur et homme de Dieu. Les diocèses de Fulda, Mayence, Limbourg et Wroclaw le vénèrent comme saint et bienheureux. Ses œuvres remplissent six volumes de la Patrologie latine de Migne. C'est à lui que l'on doit, selon toute probabilité, l'un des hymnes les plus beaux et connus de l'Eglise latine, le "Veni Creator Spiritus", synthèse extraordinaire de pneumatologie chrétienne. Le premier engagement théologique de Raban s'exprima, en effet, sous forme de poésie et eut comme thème le mystère de la Sainte Croix dans une œuvre intitulée "De laudibus Sanctae Crucis", conçue de manière telle qu'elle propose non seulement des contenus conceptuels, mais également des stimulations plus purement artistiques, utilisant aussi bien la forme poétique que la forme picturale à l'intérieur du même codex manuscrit. En proposant iconographiquement, entre les lignes de son écrit, l'image du Christ crucifié, il écrit par exemple: "Voilà l'image du Sauveur qui, par la position de ses membres, rend sainte pour nous la très salubre, très douce et très aimée forme de la Croix, afin qu'en croyant en son nom et en obéissant à ses commandements nous puissions obtenir la vie éternelle grâce à sa Passion. Chaque fois que nous élevons le regard vers la Croix, rappelons-nous donc de celui qui souffrit pour nous, afin de nous arracher au pouvoir des ténèbres, en acceptant la mort pour faire de nous les héritiers de la vie éternelle" (Lib. 1, Fig. 1, PL 107 col 151 C).
Cette méthode d'allier tous les arts, l'esprit, le cœur et les sens, qui provenait de l'orient, devait recevoir un immense développement en occident, en parvenant à des sommets jamais atteints dans les codex enluminés de la Bible, ainsi que dans d'autres œuvres de foi et d'art qui fleurirent en Europe avant l'invention de l'imprimerie et même après. Celle-ci révèle en tous cas chez Raban Maure une conscience extraordinaire de la nécessité de faire participer dans l'expérience de la foi, non seulement l'esprit et le cœur, mais également les sens à travers les autres aspects du goût esthétique et de la sensibilité humaine qui conduisent l'homme à jouir de la vérité de toute leur personne, "esprit, âme et corps". Cela est important: la foi n'est pas seulement pensée, mais elle touche tout notre être. Etant donné que Dieu s'est fait homme en chair et en os, qu'il est entré dans le monde sensible, nous devons, dans toutes les dimensions de notre être, chercher et rencontrer Dieu. Ainsi, la réalité de Dieu, à travers la foi, pénètre dans notre être et le transforme. Pour cela, Raban Maure a concentré son attention en particulier sur la liturgie, comme synthèse de toutes les dimensions de notre perception de la réalité. Cette intuition de Raban Maure le rend extraordinairement actuel. De lui sont restés également célèbres les "Carmina", proposés pour être utilisés en particulier dans les célébrations liturgiques. En effet, étant donné que Raban était avant tout un moine, son intérêt pour la célébration liturgique était évident. Toutefois, il ne se consacrait pas à l'art de la poésie comme une fin en soi, mais il orientait l'art et tout autre type de connaissance vers l'approfondissement de la Parole de Dieu. Il s'efforça donc, avec une assiduité et une rigueur extrêmes, d'introduire ses contemporains, mais surtout les ministres (évêques, prêtres et diacres), à la compréhension de la signification profondément théologique et spirituelle de tous les éléments de la célébration liturgique.
Il tenta ainsi de comprendre et de proposer aux autres les significations théologiques cachées dans les rites, en puisant à la Bible et à la tradition des Pères. Il n'hésitait pas à citer, par souci d'honnêteté mais également pour donner une importance plus grande à ses explications, les sources patristiques auxquelles il devait son savoir. Mais il se servait d'elles avec liberté et un discernement attentif, en approfondissant le développement de la pensée patristique. Par exemple, au terme de l'"Epistola prima", adressée à un "chorévêque" du diocèse de Mayence, après avoir répondu aux demandes d'éclaircissement sur le comportement à adopter dans l'exercice de la responsabilité pastorale, il poursuit: "Nous t'avons écrit tout ceci de la façon dont nous l'avons déduit des Ecritures Saintes et des canons des Pères. Mais toi, très saint homme, prend tes décisions comme bon te semble, au cas par cas, en cherchant à modérer ton jugement de façon à garantir en tout la discrétion, car elle est la mère de toutes les vertus" (Epistulae, i, PL 112, col 1510 C). On voit ainsi la continuité de la foi chrétienne, qui trouve son origine dans la Parole de Dieu; mais celle-ci est toujours vivante, elle se développe et elle s'exprime de façons nouvelles, toujours en cohérence avec toute la construction, avec tout l'édifice de la foi.
Etant donné qu'une partie intégrante de la célébration liturgique est la Parole de Dieu, Raban Maure se consacra à cette dernière avec le plus grand zèle au cours de toute sa vie. Il publia des explications exégétiques appropriées pour presque tous les livres bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament dans une claire intention pastorale, qu'il justifiait par des paroles comme celles-ci: "J'ai écrit ces choses... en résumant les explications et les propositions de beaucoup d'autres pour offrir un service au lecteur dépourvu qui n'a pas à sa disposition de nombreux livres, mais également pour faciliter ceux qui, dans de nombreuses choses, n'arrivent pas à pénétrer en profondeur la compréhension des significations découvertes par les Pères" (Commentariorum in Matthaeum praefatio, PL 107, col 72D). En effet, en commentant les textes bibliques, il puisait à pleines mains aux Pères antiques, avec une prédilection particulière pour Jérôme, Ambroise, Augustin et Grégoire le Grand.
Sa sensibilité pastorale aiguë le conduisit ensuite à s'occuper avant tout de l'un des problèmes vécus de la manière la plus vive par les fidèles et les ministres sacrés de son temps: celui de la pénitence. Il compila en effet les "Pénitenciers" - c'est ainsi qu'on les appelait - dans lesquels, selon la sensibilité de l'époque, étaient énumérés les péchés et les peines correspondantes, en utilisant dans la mesure du possible des motivations puisées dans la Bible, dans les décisions des Conciles et les décrets des Papes. Ces mêmes textes furent utilisés par les "carolingiens" dans leur tentative de réforme de l'Eglise et de la société. C'est à la même intention pastorale que répondaient des œuvres comme "De disciplina ecclesiastica" et "De institutione clericorum" dans lesquelles, en puisant avant tout à saint Augustin, Raban expliquait aux personnes simples et au clergé de son diocèse les éléments fondamentaux de la foi chrétienne: il s'agissait de sortes de petits catéchismes.
Je voudrais conclure la présentation de ce grand "homme d'Eglise" en citant certaines de ses paroles dans lesquelles se reflète bien sa conviction fondamentale: "Celui qui est négligent dans la contemplation ("qui vacare Deo negligit") se prive lui-même de la vision de la lumière de Dieu; celui qui se laisse prendre de façon indiscrète par les préoccupations et permet à ses pensées d'être emportées par le tourbillon des choses terrestres se condamne lui-même à l'impossibilité absolue de pénétrer les secrets du Dieu invisible" (Lib. I, PL 112, col 1263A). Je pense que Raban Maure nous adresse ces paroles également à nous aujourd'hui: dans les heures de travail, avec ses rythmes frénétiques, et dans les temps de loisirs, nous devons réserver des moments à Dieu. Lui ouvrir notre vie en lui adressant une pensée, une réflexion, une brève prière, et surtout, nous ne devons pas oublier le dimanche comme jour du Seigneur, le jour de la liturgie, pour percevoir dans la beauté de nos églises, de la musique sacrée et de la Parole de Dieu la beauté même de Dieu, le laissant entrer dans notre être. Ce n'est qu'ainsi que notre vie peut devenir grande, devenir une vraie vie.