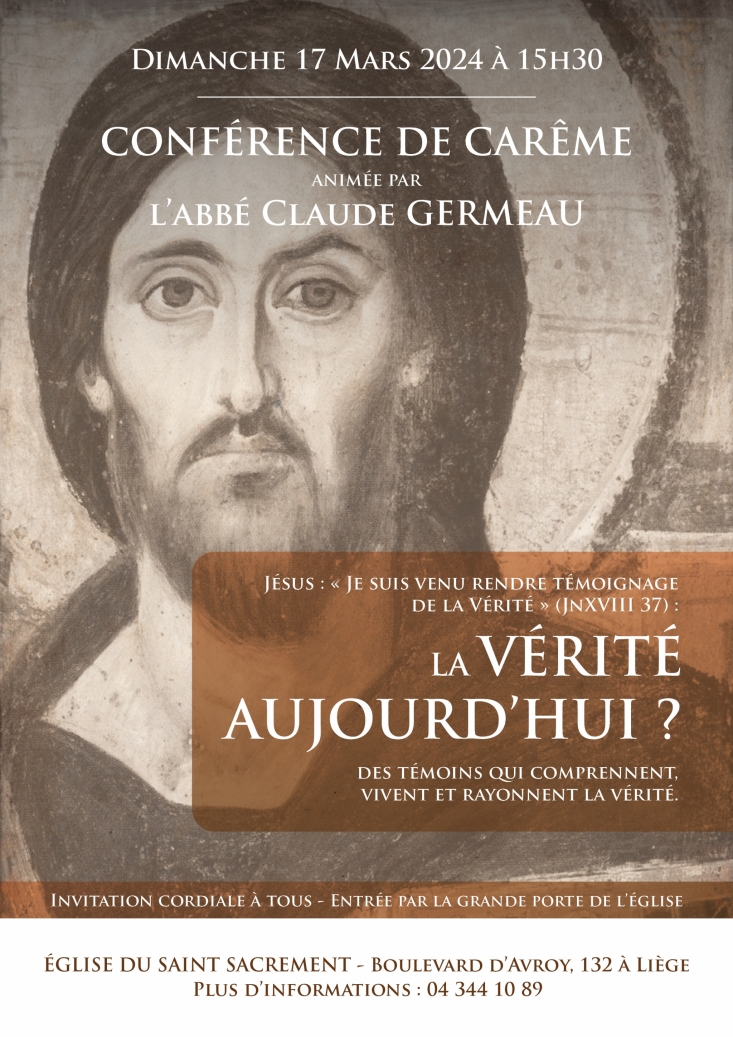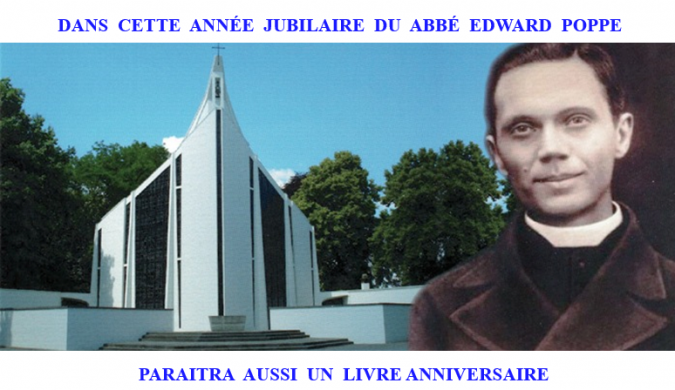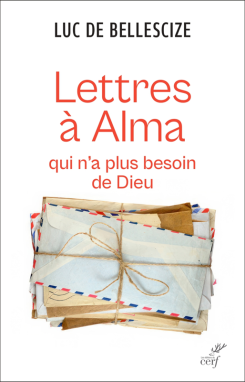DISCOURS DU SAINT-PÈRE FRANCOIS AUX PARTICIPANTS DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE "HOMME-FEMME IMAGE DE DIEU. POUR UNE ANTHROPOLOGIE DES VOCATIONS".
Salle du Synode
Vendredi, 1 mars 2024
Paroles du Saint Père avant le discours
Bonjour ! Je demande qu'on fasse la lecture, pour ne pas être trop fatigué ; j'ai encore un rhume et je suis fatigué en lisant pendant un certain temps. Mais je voudrais souligner une chose : il est très important qu'il y ait cette rencontre, cette rencontre entre les hommes et les femmes, parce qu'aujourd'hui, le danger le plus terrible est l'idéologie du genre, qui annule les différences. J'ai demandé des études sur cette vilaine idéologie de notre temps, qui efface les différences et rend tout identique ; effacer la différence, c'est effacer l'humanité. L'homme et la femme, en revanche, sont dans une "tension" féconde. Je me souviens avoir lu un roman du début des années 1900, écrit par le fils de l'archevêque de Canterbury : Le Maître de la Terre. Ce roman parle de l'avenir et est prophétique, car il montre cette tendance à effacer toutes les différences. Il est intéressant de le lire, si vous en avez le temps, parce qu'on y retrouve les problèmes d'aujourd'hui ; cet homme était un prophète.
Frères et sœurs !
Je suis heureux de participer à cette conférence promue par le Centre de recherche et d'anthropologie des vocations, au cours de laquelle des chercheurs de différentes parties du monde, chacun avec sa propre expertise, discuteront du thème "Image de Dieu de l'homme et de la femme. Vers une anthropologie des vocations". Je salue tous les participants et je remercie le cardinal Ouellet pour ses paroles : nous ne sommes pas encore des saints, mais nous espérons l'être toujours plus, c'est la première vocation que nous avons reçue ! Et merci surtout parce qu'il y a quelques années, avec d'autres personnes influentes et à la recherche d'une alliance des savoirs, vous avez créé ce Centre pour initier une recherche académique internationale visant à toujours mieux comprendre le sens et l'importance des vocations, dans l'Église et dans la société.
L'objectif de cette conférence est avant tout de considérer et de valoriser la dimension anthropologique de toute vocation. Cela nous renvoie à une vérité élémentaire et fondamentale, qu'il nous faut aujourd'hui redécouvrir dans toute sa beauté : la vie de l'être humain est vocation. Ne l'oublions pas : la dimension anthropologique, qui sous-tend tout appel au sein de la communauté, est liée à une caractéristique essentielle de l'être humain en tant que tel : l'homme lui-même est vocation. Chacun de nous, aussi bien dans les grands choix qui affectent un état de vie, que dans les multiples occasions et situations dans lesquelles ils s'incarnent et prennent forme, se découvre et s'exprime comme appelé, comme personne qui se réalise dans l'écoute et la réponse, en partageant son être et ses dons avec les autres pour le bien commun.
Cette découverte nous fait sortir de l'isolement d'un ego autoréférentiel et nous fait nous considérer comme une identité en relation : j'existe et je vis en relation avec celui qui m'a engendré, avec la réalité qui me transcende, avec les autres et avec le monde qui m'entoure, par rapport auquel je suis appelé à embrasser une mission spécifique et personnelle avec joie et responsabilité.
Cette vérité anthropologique est fondamentale car elle répond pleinement au désir d'épanouissement humain et de bonheur qui habite nos cœurs. Dans le contexte culturel actuel, on a parfois tendance à oublier ou à occulter cette réalité, au risque de réduire l'être humain à ses seuls besoins matériels ou primaires, comme s'il s'agissait d'un objet sans conscience ni volonté, simplement entraîné par la vie dans un engrenage mécanique. Au contraire, l'homme et la femme sont créés par Dieu et sont à l'image du Créateur, c'est-à-dire qu'ils portent en eux un désir d'éternité et de bonheur que Dieu lui-même a semé dans leur cœur et qu'ils sont appelés à réaliser à travers une vocation spécifique. C'est pourquoi il existe en nous une saine tension intérieure que nous ne devons jamais étouffer : nous sommes appelés au bonheur, à la plénitude de la vie, à quelque chose de grand auquel Dieu nous a destinés. La vie de chacun de nous, sans exception, n'est pas un accident de parcours ; notre présence dans le monde n'est pas le fruit du hasard, mais nous faisons partie d'un projet d'amour et nous sommes invités à sortir de nous-mêmes et à le réaliser, pour nous-mêmes et pour les autres.
C'est pourquoi, s'il est vrai que chacun de nous a une mission, c'est-à-dire que nous sommes appelés à offrir notre contribution pour améliorer le monde et façonner la société, j'aime toujours rappeler qu'il ne s'agit pas d'une tâche extérieure confiée à notre vie, mais d'une dimension qui implique notre nature même, la structure de notre être d'homme et de femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non seulement nous avons reçu une mission, mais chacun d'entre nous est une mission : "Je suis toujours une mission, tu es toujours une mission, tout baptisé et toute personne baptisée est une mission". Celui qui aime est mis en mouvement, il est poussé hors de lui-même, il est attiré et attirant, il se donne à l'autre et tisse des relations génératrices de vie. Personne n'est inutile et insignifiant pour l'amour de Dieu" (Message pour la Journée mondiale des missions 2019).
Une éminente figure intellectuelle et spirituelle, le cardinal Newman, a des paroles éclairantes à ce sujet. J'en cite quelques-unes :
"Je suis créé pour faire et être quelqu'un pour qui personne d'autre n'est créé.
J'occupe une place qui m'est propre dans les conseils de Dieu, dans le monde de Dieu : une place occupée par personne d'autre. Peu importe que je sois riche ou pauvre, méprisé ou estimé par les hommes : Dieu me connaît et m'appelle par mon nom. Il m'a confié un travail qu'il n'a confié à personne d'autre. J'ai ma propre mission. D'une certaine manière, je suis nécessaire à ses desseins".
Il poursuit : "[Dieu] ne m'a pas créé en vain. Je ferai le bien, j'accomplirai son œuvre. Je serai un ange de paix, un prédicateur de vérité à la place qu'il m'a assignée sans que je le sache, pourvu que je suive ses commandements et que je le serve dans ma vocation" (J.H. Newman, Méditations et prières, Milan 2002, 38-39).
Frères et sœurs, vos recherches, vos études et, de manière particulière, ces occasions de discussion sont si nécessaires et importantes pour faire connaître la vocation à laquelle tout être humain est appelé par Dieu, dans les différents états de vie et grâce à ses nombreux charismes. Ils sont également utiles pour s'interroger sur les défis d'aujourd'hui, sur la crise anthropologique actuelle et sur la nécessaire promotion des vocations humaines et chrétiennes. Et il est important que, grâce aussi à votre contribution, se développe une circularité toujours plus efficace entre les différentes vocations, afin que les œuvres qui découlent de l'état de vie laïque au service de la société et de l'Église, avec le don du ministère ordonné et de la vie consacrée, contribuent à générer l'espérance dans un monde sur lequel pèsent de lourdes expériences de mort.
Générer cette espérance, se mettre au service du Royaume de Dieu pour la construction d'un monde ouvert et fraternel est une tâche confiée à chaque femme et à chaque homme de notre temps. Merci pour votre contribution à cet égard. Merci pour votre travail de ces jours. Je le confie au Seigneur dans la prière, par l'intercession de Marie, icône de la vocation et mère de toute vocation. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi aussi.
Paroles du Saint-Père à la fin du discours
Je vous souhaite à tous un bon travail ! Et n'ayez pas peur en ces moments riches de la vie de l'Église. L'Esprit Saint nous demande une chose importante : la fidélité. Mais la fidélité est en chemin, et la fidélité nous amène souvent à prendre des risques. La fidélité muséale n'est pas la fidélité. Allez de l'avant avec le courage de discerner et de prendre le risque de chercher la volonté de Dieu. Je vous souhaite bonne chance. Courage et allez de l'avant, sans perdre votre sens de l'humour !