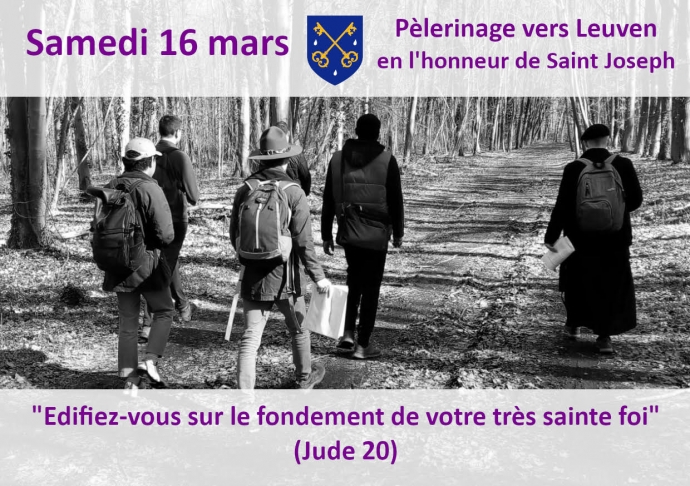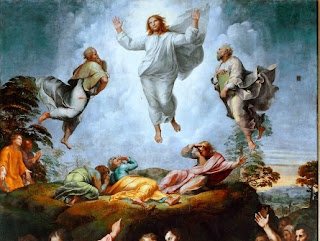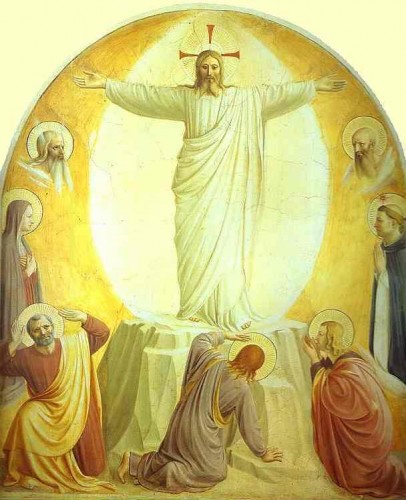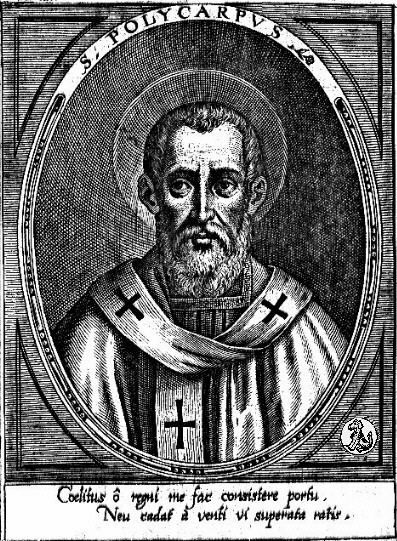De Lukas Matuschek sur kath.net/news :
Absurdité de l'esprit du temps
29 février 2024
"En Jésus, nous rencontrons la vérité elle-même. Nous Le connaissons, Lui et Sa volonté, à travers Sa révélation. Malgré tout, cela déstabilise lorsque, dans les médias et les conversations, la science veut rivaliser avec la vérité éternelle." Contribution d'invité de Lukas Matuschek
Ce n'est pas seulement depuis ces années que l'Eglise est entourée d'erreurs qui masquent la beauté qui l'habite malgré tout, parce qu'elle vient de son époux. Voici une tentative d'aperçu sans prétention d'exhaustivité.
Nous devons nous opposer à ces erreurs et nous rappeler sans cesse la vérité, afin de pouvoir affronter nos combats la tête haute et plus forts. Surtout lorsqu'il s'agit de notre vocation de prophètes, de rois et de prêtres.
Prophétisme
En Jésus, nous rencontrons la vérité elle-même. Nous Le connaissons, Lui et Sa volonté, à travers Sa révélation. Malgré cela, nous sommes déstabilisés lorsque, dans les médias et dans les conversations, la science veut rivaliser avec la vérité éternelle. Pourquoi en effet ? Où se trouvent les sources de la science ? Elles se trouvent dans la recherche, plus précisément dans l'étude de la création de Dieu. La science est un savoir humain et donc limité, donc en partie vrai et en partie entaché d'erreurs. Mais surtout, la science n'est pas un trésor objectif de connaissances, mais chaque thèse est en fin de compte l'opinion d'un individu, sur la base de ses connaissances actuelles limitées.
L'exigence synodale "on devrait prendre en compte l'état actuel de la recherche" signifie donc en dernier lieu qu'on devrait intégrer les opinions individuelles des scientifiques actuellement célébrés (dans la vérité éternelle ? Le depositum fidei ?). Il semble alors prétentieux, voire ridicule. Avec quelle autorité devons-nous le suivre ?
Rien d'autre que l'intelligence artificielle en vogue. Là aussi, il s'agit d'un résultat extrapolé sur la base de données existantes. Ici aussi, la source du savoir est humaine, même si de nombreux ordinateurs font des calculs. Ainsi, chaque résultat reste une opinion individuelle. Cela peut être utile pour les prévisions météorologiques (car facilement vérifiables). Pour les systèmes plus complexes avec des prévisions sur plusieurs années, c'est une boule de cristal plus ou moins bonne. Ce qui est plus important ici que les résultats, ce sont les justifications. Et la phrase "c'est l'état actuel de la science" n'est pas un argument, mais une affirmation sur les opinions individuelles des chercheurs.
La vérité se trouve dans l'Évangile, non pas sur la base d'opinions et de décisions prises à la majorité, mais sur la base de l'autorité de notre Dieu. Soutenir cela est notre droit et notre devoir prophétique.