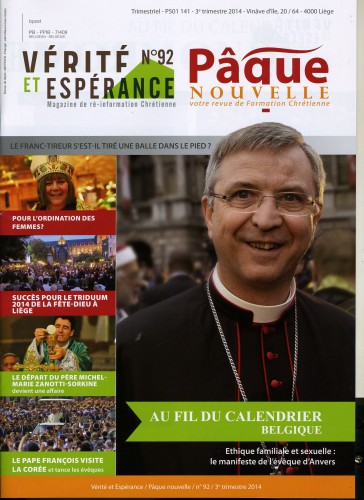Lu sur le site « Chiesa » cette réflexion de Sandro Magister (extrait) :
(…) Jusqu’au milieu du XXe siècle, dans les paroisses catholiques, l’interdiction de communier qui frappait les personnes en situation matrimoniale irrégulière ne posait pas de problèmes, parce qu’elle restait pratiquement invisible. Même dans les endroits où les fidèles se rendaient fréquemment à la messe, en effet, les gens qui communiaient chaque dimanche n’étaient pas nombreux. La communion fréquente n’était pratiquée que par des personnes qui, d’autre part, allaient fréquemment se confesser. On en trouve la preuve dans le double précepte de l’Église à l’usage de la grande masse des fidèles : il fallait se confesser "une fois par an" et communier "au moins à Pâques".
Par conséquent le fait de ne pas pouvoir accéder à la communion n’était pas une marque visible de punition ou de marginalisation. La principale raison qui éloignait de la communion fréquente une grande partie des fidèles était le très grand respect que l’on avait alors pour l'eucharistie, dont on ne devait s’approcher qu’après une préparation adéquate et toujours avec crainte et tremblement.
Tout cela va changer au cours des années du concile Vatican II et de l’après-concile. En résumé, la pratique de la confession s’effondre, tandis que la communion devient un phénomène de masse. Tout le monde, ou presque, communie, tout le temps. Parce que, dans le même temps, il y a un changement dans la perception du sacrement de l’eucharistie par la plupart des gens. La présence réelle du corps et du sang de Jésus dans le pain et le vin consacrés n’est plus qu’une présence symbolique. La communion devient, à l’instar du baiser de paix, un signe d’amitié, de partage, de fraternité, "dans la série : tout le monde fait comme ça, alors moi aussi", pour reprendre une formule du pape Benoît XVI, qui tenta de remettre à l’honneur le sens authentique de l'eucharistie, notamment en demandant que les fidèles à qui il distribuait la communion s’agenouillent pour recevoir l’hostie dans la bouche.
Dans un tel contexte, il était inévitable que l’interdiction de communier soit considérée parmi les divorcés remariés comme revenant à leur refuser publiquement un sacrement auquel tout le monde a "droit". Cette revendication émanait – et émane – d’un petit nombre de personnes, parce que la plupart des divorcés remariés sont éloignés de la pratique religieuse, tandis qu’il ne manque pas, parmi les catholiques pratiquants, de gens qui comprennent et qui respectent la discipline de l’Église. Mais ce tout petit nombre de cas a servi de point d’appui, à partir des années 90 et principalement dans quelques diocèses de langue allemande, à une campagne ayant pour objectif le changement de la discipline de l’Église catholique en matière de mariage, campagne qui a atteint son point culminant sous le pontificat du pape François, avec le consentement manifeste de celui-ci.
D’autre part le fait que le synode se concentre sur la question des divorcés remariés risque de faire perdre de vue des situations de crise concernant le mariage catholique qui impliquent beaucoup plus de gens.
Par exemple, on a pu trouver dans les librairies italiennes, peu de temps avant que le début du synode, un reportage concernant l'action pastorale mise en place dans les périphéries de Buenos Aires par celui qui était alors le cardinal Jorge Mario Bergoglio: P. De Robertis, "Le pecore di Bergoglio. Le periferie di Buenos Aires svelano chi è Francesco", Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2014.
Cet ouvrage explique qu’une large majorité - entre 80 et 85 % - des gens de ces périphéries qui vivent en couple ne sont pas mariés mais qu’ils se contentent de vivre ensemble, tandis que, en ce qui concerne les gens mariés, "les mariages sont en majorité invalides, parce que ceux qui se marient sont immatures", mais ils ne cherchent d’ailleurs même pas à faire établir la nullité de leur mariage par les tribunaux diocésains.
C’est par les "curas villeros", les prêtres qui ont été envoyés dans les périphéries par Bergoglio, que ces indications ont été fournies. Ils précisent avec fierté que, de toute façon, ils donnent la communion à tous ceux qui le souhaitent, "sans élever de barrières".
Les périphéries de Buenos Aires ne constituent pas, en Amérique latine, un cas isolé. Et elles témoignent non pas d’un succès mais, en réalité, d’une absence ou d’un échec de la pastorale du mariage. Sur d’autres continents, le mariage chrétien est aux prises avec des défis qui ne sont pas moins graves et qui vont de la polygamie aux accouplements forcés, des théories du "gender" aux "mariages" homosexuels.
Confrontés à un tel défi, ce synode et celui qui viendra ensuite devront décider si la bonne réponse va consister à frayer un passage au divorce ou bien à restituer au mariage catholique indissoluble toute sa force et toute sa beauté différente, révolutionnaire (…).
Ref. Le vrai dilemme: indissolubilité ou divorce
JPSC