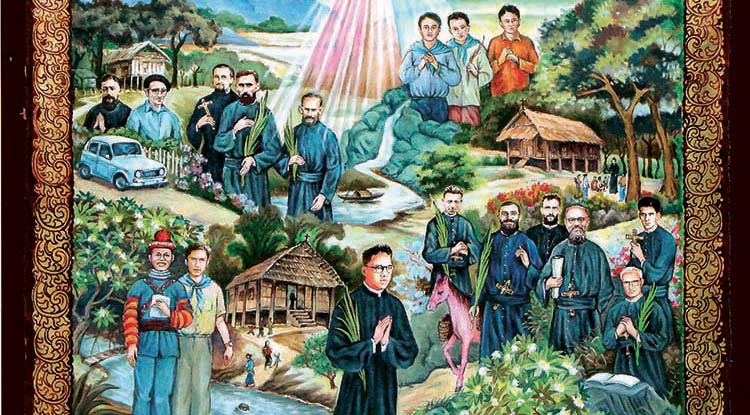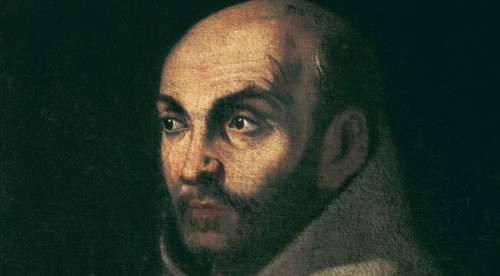De Petra Lorleberg sur kath.net/news :
Le premier sermon du pape Léon pour la fête de Notre-Dame de Guadalupe nous offre un aperçu de son cœur.
13 décembre 2025
« Aide-nous à comprendre que nous sommes les destinataires, mais non les maîtres, de ce message [de l’Évangile], mais, à l’exemple de saint Juan Diego, ses simples serviteurs. » – L’homélie papale remarquable dans son intégralité.
Vatican (kath.net/pl) « Mère du vrai Dieu, par qui nous vivons, venez en aide au Successeur de Pierre, afin qu’il fortifie tous ceux qui lui sont confiés sur l’unique chemin qui conduit au fruit béni de vos entrailles. » Tels furent les mots du pape Léon XVI dans sa première homélie pour la solennité de Notre-Dame de Guadalupe, célébrée en la basilique Saint-Pierre. « Aidez-nous à comprendre que nous sommes destinataires, mais non maîtres, de ce message, mais, à l’exemple de saint Juan Diego, ses simples serviteurs. » Le pape, originaire des États-Unis et ayant exercé son ministère pendant de nombreuses années en Amérique latine comme supérieur d’un ordre religieux et comme évêque, connaît profondément la piété qui entoure les apparitions mariales de Guadalupe.
NOTRE-DAME DE GUADALUPE
HOMÉLIE DU SAINT PÈRE LÉON XIV
Basilique Saint-Pierre, vendredi 12 décembre 2025
Chers frères et sœurs :
Dans le passage du Siracide, nous trouve une description poétique de la Sagesse, image qui trouve sa pleine expression dans le Christ, « la sagesse de Dieu » ( 1 Co 1, 24), qui, lorsque les temps furent accomplis, s’est fait chair, né d’une femme (cf. Ga 4, 4). La tradition chrétienne a également interprété ce passage à la lumière de la figure mariale, car il évoque la femme préparée par Dieu pour recevoir le Christ. En effet, qui d’autre que Marie peut dire : « En moi est toute la grâce du chemin et de la vérité, toute espérance de la vie et de la vertu » ( Sir 24, 25) ? C’est pourquoi la tradition chrétienne n’hésite pas à la reconnaître comme « la mère de l’amour » ( ibid., v. 24).
Dans l’Évangile, nous entendons comment Marie vit la transformation que procure la Parole de Dieu dans sa vie. Telle une flamme ardente et inextinguible, la Parole nous pousse à partager la joie du don reçu (cf. Jr 20, 9 ; Lc 24, 32). Réjouie par l’annonce de l’ange, elle comprend que la joie de Dieu s’accomplit dans la charité et se hâte donc chez Élisabeth.
En vérité, les paroles de la Pleine de Grâce sont « plus douces que le miel » ( Siracide 24, 27). Son seul salut suffit à faire tressaillir de joie l’enfant dans le sein d’Élisabeth, et celle-ci, remplie de l’Esprit Saint, se demande : « Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? » ( Luc 1, 43). Cette joie culmine dans le Magnificat , où Marie reconnaît que son bonheur vient du Dieu fidèle, qui a tourné son regard vers son peuple et l’a béni (cf. Psaume 66, 2) d’un héritage plus doux que le miel en rayon (cf. Siracide 24, 20) : la présence même de son Fils.
Tout au long de sa vie, Marie apporte cette joie là où la joie humaine est insuffisante, là où le vin a manqué (cf. Jn 2, 3). C’est ce qui se produit en Guadalupe. À Tepeyac, elle éveille chez les habitants des Amériques la joie de se savoir aimés de Dieu. Lors des apparitions de 1531, s’adressant à saint Juan Diego dans sa langue maternelle, elle déclare « désirer ardemment » qu’une « petite maison sacrée » y soit construite, d’où elle exaltera Dieu et le fera se manifester (cf. Nican Mopohua , 26-27). Au milieu des conflits, des injustices et des souffrances incessantes qui cherchent un soulagement, Notre-Dame de Guadalupe proclame le cœur de son message : « Ne suis-je pas ici, moi qui suis votre mère ? » ( ibid. , 119). Elle est la voix qui fait résonner la promesse de la fidélité divine, la présence qui soutient quand la vie devient insupportable.
La maternité qu’elle proclame nous fait nous redécouvrir comme des enfants. Quiconque entend « Je suis votre mère » se souvient que, depuis la croix, le « Voici votre mère » correspond à « Voici votre fils » (cf. Jn 19, 26-27). Et comme des enfants, nous nous tournerons vers elle pour lui demander : « Mère, que devons-nous faire pour être les enfants que ton cœur désire ? » Elle, fidèle à sa mission, nous répondra tendrement : « Faites tout ce qu’il vous dira » ( Jn 2, 5). Oui, Mère, nous voulons être tes vrais enfants : dis-nous comment grandir dans la foi quand nos forces nous abandonnent et que les ombres s’étendent. Aide-nous à comprendre qu’avec toi, même l’hiver se pare de roses.
Et en tant que ton enfant, je te le demande : Mère, enseigne aux nations qui aspirent à être tes enfants à ne pas diviser le monde en factions irréconciliables, à ne pas laisser la haine marquer leur histoire, ni les mensonges écrire leur mémoire. Montre-leur que l'autorité doit s'exercer au service des autres, et non par domination. Instruis leurs dirigeants sur leur devoir de préserver la dignité de chaque personne à chaque étape de la vie. Fais de ces nations, tes enfants, des lieux où chacun se sente le bienvenu.
Mère, accompagne les jeunes afin qu'ils reçoivent du Christ la force de choisir le bien et le courage de demeurer fermes dans la foi, même lorsque le monde tente de les détourner de leur chemin. Montre-leur que ton Fils marche à leurs côtés. Que rien ne trouble leur cœur afin qu'ils accueillent sans crainte les projets de Dieu. Préserve-les des menaces du crime, de la dépendance et des dangers d'une vie vaine.
Mère, allez à la rencontre de ceux qui se sont égarés loin de la sainte Église : que votre regard les atteigne là où le nôtre ne peut les atteindre, abattez les murs qui nous séparent et ramenez-les à la maison par la puissance de votre amour. Mère, je vous supplie d’incliner le cœur de ceux qui sèment la discorde vers le désir de votre Fils que « tous soient un » ( Jn 17, 21) et ramenez-les à la charité qui rend la communion possible, car au sein de l’Église, Mère, vos enfants ne peuvent être divisés.
Fortifie les familles : que les parents, à ton exemple, élèvent leurs enfants avec tendresse et fermeté, afin que chaque foyer soit une école de foi. Inspire, Mère, ceux qui forment les esprits et les cœurs, afin qu’ils transmettent la vérité avec la douceur, la précision et la clarté qui jaillissent de l’Évangile. Encourage ceux que ton Fils a appelés à le suivre de plus près : soutiens le clergé et les personnes consacrées dans leur fidélité quotidienne et ravive leur premier amour. Garde leur vie intérieure par la prière, protège-les dans la tentation, encourage-les dans la fatigue et secourt les affligés.
Sainte Vierge, puisse-t-on, comme vous, garder l’Évangile dans nos cœurs (cf. Lc 2, 51). Aide-nous à comprendre que, bien que nous en soyons les destinataires, ce message ne nous appartient pas, mais que, comme saint Juan Diego, nous en sommes les simples serviteurs. Puissions-nous vivre convaincus que partout où la Bonne Nouvelle se répand, tout devient beau, tout est restauré, tout est renouvelé. « Ceux qui te suivent ne pécheront pas » (cf. Sr 24, 22) ; assistez-nous afin que notre péché et notre misère ne ternissent pas la sainteté de l’Église qui, comme vous, est une mère.
Mère du vrai Dieu par qui nous vivons, venez en aide au Successeur de Pierre, afin qu’il confirme tous ceux qui lui sont confiés sur l’unique chemin qui conduit au fruit béni de vos entrailles. Rappelez-le à votre Fils, à qui le Christ a confié les clés du Royaume des Cieux pour le bien de tous, afin que ces clés servent à lier et à délier, et à racheter toute misère humaine ( Saint Jean-Paul II , Homélie à Syracuse , 6 novembre 1994). Et faites que, confiants en votre protection, nous avancions toujours plus unis à Jésus et les uns aux autres vers la demeure éternelle qu’il nous a préparée et où vous nous attendez. Amen.