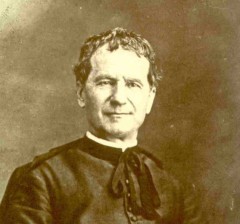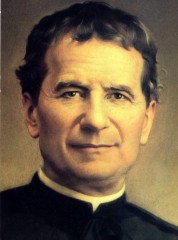La fête du 2 février est, en premier lieu, une fête de Notre Seigneur et, en second lieu, une fête de la Sainte Vierge. Pour bien comprendre cette fête, il faut la situer dans la série des grandes fêtes du cycle de Noël : Noël, l’Épiphanie et la Chandeleur sont les points dominants du cycle d’hiver. Nous pouvons même remarquer une belle progression, tant dans le symbole de la lumière que dans la participation de l’humanité à la manifestation de Dieu. A Noël, la lumière « brille dans les ténèbres » et bien peu nombreux sont ceux qui « la reçoivent » (la Mère de Dieu, les bergers à la Crèche). A l’Épiphanie, la « lumière » rayonne sur Jérusalem (l’Église), « la gloire du Seigneur s’est levée sur Jérusalem » et le monde païen « afflue » des ténèbres vers la ville de lumière. Aujourd’hui, à la Chandeleur, la lumière est dans nos mains, nous la portons en procession et à la messe ; la lumière fait aujourd’hui partie essentielle de la liturgie. Mais, aujourd’hui aussi, l’Église s’avance comme une Épouse au-devant du Seigneur et « reçoit avec amour la miséricorde (faite Homme) dans ses bras » (Intr.).
Un second thème important de cette fête, c’est la lumière. Nous connaissons déjà le haut symbolisme de la lumière. Elle signifie le Christ et la vie divine du Christ en nous. Les paroles du vieillard Siméon : « la lumière qui éclaire les nations » donnent à l’Église l’occasion de célébrer une véritable fête de lumière. (Notre fête fut instituée pour remplacer les Lupercales païennes, fêtes dévergondées qui consistaient dans des processions nocturnes aux flambeaux, c’est pour cette raison que le célébrant et ses ministres portent, à la bénédiction des cierges et à la procession, des ornements violets). L’Église bénit aujourd’hui des cierges pour son usage liturgique, mais elle met aussi des cierges dans les mains des fidèles. Ils doivent faire brûler ces cierges chez eux, dans leurs cérémonies domestiques, au moment de l’orage et du péril, et, spécialement, au moment du Saint-Viatique et de l’Extrême-Onction. L’Église veut nous faire souvenir en même temps de notre cierge de Baptême, signe de notre titre d’enfants de Dieu et du ministère sacerdotal constant des fidèles. Tous les ans, nous recevons de nouveau le cierge du Baptême, afin que nous puissions aller en hâte « avec une lampe allumée » au-devant de l’Époux quand il viendra pour les noces.
Qu’il est beau ce symbolisme de la lumière ! Nous recevons les cierges des mains de l’Église. (Il faudrait que les prêtres de paroisse, conformément aux prescriptions liturgiques, remettent vraiment les cierges aux fidèles). Quel est le sens de ce rite ? L’Église nous donne sans cesse le Christ et la vie divine. Nous portons aujourd’hui, en procession, la lumière allumée, c’est le symbole de la vie chrétienne ; ainsi devons-nous porter le Christ en nous. Avec la lumière dans nos mains, nous rentrons, après la procession, dans l’église ; c’est la maison de Dieu, symbole du ciel. Ainsi marchons-nous avec le Christ à travers la vie en nous dirigeant vers le ciel. Il est particulièrement beau et significatif de voir les fidèles, pendant le chant de l’Évangile et pendant le Canon jusqu’à la Communion, tenir leurs cierges allumés à la main. Quel est le sens de cette cérémonie ? A l’Évangile et au Canon, le Christ est présent parmi nous. C’est pourquoi, à la grand’messe, on porte à ces deux moments les cierges et l’encens. Mais aujourd’hui, l’Église nous dit : il faudrait qu’à chaque messe, vous portiez des cierges à la main ; d’ordinaire, les acolytes vous remplacent, mais aujourd’hui vous remplirez ce ministère du sacerdoce général. Ainsi la messe d’aujourd’hui est une véritable messe de « Chandeleur » presque la seule de l’année.
Extrait de Dom Pius Parsch, le Guide dans l’année liturgique . Ci-dessous, la fête de la Chandeleur à Rome sous Benoît XVI. JPSC