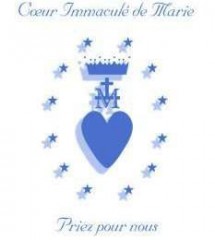Du + Cardinal Caffarra via la NBQ :
Épiphanie du Seigneur
«Comme les Mages, n'éteignons pas le désir de chercher Dieu pour l'adorer»
06_01_2025

A l'occasion de la Solennité de l'Epiphanie de Notre Seigneur Jésus Christ, nous publions une homélie prononcée par le Cardinal Carlo Caffarra en 1996.
***
1. « Quand Jésus est né... des mages sont venus de l'est à Jérusalem» . Ainsi commence aujourd'hui la Parole qui nous révèle le mystère que nous célébrons. En effet, le Pape saint Léon le Grand nous dit: «Nous reconnaissons... dans les sages qui ont adoré le Christ, les prémices de notre vocation et de notre foi, et avec des âmes exultantes nous célébrons les débuts d'une bienheureuse espérance». Oui : aujourd'hui nous célébrons le début, la naissance de notre espérance.
Écoutons encore ce que nous dit l'apôtre en deuxième lecture : « Les païens... sont appelés, en Jésus-Christ, à partager le même héritage, à former un même corps, à participer à la promesse par l'Évangile. " . Et tout cela n’arrive pas par hasard. Il s'agit d'un "mystère", c'est-à-dire d'une décision, d'un projet conçu par Dieu lui-même, "non révélé aux hommes des générations précédentes comme il l'est aujourd'hui". Plan et décision divins qui trouvent leur première manifestation-réalisation dans le fait que "Jésus est né à Bethléem...". Il s'agit du fait que Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». Il ne ferme son cœur à personne puisque « sa miséricorde s'étend de génération en génération ».
Il s'est allié au peuple d'Israël et Israël a droit à l'héritage comme à son fils premier-né, puisque la promesse a été faite à Abraham et à ses descendants. Mais (et c'est précisément le Mystère de Miséricorde que nous célébrons aujourd'hui) nous aussi, chacun de nous aujourd'hui est appelé à posséder le même héritage que nos enfants, nous qui étions morts pour nos fautes et nos péchés. Chacun de nous aujourd’hui est également appelé à participer à la même promesse. De quel droit avions-nous ? De quel droit pourriez-vous vous vanter devant Dieu, de quel titre être appelé « à former un même corps » ? Personne : c'était juste sa miséricorde.
Écoutez la voix de l'Apôtre : «Je dis... que le Christ s'est fait serviteur des circoncis en faveur de la véracité de Dieu, pour accomplir les promesses des pères; mais les nations païennes glorifient Dieu pour sa miséricorde" (Rm 15,8,9a). Autrement dit : Dieu sauve les enfants d'Israël à cause de sa fidélité à une promesse par laquelle il s'est lié à eux ; Dieu nous sauve à cause de sa seule miséricorde, car il n'a contracté aucune obligation de fidélité envers nous. C'est le Mystère qui a commencé aujourd'hui : le Mystère de la miséricorde de Dieu qui offre son salut à chacun, sans aucune discrimination. Il offre son pardon à tous ceux qui le recherchent d'un cœur sincère.
2. «Là où est le roi des Juifs... nous sommes venus l'adorer». Ces paroles des Mages indiquent précisément le désir et la recherche de l'homme. Et en effet, la page de l'Évangile est une merveilleuse description de l'homme qui cherche et trouve le salut de Dieu. Si Dieu nous offre son salut par pure miséricorde, l'homme est appelé à s'ouvrir à ce don, à correspondre à cet Amour. Comme? L'Évangile d'aujourd'hui décrit précisément le chemin de l'homme vers la rencontre avec Dieu lui-même.
Comment commence ce voyage ou cet appel de Dieu au salut ? Dieu appelle par des « signes », la lumière d'une « étoile ». Dans la personne humaine, en chaque personne humaine, il y a une lumière intérieure, une « étoile » qui signifie et indique une Présence, une Réalité qui transcende l'homme : « Seigneur, tu nous as faits pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce que cela ne le fasse pas. repose en Toi." Il y a chez la personne un désir profond et inextinguible de vérité, de bonté, de beauté, en un mot, de béatitude, qu'aucune vérité créée, aucun bien limité, aucune beauté finie ne pourra satisfaire. Tout le bien qu’est l’univers créé est incapable de satisfaire le désir humain. C'est « l'étoile » qui signifie-indique le chemin : « Cherchez au-dessus de nous », nous dit chaque créature.
Les trois mages se mirent en route : ils n'éteignirent pas en eux-mêmes leur désir. L'homme est appelé par son désir de devenir un chercheur de Dieu. Les Mages ont pris la décision de satisfaire leur recherche ; l'homme ne doit pas décapiter, limiter l'extension de son désir selon la mesure des créatures. Et c'est à ce moment-là que l'homme peut croiser Hérode « qui tente de tuer l'Enfant ». Il peut rencontrer de faux enseignants qui tentent d'empêcher l'homme d'atteindre la Présence de Dieu. Qui sont les faux enseignants aujourd'hui ? Ce sont eux qui réduisent Jésus-Christ au grand maître de la solidarité en niant qu’il soit Dieu venu dans la chair à la rencontre de l’homme. Ce sont eux qui réduisent la personne humaine à un ensemble impersonnel de besoins psycho-physiques à satisfaire. Dans cette situation, l'homme ne sait plus où chercher Dieu : il s'est limité à sa mesure infinie ; la présence de Dieu a été expulsée de l'histoire. Les mages peuvent encore continuer leur recherche ; l'homme qui cherche sincèrement la vérité, qui est fidèle à sa conscience ne pourra jamais être tué par notre culture de mort. Dieu lui-même protège toujours ceux qui le cherchent avec humilité.
Où ont-ils trouvé Dieu ? «Ils virent l'enfant avec Marie sa Mère». La présence de Dieu, c'est Jésus-Christ : Il est précisément Dieu fait chair pour pouvoir être trouvé par l'homme. En dehors de Lui, l’homme ne peut chercher Dieu que comme s’il tâtonnait dans l’obscurité. « La grâce de la vérité – écrit saint Jean – se produit par Jésus-Christ » (Jn 1, 17b). La grâce de la vérité, la rencontre avec Dieu est un événement qui se produit dans la vie de l'homme : elle n'est pas d'abord l'apprentissage d'une doctrine ou le résultat d'une ascétisme. C'est la rencontre avec Dieu fait homme.
CONCLUSION
Frères et sœurs, tout ce que j'ai dit, ou plutôt : ce que l'Esprit vous a fait comprendre, n'est que la description de ce qui va se passer maintenant et ici maintenant. La célébration des mystères divins est l'événement de la grâce de la vérité, qui se produit dans notre vie, puisque l'Eucharistie est la rencontre réelle avec le Christ et en Lui avec le Père qui aujourd'hui nous a appelés « dans le Christ Jésus à participer à sa promesse ». ".
 C’est le mardi 6 janvier que tombe la fête de l’Épiphanie. Dans les églises, elle est pourtant célébrée ce dimanche 4 janvier. Trois questions pour mieux pour comprendre.
C’est le mardi 6 janvier que tombe la fête de l’Épiphanie. Dans les églises, elle est pourtant célébrée ce dimanche 4 janvier. Trois questions pour mieux pour comprendre.