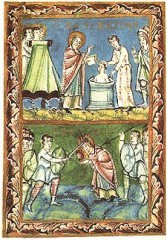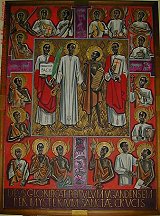De Roberto de Mattei sur Corrispondenza Romana :
Léon XIV : Le mariage n'est pas un idéal, mais le canon du véritable amour entre l'homme et la femme
Le sens de cette phrase ne doit pas être négligé, car aujourd'hui trop souvent la loi morale est réduite à un idéal difficilement atteignable. Le mot « canon », dans le langage religieux, désigne une règle officielle de l'Église, une norme juridique et morale, une loi objective, que tous les chrétiens sont tenus d'observer.
Le mariage, un et indissoluble, formé par un homme et une femme, est une institution divine et naturelle, voulue par Dieu lui-même et élevée par Jésus-Christ à la dignité de sacrement. La famille, fondée sur le mariage, est donc une véritable société dotée d'une unité spirituelle, morale et juridique, dont Dieu a établi la constitution et les droits. Quiconque observe cette loi reçoit de Dieu toutes les grâces nécessaires à son respect.
Présenter le mariage comme un idéal, et non comme une loi à laquelle serait liée une grâce, revient à affirmer que ce modèle n'appartient pas au monde de la réalité, mais à celui des désirs, parfois inaccessibles. C'est donc tomber dans le relativisme moral. Les hommes, pour vivre, ont besoin de principes qui peuvent et doivent être vécus : l'un d'eux est le mariage. L'idée, au contraire, que « le mariage est un idéal » transparaît dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia de 2016, dans laquelle le pape François insiste sur le fait que cet idéal doit être proposé progressivement, en accompagnant les personnes sur leur chemin. Or, la morale catholique n'est pas graduelle et ne souffre aucune exception : elle est absolue ou elle ne l'est pas. La possibilité d'« exceptions » à la loi naît précisément de l'idée d'un idéal impraticable. Telle était la thèse de Luther, qui soutenait que Dieu avait donné à l'homme une loi impossible à suivre. Luther a donc développé le concept de « foi fiduciaire » qui sauve sans œuvres, précisément parce que les commandements ne peuvent être observés. À la conception luthérienne de l'impraticabilité de la loi, le Concile de Trente a répondu que l'on est sauvé par la foi et les œuvres. Le Concile a anathématisé quiconque affirmait que « pour l'homme justifié et constitué en grâce, les commandements de Dieu sont impossibles à observer » (Denz-H, n. 1568) et a affirmé : « Dieu, en effet, ne commande pas l'impossible ; mais lorsqu'il commande, il nous exhorte à faire ce que nous pouvons, à demander ce que nous ne pouvons pas, et il nous aide afin que nous puissions » (Denz.H, n. 1356).
On peut se trouver confronté à des problèmes apparemment insurmontables, mais dans ce cas, il faut tout mettre en œuvre, de toutes ses forces, pour observer la loi naturelle et divine et demander l'aide de Dieu pour surmonter le problème. La foi catholique est que cette aide ne manquera pas et que tout problème sera résolu. Dans des cas exceptionnels, Dieu nous offrira une aide extraordinaire de grâce, précisément parce qu'il ne nous a pas donné une loi impraticable. La doctrine n'est pas un idéal abstrait et la vie d'un chrétien n'est rien d'autre que la pratique des commandements, selon l'enseignement de Jésus : « Celui qui garde mes commandements et les observe, celui-là m'aime » ( Jn 14, 21).
C'est pourquoi, dans une interview de 2019 rapportée par Corrispondenza Romana, le cardinal Burke expliquait : « Quelqu'un a dit qu'en fin de compte, nous devons comprendre que le mariage est un idéal que tout le monde ne peut pas atteindre et que nous devons donc adapter l'enseignement de l'Église aux personnes qui ne sont pas en mesure de respecter leurs vœux de mariage. Mais le mariage n'est pas un « idéal ». Le mariage est une grâce et lorsqu'un couple échange ses vœux, tous deux reçoivent la grâce de vivre un lien fécond et fidèle pour la vie. Même la personne la plus faible, la moins formée, reçoit la grâce de vivre fidèlement l'alliance du mariage » ( ici ).
Mais lisons attentivement les paroles de Léon XIV : « Ces dernières décennies, nous avons reçu un signe qui nous réjouit et nous fait réfléchir : je fais référence au fait que des époux ont été proclamés bienheureux et saints, non pas séparément, mais ensemble, en tant que couples mariés. Je pense à Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ; ainsi qu’aux bienheureux Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, dont la vie familiale s’est déroulée à Rome au siècle dernier. Et n’oublions pas la famille polonaise Ulma : parents et enfants unis dans l’amour et le martyre. Je disais que c’est un signe qui nous fait réfléchir. Oui, en désignant les époux comme des témoins exemplaires, l’Église nous dit que le monde d’aujourd’hui a besoin de l’alliance conjugale pour connaître et accueillir l’amour de Dieu et pour vaincre, par sa force unificatrice et réconciliatrice, les forces qui désintègrent les relations et les sociétés . »
« C'est pourquoi, le cœur rempli de gratitude et d'espérance, je vous dis, chers époux : le mariage n'est pas un idéal, mais le canon du véritable amour entre un homme et une femme : un amour total, fidèle et fécond (cf. saint Paul VI, Encyclique Humanae vitae , n. 9). En vous transformant en une seule chair, ce même amour vous rend capables, à l'image de Dieu, de donner la vie ».
« Je vous encourage donc à être des exemples de cohérence pour vos enfants, en vous comportant comme vous le souhaitez, en les éduquant à la liberté par l'obéissance, en recherchant toujours en eux le bien et les moyens de le développer. Et vous, les enfants, soyez reconnaissants envers vos parents : dire « merci » pour le don de la vie et pour tout ce qu'elle nous donne chaque jour, est la première façon d'honorer votre père et votre mère (cf. Ex 20, 12) . »
Au début et à la fin de son homélie, le Pape est revenu sur un thème qui lui est cher : la prière de Jésus au Père, tirée de l'Évangile de Jean : « Que tous soient un » ( Jn 17, 20). Non pas une uniformité indistincte, mais une communion profonde, fondée sur l'amour de Dieu lui-même ; « uno unum », comme le dit saint Augustin ( Sermo super Ps. 127) : un dans l'unique Sauveur, embrassé par l'amour éternel de Dieu. « Bien-aimés, si nous nous aimons ainsi les uns les autres, sur le fondement du Christ, qui est « l'Alpha et l'Oméga », « le commencement et la fin » (cf. Ap 22, 13), nous serons signe de paix pour tous, dans la société et dans le monde. Et n'oublions pas : l'avenir des peuples se construit dans les familles . »