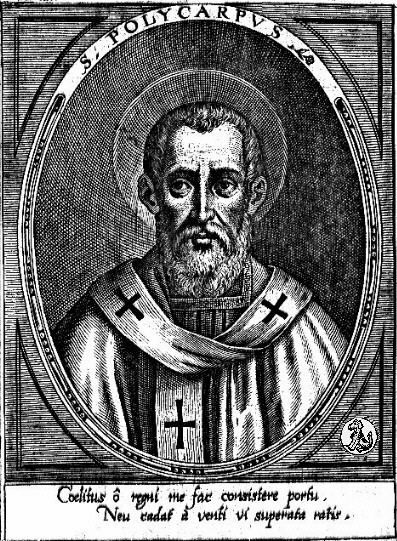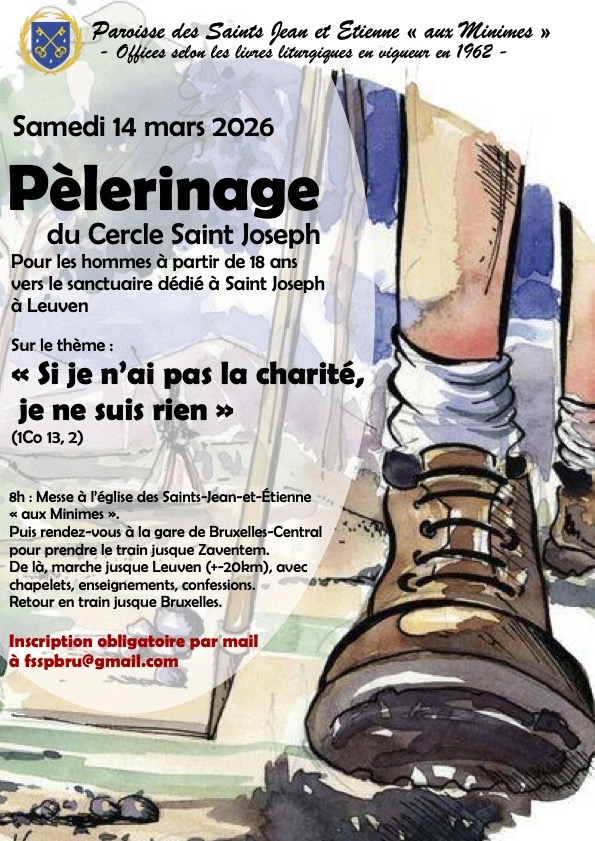Le Cardinal Sarah sur X :
« Aussi je veux dire ma vive inquiétude et ma tristesse profonde en apprenant l'annonce par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, fondée par Mgr Lefebvre, de procéder à des ordinations épiscopales sans mandat pontifical. »
Le texte de la tribune publiée par le Cardinal Sarah sur le Journal du Dimanche est relayé par le site InfoVaticana :
Avant qu'il ne soit trop tard ! L'appel à l'unité du cardinal Robert Sarah
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt 16, 16). Par ces mots, Pierre, interrogé par le Maître sur sa foi en Lui, exprime succinctement l’héritage que l’Église, par la succession apostolique, a sauvegardé, approfondi et transmis pendant deux mille ans : Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c’est-à-dire l’unique Sauveur. « Ces paroles claires du pape Léon XIV sur la foi de Pierre, le lendemain de son élection, résonnent encore en moi. » Le Saint-Père résume ainsi le mystère de la foi que les évêques, successeurs des apôtres, ne doivent jamais cesser de proclamer. Or, où trouver Jésus-Christ, l’unique Rédempteur ? Saint Augustin nous répond clairement : « Là où est l’Église, là est le Christ. » Dès lors, notre souci du salut des âmes se traduit par notre engagement à les conduire à l’unique source, qui est le Christ, qui se donne lui-même dans son Église. Seule l’Église est le chemin ordinaire du salut. C’est donc le seul lieu où la foi est transmise dans son intégralité. C’est le seul lieu où la vie de grâce nous est pleinement donnée par les sacrements. Dans l’Église, il existe un centre, un point de repère incontournable : l’Église de Rome, gouvernée par le Successeur de Pierre, le Pape. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle » (Mt 16, 18).
Abandonner la barque de Pierre, c'est se rendre aux vagues de la tempête.
Je tiens à exprimer ma profonde inquiétude et ma profonde tristesse en apprenant l'annonce de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, fondée par l'archevêque Lefebvre, de procéder aux ordinations épiscopales sans mandat pontifical.
On nous dit que cette décision, qui enfreindrait le droit canonique, est motivée par la loi suprême du salut des âmes : « suprema lex, salus animarum » . Or, le salut est le Christ, et il ne se donne que dans l’Église. Comment peut-on prétendre conduire les âmes au salut par d’autres voies que celles qu’il nous a lui-même montrées ? Chercher le salut des âmes, est-ce déchirer le Corps mystique du Christ d’une manière potentiellement irréversible ? Combien d’âmes risquent d’être perdues à cause de cette nouvelle rupture ?
On nous dit que cet acte vise à défendre la Tradition et la foi. Je sais combien le dépôt de la foi est parfois méprisé aujourd'hui par ceux qui ont pour mission de le défendre. Je sais que certains oublient que seule la chaîne ininterrompue de la vie de l'Église, la proclamation de la foi et la célébration des sacrements, que nous appelons Tradition, nous garantissent que ce que nous croyons est le message originel du Christ transmis par les apôtres. Mais je sais aussi, et je crois fermement, qu'au cœur de la foi catholique se trouve notre mission de suivre le Christ, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Pouvons-nous vraiment nous passer de suivre le Christ dans son humilité jusqu'à la Croix ? N'est-ce pas trahir la Tradition que de se réfugier dans des moyens humains pour maintenir nos œuvres, même si elles sont bonnes ?
Notre foi surnaturelle en l'indéfectibilité de l'Église peut nous amener à dire avec le Christ : « Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort » (Mt 26, 38), lorsque nous constatons la lâcheté de chrétiens, voire de prélats, qui renoncent à l'enseignement du dépôt de la foi et préfèrent leurs opinions personnelles en matière de doctrine et de morale. Mais la foi ne saurait jamais nous conduire à désobéir à l'Église. Sainte Catherine de Sienne, qui n'hésitait pas à exhorter les cardinaux et même le Pape, s'écriait : « Obéissez toujours au pasteur de l'Église, car il est le guide que le Christ a établi pour conduire les âmes à lui. » Le salut des âmes ne saurait jamais se faire au prix d'une désobéissance délibérée, car il est une réalité surnaturelle. Ne réduisons pas le salut à un jeu mondain de pression médiatique.
Qui peut nous assurer que nous sommes véritablement en contact avec la source du salut ? Qui peut garantir que nous ne prenons pas nos propres opinions pour la vérité ? Qui peut nous protéger du subjectivisme ? Qui peut garantir que nous demeurons nourris par l’unique Tradition qui nous vient du Christ ? Qui peut nous assurer que nous n’anticipons pas la Providence et que nous continuons de suivre sa voie ? À ces questions lancinantes, il n’y a qu’une seule réponse, donnée par le Christ aux apôtres : « Celui qui vous écoute m’écoute. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés ; ceux à qui vous ne les pardonnerez pas, ils ne leur seront pas pardonnés » (Lc 10, 16 ; Jn 20, 23). Comment pouvons-nous supporter la responsabilité de nous éloigner de cette unique certitude ?
On nous dit que cela se fait par fidélité au Magistère précédent, mais qui peut le garantir sinon le Successeur de Pierre lui-même ? C’est là une question de foi. « Quiconque désobéit au Pape, représentant du Christ sur terre, ne participera pas au sang du Fils de Dieu », disait aussi sainte Catherine de Sienne. Il ne s’agit pas d’une fidélité terrestre à un homme et à ses idées personnelles. Il ne s’agit pas d’un culte de la personnalité autour du Pape. Il ne s’agit pas d’obéir au Pape lorsqu’il exprime ses propres idées ou opinions. Il s’agit d’obéir au Pape lorsqu’il dit, comme Jésus : « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé » (Jn 7, 16).
Il s'agit d'une perspective surnaturelle sur l'obéissance canonique, qui garantit notre lien avec le Christ lui-même. C'est la seule garantie que notre combat pour la foi, la morale catholique et la Tradition liturgique ne se détournera pas vers l'idéologie. Le Christ ne nous a donné aucun autre signe certain. Abandonner la Barque de Pierre et s'organiser de manière autonome et repliée sur soi revient à se laisser submerger par la tempête.
Je sais pertinemment que souvent, même au sein de l'Église, des loups se déguisent en brebis. Le Christ lui-même ne nous a-t-il pas mis en garde contre cela ? Mais le meilleur rempart contre l'erreur demeure notre lien canonique avec le Successeur de Pierre. « C'est le Christ lui-même qui veut que nous restions unis et que, même blessés par les scandales des mauvais pasteurs, nous n'abandonnions pas l'Église », nous dit saint Augustin. Comment rester insensibles à la prière angoissée de Jésus : « Père, qu'ils soient un comme nous sommes un » (Jn 17, 22) ? Comment continuer à déchirer son Corps sous prétexte de sauver des âmes ? N'est-ce pas lui, Jésus, qui sauve ? Sommes-nous, avec nos institutions, ceux qui sauvent les âmes ? N'est-ce pas par notre unité que le monde croira et sera sauvé ? Cette unité est avant tout celle de la foi catholique ; elle est aussi celle de la charité ; et elle est, enfin, celle de l'obéissance.
Je voudrais rappeler que saint Padre Pio de Pietrelcina fut injustement condamné par les hommes d'Église de son vivant. Dieu lui avait accordé une grâce particulière pour secourir les âmes des pécheurs, mais il lui fut interdit d'entendre les confessions pendant douze ans. Qu'a-t-il fait ? A-t-il désobéi au nom du salut des âmes ? S'est-il rebellé au nom de la fidélité à Dieu ? Non ; il est resté silencieux. Il a embrassé une obéissance rigoureuse, certain que son humilité serait plus fructueuse que sa rébellion. Il a écrit : « Le Dieu bon m'a fait comprendre que l'obéissance est la seule chose qui lui plaise ; c'est pour moi le seul moyen d'espérer le salut et de chanter la victoire. »
Nous pouvons affirmer que le meilleur moyen de défendre la foi, la Tradition et la liturgie authentique sera toujours de suivre le Christ en lui obéissant. Le Christ ne nous commandera jamais de rompre l’unité de l’Église.