De sur le CWR :
Hommage au cardinal Mercier (1851-1926) : thomiste, œcuméniste, mariologue
Philosophe thomiste très respecté qui, en tant que cardinal, résista à l'occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale, il était également connu pour ses efforts œcuméniques et ses pétitions en faveur d'une définition dogmatique de Marie comme Médiatrice de toutes les grâces.

En 1906, Pie X nomma Mercier archevêque de Malines (Malines, en Flandre), en Belgique. Par cette nomination, il devint primat de Belgique et pasteur d'environ 2,3 millions de catholiques et 3 000 prêtres. En termes d'effectifs, l'archidiocèse de Malines était alors le deuxième plus important au monde après celui de Milan.
En 1907, Mercier fut nommé cardinal et rejoignit rapidement Pie X dans sa lutte contre le modernisme catholique. Bien qu'opposé aux modernistes, il restait ouvert au dialogue avec des penseurs accusés de modernisme, tels que Maurice Blondel et Marie-Joseph Lagrange, OP. Il prit également contact avec le prêtre jésuite moderniste et suspendu, George Tyrrell. Mercier invita Tyrrell dans son archidiocèse à condition qu'il accepte de soumettre tous ses écrits à son examen et à son approbation. Tyrrell rejeta cette condition et critiqua le cardinal belge, le qualifiant de représentant d'une conception « ultramontaine » dépassée qui étouffait le débat théologique.
Durant la Première Guerre mondiale, Mercier résista à l'occupation allemande de la Belgique et fut finalement assigné à résidence. Sa lettre pastorale de Noël 1914, Patriotisme et Endurance, fut accueillie avec enthousiasme non seulement en Belgique, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, en France et dans d'autres pays. Les évêques allemands, mécontents, accusèrent Mercier de violer la position de neutralité du Vatican. Benoît XV, cependant, admirait Mercier et soutint la libération de la Belgique comme condition à la paix. Après la guerre, Mercier reçut de nombreuses distinctions pour sa résistance héroïque à l'occupation allemande. Considéré comme le « pape du Nord », il accepta des invitations à donner des conférences en France, en Espagne, en Autriche, en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Il reçut des doctorats honoris causa, notamment de Harvard, de Princeton et de Yale, et participa au défilé de la victoire de 1919 à New York aux côtés du roi Albert de Belgique.
Mercier est également resté dans les mémoires pour son soutien aux discussions œcuméniques avec les anglicans, connues sous le nom de Conversations de Malines. Soutenues par Lord Halifax d'Angleterre, ces discussions théologiques se déroulèrent à la résidence du cardinal Mercier entre 1921 et 1925. Bien que ces échanges se soient déroulés dans un climat amical, aucun accord ne put être trouvé sur la signification de la primauté papale ni sur d'autres questions. Le pape Benoît XV (r. 1914-1922) était au courant des Conversations de Malines. Il ne les critiqua jamais, mais ne les approuva jamais non plus. Pie XI (r. 1922-1939) était également informé de ces discussions œcuméniques. Admiratif pour Mercier, il attendit la mort du cardinal en 1926 pour y mettre un terme. Dans son encyclique de 1928, Mortalium Animos, Pie XI réaffirma la conception catholique de la primauté papale et mit en garde contre les discussions œcuméniques susceptibles de relativiser la doctrine catholique.
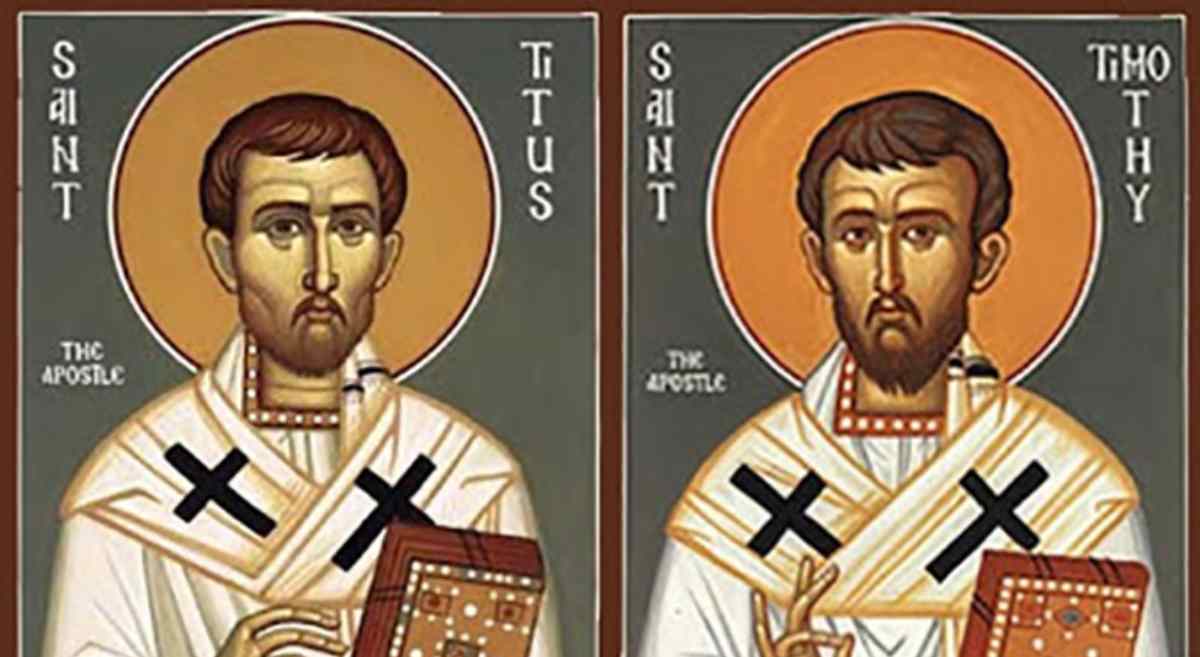

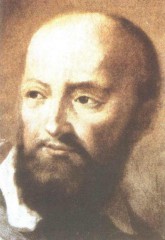
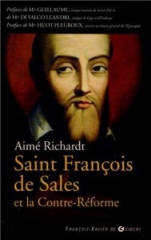 "Saint François de Sales et la Contre-Réforme" d'Aimé Richardt
"Saint François de Sales et la Contre-Réforme" d'Aimé Richardt