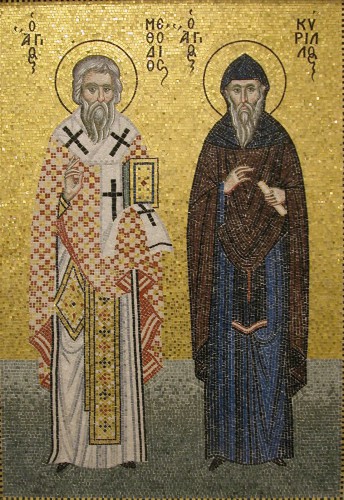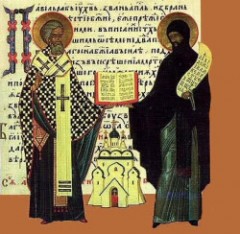J’ai le plaisir de vous adresser cette lettre à l’occasion de votre assemblée presbytérale, et je le fais avec un désir sincère de fraternité et d’unité. Je remercie votre archevêque et, du fond du cœur, chacun d’entre vous, pour votre volonté de vous réunir en presbyterium, non seulement pour discuter de questions communes, mais aussi pour vous soutenir mutuellement dans la mission que vous partagez.
J’apprécie l’engagement avec lequel vous vivez et exercez votre sacerdoce dans les paroisses, les ministères et les réalités diverses. Je sais que ce ministère se déploie souvent dans la fatigue, face à des situations complexes, et dans un dévouement silencieux dont seul Dieu est témoin. C’est précisément pour cette raison que j’espère que ces mots vous parviennent comme un geste de proximité et d’encouragement, et que cette rencontre favorise un climat d’écoute sincère, de communion véritable et d’ouverture confiante à l’action de l’Esprit Saint, qui ne cesse d’œuvrer dans votre vie et votre mission.
L’époque que traverse l’Église nous invite à un temps de recueillement et de réflexion sincère. Non pas tant pour nous attarder sur les diagnostics immédiats ou les mesures d’urgence, mais pour apprendre à comprendre profondément le moment présent, en reconnaissant, à la lumière de la foi, les défis et les possibilités que le Seigneur nous offre. Sur ce chemin, il devient de plus en plus nécessaire de cultiver notre vision et d’exercer notre discernement, afin de percevoir plus clairement ce que Dieu accomplit déjà, souvent silencieusement et discrètement, parmi nous et dans nos communautés.
Cette lecture du présent ne saurait ignorer le cadre culturel et social dans lequel la foi est vécue et exprimée aujourd'hui. Dans de nombreux milieux, on observe une sécularisation avancée, une polarisation croissante du discours public et une tendance à simplifier à l'extrême la complexité de la personne humaine, en l'interprétant à travers des idéologies ou des catégories partielles et insuffisantes. Dans ce contexte, la foi risque d'être instrumentalisée, banalisée ou reléguée au rang d'accessoire, tandis que des formes de coexistence qui s'affranchissent de toute référence transcendante se consolident.
À cela s'ajoute un profond bouleversement culturel qu'il est impossible d'ignorer : la disparition progressive des repères communs. Longtemps, la semence chrétienne a trouvé un terrain largement fertile, car le langage moral, les grandes questions sur le sens de la vie et certaines notions fondamentales étaient, au moins en partie, partagés. Aujourd'hui, ce terrain d'entente s'est considérablement affaibli. Nombre des présupposés conceptuels qui, pendant des siècles, ont facilité la transmission du message chrétien ne sont plus évidents et, dans bien des cas, même compréhensibles. L'Évangile se heurte non seulement à l'indifférence, mais aussi à un paysage culturel différent, où les mots n'ont plus la même signification et où la proclamation initiale ne va plus de soi.
Cependant, cette description ne rend pas pleinement compte de la réalité. J'en suis convaincu – et je sais que nombre d'entre vous le perçoivent dans l'exercice quotidien de votre ministère – qu'un malaise nouveau s'installe dans le cœur de beaucoup, surtout chez les jeunes. La quête absolue du bien-être n'a pas apporté le bonheur escompté ; la liberté déconnectée de la vérité n'a pas engendré l'épanouissement promis ; et le progrès matériel, à lui seul, n'a pas su combler l'aspiration la plus profonde du cœur humain.
En effet, les propositions dominantes, ainsi que certaines interprétations herméneutiques et philosophiques du destin de l’humanité, loin d’apporter une réponse satisfaisante, ont souvent engendré un profond sentiment de lassitude et de vide. C’est précisément pour cette raison que l’on observe que beaucoup s’ouvrent à une recherche plus sincère et authentique, une recherche qui, empreinte de patience et de respect, les ramène à la rencontre du Christ. Cela nous rappelle que, pour le prêtre, ce n’est pas un temps de retrait ni de résignation, mais de présence fidèle et de disponibilité généreuse. Tout cela découle de la reconnaissance que l’initiative appartient toujours au Seigneur, qui est déjà à l’œuvre et nous précède par sa grâce.
Voilà comment se précise aujourd’hui le type de prêtres dont Madrid – et toute l’Église – a besoin en ce temps-ci. Non pas des hommes définis par une multitude de tâches ou la pression des résultats, mais des hommes configurés au Christ, capables de nourrir leur ministère d’une relation vivante avec Lui, nourris par l’Eucharistie et exprimés dans une charité pastorale marquée par le don sincère de soi. Il ne s’agit pas d’inventer de nouveaux modèles ni de redéfinir l’identité reçue, mais de proposer à nouveau, avec une ferveur renouvelée, le sacerdoce dans son essence la plus authentique – être alter Christus – en Le laissant façonner nos vies, unifier nos cœurs et donner forme à un ministère vécu dans l’intimité avec Dieu, la fidélité à l’Église et le service concret du peuple qui nous est confié.
Mes chers fils, permettez-moi aujourd'hui de vous parler du sacerdoce à travers une image qui vous est familière : votre cathédrale. Non pas pour décrire un édifice, mais pour en tirer un enseignement. Car les cathédrales, comme tout lieu sacré, existent, à l'instar du sacerdoce, pour nous conduire à la rencontre de Dieu et à la réconciliation avec nos frères et sœurs, et leurs éléments recèlent une leçon pour notre vie et notre ministère.
En observant simplement sa façade, nous apprenons l'essentiel. C'est la première chose que nous voyons, et pourtant elle ne dit pas tout : elle indique, suggère, invite. De même, le prêtre ne vit pas pour se mettre en valeur, mais il ne vit pas non plus pour se cacher. Sa vie est appelée à être visible, cohérente et reconnaissable, même si elle n'est pas toujours comprise. La façade n'existe pas pour elle-même : elle conduit à l'intérieur. De même, le prêtre n'est jamais une fin en soi. Toute sa vie est appelée à témoigner de Dieu et à accompagner le chemin vers le Mystère, sans usurper la place de Dieu.
Une fois le seuil franchi, nous comprenons que tout ne saurait y entrer, car il s’agit d’un espace sacré. Le seuil marque un passage, une séparation nécessaire. Avant d’entrer, quelque chose demeure à l’extérieur. Le sacerdoce, lui aussi, se vit ainsi : être dans le monde, mais non du monde (cf. Jn 17, 14). À ce carrefour se trouvent le célibat, la pauvreté et l’obéissance ; non comme un renoncement à la vie, mais comme les moyens concrets par lesquels le prêtre peut appartenir pleinement à Dieu tout en cheminant parmi les hommes.
La cathédrale est aussi une maison commune, où chacun a sa place. C’est ainsi que l’Église est appelée à être, particulièrement envers ses prêtres : une maison qui accueille, protège et n’abandonne jamais. Et c’est ainsi que doit se vivre la fraternité sacerdotale : comme l’expérience concrète de se sentir chez soi, responsable les uns des autres, attentif à la vie de ses frères et sœurs, et prêt à s’entraider. Mes fils, nul ne doit se sentir exposé ou seul dans l’exercice du ministère : résistez ensemble à l’individualisme qui appauvrit le cœur et affaiblit la mission !
En parcourant le temple, nous constatons que tout repose sur les colonnes qui soutiennent l’ensemble. L’Église y a reconnu l’image des Apôtres (cf. Éph 2, 20). De même, la vie sacerdotale ne se suffit pas à elle-même, mais s’appuie sur le témoignage apostolique reçu et transmis dans la Tradition vivante de l’Église, et préservé par le Magistère (cf. 1 Co 11, 2 ; 2 Tm 1, 13-14). Lorsque le prêtre demeure enraciné sur ce fondement, il évite de bâtir sur le sable des interprétations partielles ou des accents circonstanciels, et s’appuie plutôt sur le roc solide qui le précède et le surpasse (cf. Mt 7, 24-27).
Avant d'atteindre le sanctuaire, la cathédrale nous révèle des lieux discrets mais essentiels : aux fonts baptismaux, le Peuple de Dieu naît ; au confessionnal, il se renouvelle sans cesse. Dans les sacrements, la grâce se révèle comme la force la plus réelle et la plus efficace du ministère sacerdotal. Aussi, chers fils, célébrez-vous les sacrements avec dignité et foi, conscients que ce qui s'y produit est la véritable puissance qui édifie l'Église et qu'ils sont la fin ultime vers laquelle tend tout notre ministère. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas la source, mais le canal, et que vous aussi avez besoin de vous abreuver à cette eau. Aussi, ne négligez-vous pas la confession, en revenant toujours à la miséricorde que vous proclamez.
Plusieurs chapelles s'ouvrent autour de l'espace central. Chacune a sa propre histoire et sa propre dédicace. Bien que différentes par leur style et leur composition, elles partagent toutes la même orientation : aucune n'est repliée sur elle-même, aucune ne perturbe l'harmonie de l'ensemble. Il en va de même dans l'Église, avec les divers charismes et spiritualités par lesquels le Seigneur enrichit et soutient votre vocation. Chacune reçoit une manière particulière d'exprimer sa foi et de nourrir sa vie intérieure, mais toutes restent orientées vers le même centre.
Mes chers fils, regardons au cœur de tout cela : c’est là que se révèle ce qui donne sens à vos actions quotidiennes et d’où jaillit votre ministère. Sur l’autel, par vos mains, le sacrifice du Christ est rendu présent dans l’acte le plus sacré confié à l’homme ; dans le tabernacle, Celui que vous avez offert demeure, de nouveau confié à votre garde. Soyez des adorateurs, des personnes ferventes dans la prière, et enseignez à votre peuple à faire de même.
Au terme de ce cheminement, afin que vous soyez les prêtres dont l’Église a besoin aujourd’hui, je vous confie le même conseil que votre saint compatriote, saint Jean d’Avila : « Soyez tout à lui » ( Sermon 57). Soyez saints ! Je vous confie à Notre-Dame d’Almudena et, le cœur plein de gratitude, je vous accorde la Bénédiction apostolique, que j’étends à tous ceux qui sont confiés à votre charge pastorale.
Cité du Vatican, 28 janvier 2026. Mémoire de saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église.
LEÓN PP. XIV