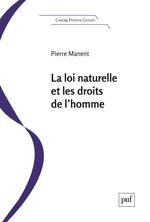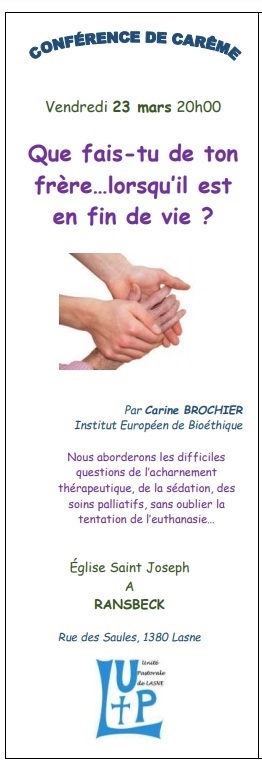D'Austin Ruse sur C-Fam :
Des organismes de défense des Droits de l’Homme remercient les États-Unis de faire reculer l’avortement dans le rapport à paraître
WASHINGTON DC, 9 mars (C-Fam) Une coalition de 197 groupes du monde entier ont envoyé une lettre au Secrétaire d’État américain Rex Tillerson pour le remercier des modifications attendues dans le rapport annuel du Département d’État sur les droits de l’homme.
La lettre remercie Tillerson « … de soutenir une compréhension correcte des droits de l’homme internationalement reconnus dans le prochain Rapport annuel du Département d’État. En rejetant les tentatives visant à inclure l’avortement et d’autres questions qui font l’objet de querelles et qui ne font pas l’objet d’un accord universel sur les droits de l’homme, vous remettez les États-Unis dans leur rôle de direction dans la promotion du droit à la vie et de protection de la famille. »
La lettre « … accueille avec joie la nouvelle donnée par la porte-parole Heather Nauert selon laquelle le Département d’État n’essaiera plus de diluer le sérieux des droits de l’homme et “va focaliser le rapport sur les abus concernant les droits de l’homme internationalement reconnus et les problèmes les plus importants”. »
Ces dernières années, sous le gouvernement Obama, le rapport est devenu un fourre-tout de questions qui ne sont pas considérées comme des droits de l’homme mais comme des affaires importantes pour la gauche politique, tout particulièrement l’avortement, ainsi que des éléments LGBT.
Le rapport vise à mettre en lumière les abus et les problèmes relatifs aux droits de l’homme dans le monde. Selon la manière traditionnelle de les comprendre, les droits de l’homme sont ceux que l’on trouve dans les documents approuvés qui en traitent, comme la Déclaration des Droits de l’Homme, c’est-à-dire les droits de vote, de réunion, la liberté religieuse, d’auto-détermination politique, etc.
Depuis que la gauche politique s’est installée aux Nations-Unies, il y a plusieurs décennies, des tentatives ont été faites pour réinterpréter les documents sur les droits de l’homme. Ces efforts, pour faire que l’avortement devienne un droit de l’homme et inclure des protections spéciales fondées sur les pratiques sexuelles, ont toujours échoué à l’ONU. Mais cela n’a pas empêché les gouvernements de gauche de les exporter au travers de rapports comme celui que l’on attend ces jours-ci du Département d’État américain.
Dans les semaines passées, les membres de la gauche de l’administration du Département d’État américain ont laissé fuiter les modifications imminentes par la publication en ligne Politicoqui a publié consciencieusement deux articles dont pas un ne présentait les façons de voir des communautés des droits de l’homme pro-vie et pro-famille. Les groupes en faveur de l’avortement ont également envoyé des doléances au Secrétaire d’État Tillerson par une lettre de groupe.
La lettre des groupes pro-vie remarque que les entités des droits de l’homme des Nations Unies ont fait pression sur 154 pays 479 fois pour libéraliser leurs lois sur l’avortement fondées sur leurs manières personnelles de voir les traités des droits de l’homme. Ils soulignent que les États-Unis vont lancer un signal fort que ceci est inacceptable et que les États-Unis adhèrent à une manière correcte de comprendre les droits de l’homme.
Un porte-parole du Département d’État a dit au Friday Fax que la lettre provient « [d’]un groupe impressionnant » et « [qu’]elle aide nos efforts pour aligner le rapport sur l’intention légale. » Le porte-parole faisait allusion à la tendance de certains fonctionnaires de la branche exécutive de développer l’intention du Congrès lorsque de tels rapports sont demandés. Il n’a jamais été dans l’intention du Congrès que le rapport sur les droits de l’homme critique, par exemple, l’Église catholique de certains pays dans lesquels elle s’oppose au mariage homosexuel.
Les défenseurs des droits de l’homme affirment que les tentatives d’étendre les droits de l’homme en y incluant largement des sujets controversés tels que l’avortement et les questions LGBT, ont tendance à diluer les droits de l’homme existants. Si tout est droit de l’homme, alors plus rien ne l’est.


 « Ces dernières semaines, de nombreux observateurs sont restés perplexes, voire profondément troublés, devant
« Ces dernières semaines, de nombreux observateurs sont restés perplexes, voire profondément troublés, devant