Une opinion de Jacques Meurice, prêtre ouvrier en retraite, publiée par « La Libre Belgique ». Selon lui, le pape François veut ouvrir l’Eglise mais, pour en faire une démocratie, cela ne suffit pas. Il faudrait inventer des syndicats, y créer des partis, y favoriser une liberté d’options et de parole. Peu de chances :
« Eh oui ! les religions sont comme les êtres humains, elles naissent un jour, elles vivent, grandissent, prospèrent, puis elles sont malades et un jour aussi elles meurent et disparaissent. Leur vie est seulement habituellement plus longue que celle des hommes, elle se compte en siècles plutôt qu’en années, à tel point que beaucoup d’adeptes et de fervents adhérents ont souvent été persuadés de leur immortalité. Au cours de son histoire, l’humanité a cependant connu bien des exemples de mort de religions. A Babylone on en a déjà fait l’expérience, puis les religions des Hittites, des Egyptiens, des Grecs, des Celtes, des Etrusques, des Romains, toutes y ont passé. Certaines ont vécu plus de trois mille ans, mais la moyenne se situe plutôt vers les deux millénaires. Il y a quelques exceptions comme pour confirmer la règle : le judaïsme en est une, le bouddhisme aussi, mais le bouddhisme est-il vraiment une religion ?
Trois siècles de retard
Pourquoi la religion catholique échapperait-elle à ce qui paraît être une loi universelle ? Le cardinal Martini, jadis archevêque de Milan et père du Concile Vatican II, a parfois dit que l’Eglise catholique avait dans la société un retard de deux siècles au moins. Maintenant il faudrait bien lui en reconnaître trois. Quand les peuples ou les nations ont à surmonter des obstacles importants comme des guerres, des invasions, des migrations obligées, il n’y a qu’une seule règle et chance de survie, c’est l’adaptation. S’adapter aux changements c’est sauver sa vie. C’est, semble-t-il, ce que l’Eglise catholique n’a pas su ou pu ou voulu faire, depuis quelques siècles.
Elle n’a pas accepté les grandes révolutions, ni en France, ni en Italie, ni en Russie, ni en Espagne, et les petites seulement où et quand cela l’arrangeait. Elle n’a jamais été pour le progrès par les lumières ou par la science. Prisonnière de ses dogmes et d’une morale dite naturelle, elle n’a pu accepter spontanément Darwin et l’évolution, Voltaire et le goût des libertés, Marx et le socialisme, Einstein et la relativité, Gandhi et l’autonomie des peuples dans la paix, pour n’en citer que quelques-uns.
Elle a toujours refusé d’envisager le droit au divorce, à l’avortement, à l’homosexualité, à la pilule contraceptive, à la procréation médicalement assistée, au mariage pour tous, au suicide, à l’euthanasie. Elle s’oppose avec obstination à l’ordination des femmes, au mariage des prêtres, à la franc-maçonnerie et à la liberté de pensée. Bref, elle a multiplié à l’infini les blocages et les refus.
Tant de questions sans réponses
Pourquoi la fréquentation des églises a-t-elle baissé de façon aussi catastrophique depuis la dernière guerre mondiale ? Pourquoi les sacrements ne font-ils plus partie des signes sensibles de la vie pour beaucoup ? Pourquoi les vocations sacerdotales et religieuses sont-elles devenues si rares, alors que les ONG continuent à recruter parmi les jeunes ? Tant de questions qui sont restées sans réponse, qui bien souvent n’ont même pas été posées, car il y a une sorte de silence orgueilleux de sa hiérarchie qui s’est appesanti sur les difficultés de l’Eglise.
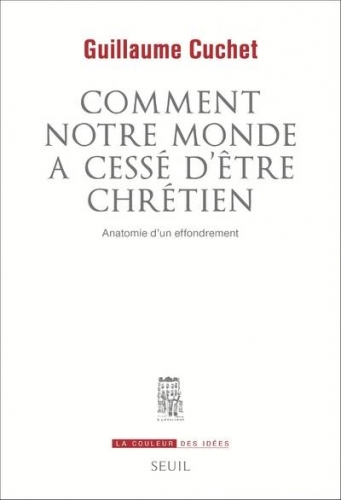 D'Isabelle de Gaulmyn
D'Isabelle de Gaulmyn 