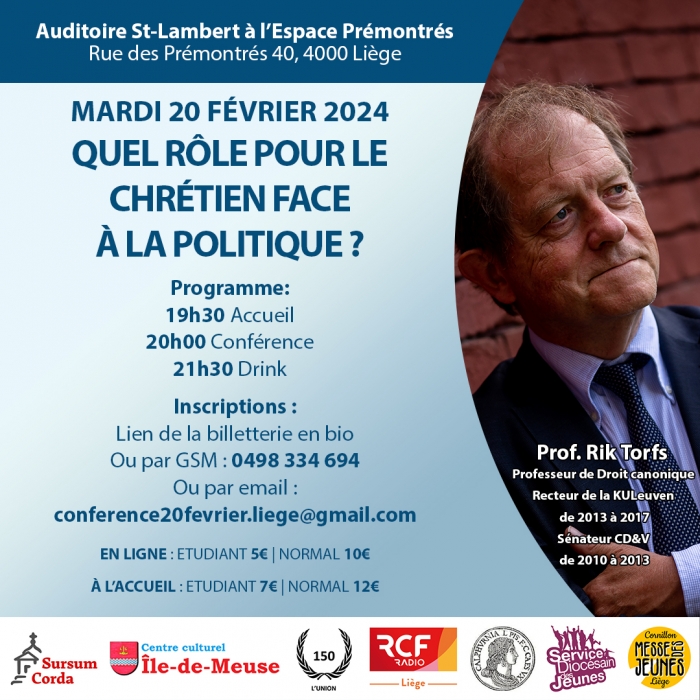(S.M.) L’auteur de cette analyse éclairante et très actuelle de la situation réelle de l’Église catholique en Chine est Gianni Criveller, 63 ans, de l’Institut pontifical pour les missions étrangères, sinologue et théologien, président depuis sept années du séminaire théologique international du P.I.M.E affilié à l’Université pontificale urbanienne de Rome et, depuis septembre dernier, directeur de l’agence « Asia News » de ce même institut, mais qui a surtout été missionnaire en Chine pendant des décennies, en plus d’être l’auteur de nombreuses études sur l’histoire de la Chine dans ce grand pays, professeur invité à Hong Kong, Pékin et dans d’autres universités et traducteur chevronné aussi bien du mandarin que du cantonais. Cette note a été publiée le 12 février dans « Asia News » en italien, en anglais, en espagnol et en chinois. À lire à tout prix.
*
Pékin et le Saint-Siège : des signaux positifs, mais un silence de plomb
de Gianni Criveller
J’écris ce billet pendant que l’on fête le nouvel-an chinois, une fête chère à tous les Chinois, au pays comme à l’étranger. C’est l’année du dragon, qui parmi les douze animaux de l’horoscope est le plus fort et le plus aimé : on dit que beaucoup de Chinoises rêvent d’avoir un enfant au cours de cette année qui est considérée comme la plus propice.
La fête de ce jour me remet en mémoire le souvenir de la foi catholique en Chine, le thème fondamental de ma vie consacrée à la mission. L’année 2024 devrait être, pour autant qu’on le sache, une année décisive pour le dialogue entre la Chine et le Saint-Siège : l’accord de 2018, renouvelé à deux reprises, devra être ratifié de manière permanente ou bien abandonné.
Ces derniers jours, deux actualités ont été accueillies – à juste titre – de manière positive par les observateurs : trois nouveaux évêques ont été ordonnés (sur la photo le dernier, celui de Shaowu), avec l’accord des deux parties, conformément à l’accord.
L’année 2023 avait été une « annus horribilis » pour le Saint-Siège, après le scandale du transfert à Shanghai de l’évêque Shen Bin. Il s‘agissait du deuxième acte unilatéral de la Chine, qui avait tenu le Saint-Siège à l’écart de toute consultation. Le Vatican avait protesté, avant de finir par accepter le fait accompli, tout en demandant que la situation ne se reproduise pas.
Les trois dernières ordinations concertées, accompagnées de la reconnaissance par le Saint-Siège d’un nouveau diocèse (Weifang, dans la province de Shandong, dont les frontières ont été redessinées par les autorités chinoises) ont donné l’impression qu’il y ait, dans le chef de la Chine, la volonté de ne pas rompre avec Rome et de ratifier l’accord de manière permanente.
Mais il faut rappeler que ces bonnes nouvelles doivent être remises dans leur contexte. S’il est vrai que le pape nomme les évêques, ces derniers ne sont pas choisis par lui mais via un processus autonome dirigé par les autorités chinoises, et dont les détails ne sont pas connus, étant donné que le texte de l’accord demeure secret.
Ceux qui ont été élus en Chine sont donc bien des évêques catholiques, mais qui sont dans le même temps approuvés par le régime. En outre, il est bon de souligner qu’en aucune manière, en Chine, ni le pape ni le Saint-Siège ni l’accord n’ont été mentionnés à l’annonce de ces nominations. Je crains que la nomination par le pape ne soit pas davantage mise en avant au cours de la liturgie d’ordination elle-même. Cela fait d’ailleurs belle lurette que les célébrations des consécrations épiscopales ne sont plus accessibles aux observateurs extérieurs.
Le double registre – d’une part des nominations qui semblent renforcer l’accord ; d’autre part le silence sur le rôle de Rome – saute encore plus aux yeux en lisant le « Plan quinquennal pour la sinisation du catholicisme en Chine (2023-2027) ».
Ce « Plan », très détaillé et articulé en trois parties et 33 paragraphes, a été approuvé le 14 décembre 2023 par l’organisme officiel qui unit la Conférence des évêques catholiques (non reconnue par le Saint-Siège) et l’Association patriotique des catholiques chinois, toutes deux placées sous la supervision du Front uni, le service du parti communiste qui gouverne la vie religieuse du pays. Ce document a été publié le jour de Noël sur le site de l’Église catholique chinoise. Un document similaire était sorti le 19 décembre pour les Églises protestantes.
Composé de 5000 caractères (soit environ 3000 mots en français), le « Plan » catholique ne nomme pas une seule fois le pape ni le Saint-Siège ; pas plus que l’accord intervenu entre le Vatican et la Chine. Le leader Xi Jinping est quant à lui cité à quatre reprises. Par cinq fois, on répète que le catholicisme doit adopter des « caractéristiques chinoises ». On fait la part belle au mot « sinisation », qui apparaît pas moins de 53 fois.
Le « Plan » est la feuille de route pour rendre le processus de sinisation plus profond, plus idéologique et plus efficace : « Il est nécessaire d’intensifier la recherche pour doter la sinisation du catholicisme d’un fondement théologique, pour améliorer continuellement le système de pensée théologique sinisé, pour construire une base théorique solide à la sinisation du catholicisme, afin qu’il se manifeste constamment sous des caractéristiques chinoises ».
Ces dispositions n’ont rien de surprenant pour tout qui s’intéresse à la politique religieuse du gouvernement chinois ces dernières années : ce qui impressionne, en revanche, c’est la fermeté et le style péremptoire du langage. Comme s’il n’y avait eu aucun dialogue et aucun rapprochement avec le Saint-Siège ; comme si la reconnaissance donnée par le pape à tous les évêques chinois comptait pour rien, comme s’il n’y avait pas d’accord entre le Saint-Siège et la Chine donnant au monde entier l’impression que le catholicisme romain ait trouvé hospitalité et résidence en Chine.
En tant que théologien, le projet de donner un fondement théologique à la sinisation me frappe. Il est trop facile pour des observateurs superficiels de le justifier et de considérer ce terme comme une étape légitime du processus ecclésial d’inculturation. Il n’en est rien : ici ce ne sont pas les croyants qui cherchent librement un dialogue vertueux entre la foi catholique et leur propre appartenance culturelle. Il s’agit au contraire de la part d’un régime autoritaire, d’adapter de force la pratique de la foi à la politique religieuse imposée par les autorités du régime.
Il y a cent ans, du 15 mai au 12 juin 1924, se tenait le Concile de Shanghai, la première rencontre de tous les évêques de Chine (il n’y avait encore hélas aucun Chinois parmi eux). Ce Concile (l’adoption de ce terme est intéressante) avait été convoqué par le délégué pontifical Celso Costantini. Ce dernier avait été envoyé en Chine à la suite de l’encyclique « Maximum Illud » de 1919, qui imposait aux missions de poursuivre sur la voie de l’inculturation. Plusieurs missionnaires, dont le supérieur général des P.I.M.E. Paolo Manna (aujourd’hui béatifié) avaient dénoncé le caractère étranger de l’Église catholique en Chine. En 1926, six évêques chinois furent finalement ordonnés, et quelques années plus tard, à Pékin, Costantini fondait une école pour créer un art chrétien chinois. C’est ainsi, avec grand retard, que s’est amorcé le processus de sinisation. Et cette année du centenaire du Concile de Shanghai, il convient de réfléchir, du point de vue historique et théologique, sur ces événements et sur les défis pour l’avenir de la foi en Chine.
Ce que nous considérons comme étant inacceptable, c’est que le contrôle exercé par les des autorités politiques sur les croyants catholiques – un contrôle qui tente de se faire passer pour de la sinisation – soit justifié de manière ambigüe au nom de l’inculturation de l’Évangile.
Sandro Magister est vaticaniste à L’Espresso.
Tous les articles de Settimo Cielo depuis 2017 sont disponibles en ligne.