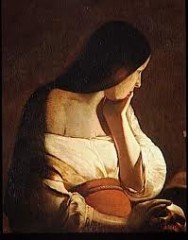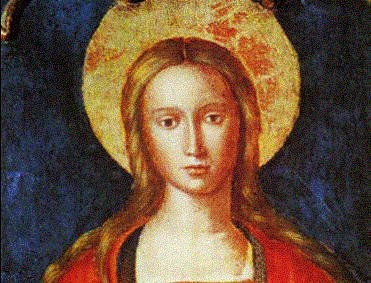D'InfoVaticana :
Ce qu'on ne vous dit pas sur la guerre civile espagnole : l'assassinat de 4 840 prêtres, 2 365 religieux et 283 religieuses
19 juillet, 2024
Le 18 juillet est la date à laquelle on considère que le soulèvement national a commencé, bien que la veille, le 17 juillet 1936, les troupes du camp national se soient soulevées à Melilla contre l'infâme et criminel gouvernement républicain.
La haine anti-catholique était déjà présente depuis des années avant le déclenchement de la guerre civile en 1936. Les socialistes, les communistes, les syndicalistes et les anarchistes s'en étaient pris aux catholiques et les incendies d'églises et de couvents étaient devenus monnaie courante dans les années 1930.
En 1931, le Premier ministre Manuel Azaña proclame : « L'Espagne a cessé d'être catholique ». En mai, une centaine d'églises et de couvents sont incendiés et le cardinal Segura, archevêque de Tolède et primat d'Espagne, est chassé. Tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif de destruction de l'Église. L'année suivante, plus de trente mille jésuites sont expulsés. En 1933, la loi sur les confessions et les congrégations interdit aux ordres religieux d'enseigner la foi et d'exercer toute activité.
Au cours de ce que l'on a appelé « l'octobre rouge des Asturies », une violente persécution religieuse a été déclenchée. En dix jours, 12 prêtres, 7 séminaristes et 18 religieux sont tués ; 58 églises sont incendiées. C'est dans ce contexte de fureur que sont nés les martyrs. Torturés et tués pour l'odium fidei (la haine de la foi). Une Eglise « arrosée » par le sang rouge des martyrs.
Francisco Franco, quant à lui, prononce son soulèvement en juillet 1936 et s'installe à Salamanque. De 1931 à 1939, 4 840 prêtres, 2 365 religieux et 283 religieuses ont été tués. Il ne faut pas oublier que certaines régions ont été plus virulentes que d'autres.
Le diocèse de Barbastro fut l'un des plus martyrisés, où 87% du clergé fut exterminé, ainsi que l'évêque Florentino Asensio. Ce martyr s'est fait enlever les testicules après avoir été fusillé et enveloppé dans des feuilles d'un journal local, il a été exposé sur les places et dans les cafés. Les martyrs clarétains de Barbastro, pour la plupart des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, sont morts en pardonnant à leurs bourreaux et en criant « Vive le Christ Roi ».
Pratiquement à partir du 18 juillet 1936, le culte catholique a dû être suspendu et les citoyens catholiques ont dû entrer dans la clandestinité, car ils étaient recherchés pour être arrêtés et traduits devant des tribunaux arbitraires où, à des milliers d'occasions, la peine de mort a été décrétée, sous le seul chef d'accusation d'être catholique.
La possession d'un chapelet ou le souvenir qu'un citoyen avait l'habitude d'aller à la messe ou de participer à des réunions de l'Action catholique suffisait pour être conduit devant un peloton d'exécution. Les exécutions étaient souvent immédiates et précédées de tortures sauvages.
La situation la plus précaire est celle des ecclésiastiques (évêques, prêtres et religieux). Beaucoup d'entre eux fuient de refuge en refuge, au péril de leur vie et de celle des personnes qui les hébergent. Il fallait être très courageux pour accueillir un prêtre ou une religieuse chez soi, et tout le monde n'était pas prêt à le faire : il n'était pas rare que des amis d'ecclésiastiques soient exécutés. Parmi les prêtres qui ont dû fuir Madrid la rouge, il y a par exemple le fondateur de l'Opus Dei, saint Josémaria Escriva de Balaguer, qui a traversé les Pyrénées avec quelques membres de l'Œuvre pour se rendre en Andorre et s'installer dans la zone nationale.
Selon Gabriel Jackson, « les trois premiers mois de la guerre ont été la période de terreur maximale dans la zone républicaine. Les passions républicaines sont à leur comble. Les prêtres furent les principales victimes du gangstérisme pur et dur ».
Il est difficile de donner des chiffres, mais on estime à 10 000 le nombre de martyrs des persécutions religieuses pendant la guerre civile, dont 3 000 laïcs, appartenant pour la plupart à l'Action catholique. Environ 7 000 d'entre eux sont enregistrés avec des noms et des prénoms. Ces chiffres signifient que la persécution religieuse est considérée comme la pire persécution religieuse de l'histoire.
Il y a eu des épisodes de grande cruauté et de véritable sadisme ; il y a eu des cas où les victimes ont été brûlées vives, terriblement mutilées avant de mourir ou soumises à de véritables tortures psychologiques. Il y a aussi eu des personnes traînées par des voitures. Il y a eu des cas où le corps d'une personne assassinée a été donné en pâture à des animaux. Il y a même eu une véritable chasse aux prisonniers.
Il convient également de noter ce que certains appellent « le martyre des choses ». Dès le début, les églises et les couvents ont été dévalisés, les images brûlées et les œuvres d'art pillées. Quelque 20 000 églises ont été détruites, dont plusieurs cathédrales, avec leur ornementation (retables et images) et leurs archives. Il est à noter que ces églises n'ont pas été détruites en temps de guerre, mais à l'arrière-garde. Aujourd'hui, de nombreuses provinces, comme Cuenca, Albacete et Valencia, qui n'ont pas connu une seule bataille pendant la guerre, n'ont pratiquement rien de leur patrimoine artistique religieux antérieur à 1936, parce qu'il a été détruit dans les flammes à l'époque.
 Lors de l'audience générale du mercredi 27 octobre 2010, place Saint-Pierre, Benoît XVI a consacré sa catéchèse à sainte Brigitte de Suède :
Lors de l'audience générale du mercredi 27 octobre 2010, place Saint-Pierre, Benoît XVI a consacré sa catéchèse à sainte Brigitte de Suède :