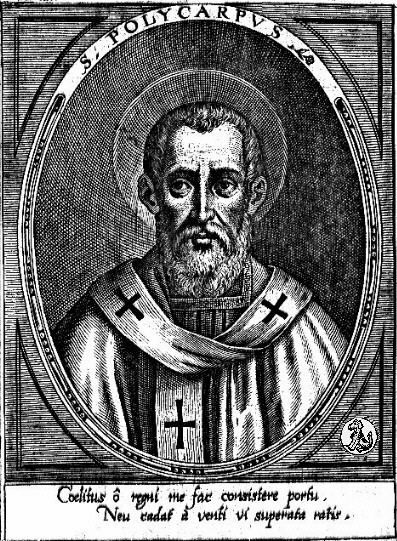Chers frères et sœurs !
Lorsque notre Dieu se révèle, il communique la liberté : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage » (Ex 20, 2). C’est ainsi que s’ouvre le Décalogue donné à Moïse sur le mont Sinaï. Le peuple sait bien de quel exode Dieu parle : l’expérience de l’esclavage est encore gravée dans sa chair. Il reçoit les dix consignes dans le désert comme un chemin vers la liberté. Nous les appelons « commandements », pour souligner la force de l’amour avec lequel Dieu éduque son peuple. Il s’agit en effet d’un appel vigoureux à la liberté. Il ne se réduit pas à un seul événement, car il mûrit au cours d’un cheminement. De même qu’Israël dans le désert conserve encore en lui l’Égypte – en fait, il regrette souvent le passé et murmure contre le ciel et contre Moïse – de la même façon, aujourd’hui, le peuple de Dieu garde en lui des liens contraignants qu’il doit choisir d’abandonner. Nous nous en rendons compte lorsque nous manquons d’espérance et que nous errons dans la vie comme sur une lande désolée, sans terre promise vers laquelle tendre ensemble. Le Carême est le temps de la grâce durant lequel le désert redevient – comme l’annonce le prophète Osée – le lieu du premier amour (cf. Os 2, 16-17). Dieu éduque son peuple pour qu’il sorte de l’esclavage et expérimente le passage de la mort à la vie. Comme un époux, il nous ramène à lui et murmure à notre cœur des paroles d’amour.
L’exode de l’esclavage vers la liberté n’est pas un chemin abstrait. Pour que notre Carême soit aussi concret, la première démarche est de vouloir voir la réalité. Lorsque, dans le buisson ardent, le Seigneur attira Moïse et lui parla, il se révéla immédiatement comme un Dieu qui voit et surtout qui écoute : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel » (Ex 3, 7-8). Aujourd’hui encore, le cri de tant de frères et sœurs opprimés parvient au ciel. Posons-nous la question : est-ce qu’il nous parvient à nous aussi ? Nous ébranle-t-il ? Nous émeut-il ? De nombreux facteurs nous éloignent les uns des autres, en bafouant la fraternité qui, à l’origine, nous liait les uns aux autres.
Lors de mon voyage à Lampedusa, j’ai opposé à la mondialisation de l’indifférence deux questions de plus en plus actuelles : « Où es-tu ? » (Gn 3, 9) et « Où est ton frère ? » (Gn 4, 9). Le parcours de Carême sera concret si, en les écoutant à nouveau, nous reconnaissons que nous sommes encore sous la domination du Pharaon. Une domination qui nous épuise et nous rend insensibles. C’est un modèle de croissance qui nous divise et nous vole l’avenir. La terre, l’air et l’eau en sont pollués, mais les âmes sont elles aussi contaminées. En effet, bien que notre libération ait commencé avec le baptême, il subsiste en nous une inexplicable nostalgie de l’esclavage. C’est comme une attirance vers la sécurité du déjà vu, au détriment de la liberté.
Je voudrais souligner, dans le récit de l’Exode, un détail qui n’est pas sans importance : c’est Dieu qui voit, qui s’émeut et qui libère, ce n’est pas Israël qui le demande. Le Pharaon, en effet, anéantit même les rêves, vole le ciel, fait apparaître comme immuable un monde où la dignité est bafouée et où les relations authentiques sont déniées. En un mot, il réussit à enchaîner à lui-même. Posons-nous la question : est-ce que je désire un monde nouveau ? Suis-je prêt à me libérer des compromis avec l’ancien ? Le témoignage de nombreux frères évêques et d’un grand nombre d’artisans de paix et de justice me convainc de plus en plus à devoir dénoncer un défaut d’espérance. Il s’agit d’un obstacle au rêve, d’un cri muet qui monte jusqu’au ciel et touche le cœur de Dieu et ressemble à ce regret de l’esclavage qui paralyse Israël dans le désert, en l’empêchant d’avancer. L’exode peut prendre fin : autrement, on ne pourrait pas expliquer pourquoi une humanité qui a atteint le seuil de la fraternité universelle et des niveaux de développement scientifique, technique, culturel et juridique capables d’assurer la dignité de tous, tâtonne dans l’obscurité des inégalités et des conflits.
Dieu ne s’est pas lassé de nous. Accueillons le Carême comme le temps fort durant lequel sa Parole s’adresse de nouveau à nous : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage » (Ex 20, 2). C’est un temps de conversion, un temps de liberté. Jésus lui-même, comme nous le rappelons chaque année à l’occasion du premier dimanche de Carême, a été conduit par l’Esprit au désert pour être éprouvé dans sa liberté. Pendant quarante jours, il sera devant nous et avec nous : il est le Fils incarné. Contrairement au Pharaon, Dieu ne veut pas des sujets, mais des fils. Le désert est l’espace dans lequel notre liberté peut mûrir en une décision personnelle de ne pas retomber dans l’esclavage. Pendant le Carême, nous trouvons de nouveaux critères de jugement et une communauté avec laquelle nous engager sur une route que nous n’avons jamais parcourue auparavant.
Cela implique une lutte : le livre de l’Exode et les tentations de Jésus dans le désert nous le disent clairement. À la voix de Dieu, qui dit : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 11) et « Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi » (Ex 20, 3), s’opposent en effet les mensonges de l’ennemi. Les idoles sont plus redoutables que le Pharaon : nous pourrions les considérer comme sa voix en nous. Pouvoir tout faire, être reconnu par tous, avoir le dessus sur tout le monde : chaque être humain ressent en lui la séduction de ce mensonge. C’est une vieille habitude. Nous pouvons nous accrocher ainsi à l’argent, à certains projets, à des idées, à des objectifs, à notre position, à une tradition, voire à certaines personnes. Au lieu de nous faire avancer, elles nous paralyseront. Au lieu de nous rapprocher, elles nous opposeront. Mais il y a une nouvelle humanité, le peuple des petits et des humbles qui n’a pas succombé à l’attrait du mensonge. Alors que les idoles rendent muets, aveugles, sourds, ou immobiles ceux qui les servent (cf. Ps 114, 4), les pauvres en esprit sont immédiatement ouverts et prêts : une silencieuse force de bien qui guérit et soutient le monde.
Il est temps d’agir, et durant le Carême, agir c’est aussi s’arrêter. S’arrêter en prière, pour accueillir la Parole de Dieu, et s’arrêter comme le Samaritain, en présence du frère blessé. L’amour de Dieu et du prochain est un unique amour. Ne pas avoir d’autres dieux, c’est s’arrêter en présence de Dieu, devant la chair de son prochain. C’est pourquoi la prière, l’aumône et le jeûne ne sont pas trois exercices indépendants, mais un seul mouvement d’ouverture, de libération : finies les idoles qui nous alourdissent, finis les attachements qui nous emprisonnent. C’est alors que le cœur atrophié et isolé s’éveillera. Alors, ralentir et s’arrêter. La dimension contemplative de la vie, que le Carême nous fera ainsi redécouvrir, mobilisera de nouvelles énergies. En présence de Dieu, nous devenons des frères et des sœurs, nous percevons les autres avec une intensité nouvelle : au lieu de menaces et d’ennemis, nous trouvons des compagnons et des compagnes de route. C’est le rêve de Dieu, la terre promise vers laquelle nous tendons une fois sortis de l’esclavage.
La forme synodale de l’Église, que nous redécouvrons et cultivons ces dernières années, suggère que le Carême soit aussi un temps de décisions communautaires, de petits et de grands choix à contre-courant, capables de changer la vie quotidienne des personnes et la vie d’un quartier : les habitudes d’achat, le soin de la création, l’inclusion de celui qui n’est pas visible ou de celui qui est méprisé. J’invite chaque communauté chrétienne à faire cela : offrir à ses fidèles des moments pour repenser leur style de vie ; se donner du temps pour vérifier leur présence dans le quartier et leur contribution à le rendre meilleur. Quel malheur si la pénitence chrétienne ressemblait à celle qui attristait Jésus. À nous aussi, il dit : « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent » (Mt 6, 16). Au contraire, que l’on voie la joie sur les visages, que l’on sente le parfum de la liberté, qu’on libère cet amour qui fait toutes choses nouvelles, en commençant par les plus petites et les plus proches. Cela peut se produire dans chaque communauté chrétienne.
Dans la mesure où ce Carême sera un Carême de conversion, alors l’humanité égarée éprouvera un sursaut de créativité : l’aube d’une nouvelle espérance. Je voudrais vous dire, comme aux jeunes que j’ai rencontrés à Lisbonne l’été dernier : « Cherchez et risquez, cherchez et risquez. À ce tournant de l’histoire, les défis sont énormes, les gémissements douloureux. Nous assistons à une troisième guerre mondiale par morceaux. Prenons le risque de penser que nous ne sommes pas dans une agonie, mais au contraire dans un enfantement ; non pas à la fin, mais au début d’un grand spectacle. Il faut du courage pour penser cela » ( Rencontre avec les jeunes universitaires, 3 août 2023). C’est le courage de la conversion, de la délivrance de l’esclavage. La foi et la charité tiennent la main de cette « petite fille espérance ». Elles lui apprennent à marcher et elle, en même temps, les tire en avant [1].
Je vous bénis tous ainsi que votre cheminement de Carême.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, le 3 décembre 2023, 1er dimanche de l’Avent.
FRANÇOIS
[1] Cf. Ch. Péguy, Le porche du mystère de la deuxième vertu, in Œuvres poétiques et dramatiques, Gallimard, Paris, 2014, p. 613.
 Du site Patristique.org :
Du site Patristique.org :