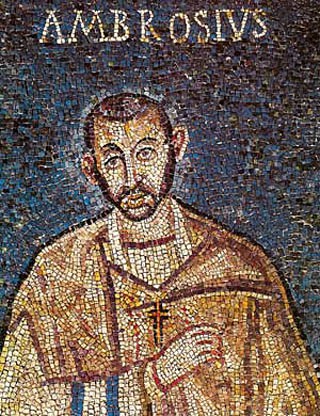Jean-Paul II lors de l'audience générale du 29 mai 1996 :
L' Immaculée Conception
Cher(e) ami(e)s ,
1. Nous avons vu dans nos catéchèses précédentes que, dans la réflexion doctrinale de l'Église d'Orient, l'expression "pleine de grâce " fut interprétée dès le VIe siècle dans le sens d'une sainteté singulière qui saisit Marie dans toute son existence. Elle inaugure ainsi la création nouvelle.
À côté du récit de l'Annonciation de saint Luc, la Tradition et le Magistère ont vu dans ce que l'on appelle le Protévangile (Gn 3, 15) une source scripturaire de la vérité de l'Immaculée Conception de Marie. Ce texte a inspiré, à partir de l'ancienne traduction latine : " Elle t'écrasera la tête ", de nombreuses représentations de l'Immaculée qui écrase le serpent sous ses pieds.
Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler que cette traduction ne correspond pas au texte hébreu, où ce n'est pas la femme, mais bien sa descendance, qui écrase la tête du serpent. Ce texte n'attribue donc pas à Marie, mais à son Fils, la victoire sur Satan. Cependant, puisque la tradition biblique établit une profonde solidarité entre celle qui engendre et sa descendance, la représentation de l'Immaculée qui écrase le serpent est cohérente avec le sens originel du passage : elle le fait non pas par sa propre force mais par grâce de son Fils.
2. Dans ce même texte biblique, on proclame en outre l'inimitié entre la femme et sa descendance, d'une part, et le serpent et sa descendance, d'autre part. Il s'agit d'une hostilité expressément établie par Dieu, qui prend un relief singulier si nous considérons le problème de la sainteté personnelle de la Vierge. Pour être l'ennemie inconciliable du serpent et de sa descendance, Marie doit être exempte de toute domination du péché. Et cela dès le premier moment de son existence.
À cet égard, l'Encyclique Fulgens corona, publiée par le Pape Pie XII en 1953 pour commémorer le centenaire de la définition du dogme de l'Immaculée Conception, propose cette argumentation : "Si, à un moment donné, la Bienheureuse Vierge Marie était restée privée de la grâce divine, parce que souillée dans sa conception par la tache héréditaire du péché, il y aurait eu entre elle et le serpent – du moins pendant cet espace de temps, si court qu'il eût été – non pas l'éternelle inimitié dont il est fait mention depuis la tradition primitive jusqu'à la définition solennelle de l'Immaculée Conception de la Vierge, mais bien plutôt un certain asservissement (AAS 45 [1953], 579) (DC 1953, no 1158, col. 1283. NDLR).
L'hostilité absolue établie par Dieu entre la femme et le démon postule donc en Marie l'Immaculée Conception, c'est-à-dire une absence totale de péché, dès le début de sa vie. Le Fils de Marie a remporté la victoire définitive sur Satan et en a fait bénéficier par anticipation sa Mère, la préservant du péché. En conséquence, le Fils lui a accordé le pouvoir de résister au démon, réalisant ainsi dans le mystère de l'Immaculée Conception l'effet le plus notable de son oeuvre rédemptrice.
3. L'appellation " pleine de grâce " et le Protévangile, en attirant notre attention sur la sainteté spéciale de Marie et sur sa complète exemption de l'influence de Satan, nous font comprendre, dans le privilège unique que le Seigneur a accordé à Marie, qu'un ordre nouveau commence, qui est le fruit de l'amitié avec Dieu et qui comporte, par conséquent, une inimitié profonde entre le serpent et les hommes.
Comme témoignage biblique en faveur de l'Immaculée Conception de Marie, on cite souvent, aussi, le chapitre XII de l'Apocalypse, où l'on parle de " la femme revêtue de soleil" (12, 1). L'exégèse actuelle est d'accord pour voir en cette femme la communauté du Peuple de Dieu, qui engendre dans la douleur le Messie ressuscité. Mais, à côté de cette interprétation collective, le texte suggère une interprétation individuelle lorsqu'il affirme : "La Femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer" (12, 5). On admet ainsi, par cette référence à l'enfantement, une certaine identification de la femme revêtue de soleil avec Marie, la Femme qui a mis le Messie au monde (" à la lumière "). La femme-communauté est décrite en effet sous les apparences de la femme-Mère de Jésus.
Caractérisée par sa maternité, la femme " était enceinte, et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement" (12, 2). Cette annotation renvoie à la Mère de Jésus au pied de la Croix (cf. Jn 19, 25) où elle participe, le coeur transpercé par une épée (cf. Lc 2, 35), au travail de l'enfantement de la communauté des disciples. Malgré ses souffrances, elle est " revêtue de soleil " – c'est-à-dire qu'elle porte le reflet de la splendeur divine – et elle apparaît comme un " signe grandiose" du rapport sponsal de Dieu avec son peuple.
Même si elles n'indiquent pas directement le privilège de l'Immaculée Conception, ces images peuvent être interprétées comme des expressions de l'amour du Père qui entoure Marie de la grâce du Christ et de la splendeur de l'Esprit.
Enfin, l'Apocalypse invite à reconnaître plus particulièrement la dimension ecclésiale de la personnalité de Marie : la femme revêtue de soleil représente la sainteté de l'Église, qui se réalise pleinement dans la Sainte Vierge, en vertu d'une grâce singulière.
4. À ces affirmations scripturaires auxquelles se réfèrent la Tradition et le Magistère pour fonder la doctrine de l'Immaculée Conception, paraissent s'opposer les textes bibliques qui affirment l'universalité du péché.
L'Ancien Testament parle d'une contagion due au péché qui touche tout " petit né d'une femme " (Ps 50, 7 ; Jb 14, 2). Dans le Nouveau Testament, Paul déclare que, à la suite de la faute d'Adam, "tous ont péché " et que "la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation " (Rm 5, 12. 18). Donc, comme le rappelle le Catéchisme de l'Eglise catholique, le péché originel "affecte la nature humaine" qui se trouve ainsi " dans un état déchu ". Aussi le péché est-il transmis "par propagation à toute l'humanité, c'est-à-dire par la transmission d'une nature humaine privée de la sainteté et de la justice originelles" (n. 404). Paul admet cependant une exception à cette loi universelle : le Christ, celui " qui n'a pas connu le péché " (2 Co 5, 21) et qui a pu ainsi faire surabonder la grâce " là où le péché a abondé " (Rm 5, 20).
Ces affirmations ne portent pas nécessairement à la conclusion que Marie a été impliquée dans l'humanité pécheresse. Le parallèle, établi par Paul, entre Adam et le Christ, est complété par celui qui existe entre Ève et Marie : le rôle, important, de la femme dans le drame du péché, l'est aussi dans la rédemption de l'humanité.
Saint Irénée présente Marie comme la nouvelle Ève qui, par sa foi et son obéissance, a fait contrepoids à l'incrédulité et à la désobéissance d'Ève. Un tel rôle dans l'économie du salut requiert l'absence de péché. Il convenait que comme le Christ, nouvel Adam, Marie, nouvelle Ève, n'eût pas connu le péché et qu'elle fût ainsi plus apte à coopérer à la rédemption.
Le péché qui traverse l'humanité comme un torrent, s'arrête devant le Rédempteur et sa fidèle Collaboratrice. Avec une différence substantielle : le Christ est totalement saint en vertu de la grâce qui, dans son humanité, découle de la personne divine ; Marie est toute sainte en vertu de la grâce reçue par les mérites du Sauveur.