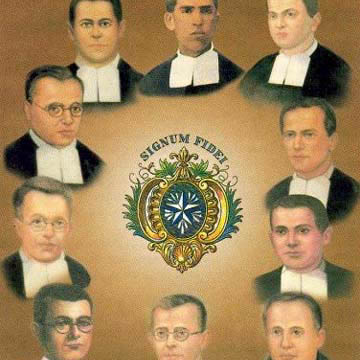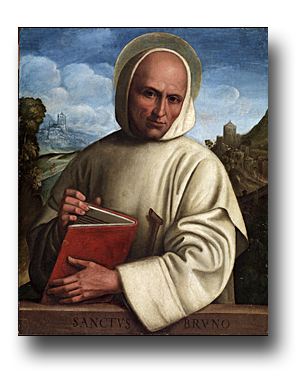LETTRE APOSTOLIQUE
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
DU PAPE JEAN-PAUL II
À L'ÉPISCOPAT, AU CLERGÉ ET AUX FIDÈLES SUR LE ROSAIRE (16 octobre 2002)
INTRODUCTION
1. Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s'est développé progressivement au coursdu deuxième millénaire sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, est une prière aimée de nombreux saints et encouragée par le Magistère. Dans sa simplicité et dans sa profondeur, il reste, même dans le troisième millénaire commençant, une prière d'une grande signification, destinée à porter des fruits de sainteté. Elle se situe bien dans la ligne spirituelle d'un christianisme qui, après deux mille ans, n'a rien perdu de la fraîcheur des origines et qui se sent poussé par l'Esprit de Dieu à « avancer au large » (Duc in altum!) pour redire, et même pour “crier” au monde, que le Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6), qu'il est « la fin de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation ».1
En effet, tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire est une prière dont le centre est christologique. Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique, dont il est presque un résumé.2 En lui résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat permanent pour l'œuvre de l'Incarnation rédemptrice qui a commencé dans son sein virginal. Avec lui, le peuple chrétien se met à l'école de Marie, pour se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la profondeur de son amour. Par le Rosaire, le croyant puise d'abondantes grâces, les recevant presque des mains mêmes de la Mère du Rédempteur.
Les Pontifes romains et le Rosaire
2. Beaucoup de mes prédécesseurs ont accordé une grande importance à cette prière. À ce sujet, des mérites particuliers reviennent à Léon XIII qui, le 1erseptembre 1883, promulgua l'encyclique Supremi apostolatus officio,3 paroles fortes par lesquelles il inaugurait une série de nombreuses autres interventions concernant cette prière, qu'il présente comme un instrument spirituel efficace face aux maux de la société. Parmi les Papes les plus récents qui, dans la période conciliaire, se sont illustrés dans la promotion du Rosaire, je désire rappeler le bienheureux Jean XXIII4 et surtout Paul VI qui, dans l'exhortation apostoliqueMarialis cultus, souligna, en harmonie avec l'inspiration du Concile Vatican II, le caractère évangélique du Rosaire et son orientation christologique.
Puis, moi-même, je n'ai négligé aucune occasion pour exhorter à la récitation fréquente du Rosaire. Depuis mes plus jeunes années, cette prière a eu une place importante dans ma vie spirituelle. Mon récent voyage en Pologne me l'a rappelé avec force, et surtout la visite au sanctuaire de Kalwaria. Le Rosaire m'a accompagné dans les temps de joie et dans les temps d'épreuve. Je lui ai confié de nombreuses préoccupations. En lui, j'ai toujours trouvé le réconfort. Il y a vingt-quatre ans, le 29 octobre 1978, deux semaines à peine après mon élection au Siège de Pierre, laissant entrevoir quelque chose de mon âme, je m'exprimais ainsi: « Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. [...] On peut dire que le Rosaire est, d'une certaine manière, une prière-commentaire du dernier chapitre de la Constitution Lumen gentium du deuxième Concile du Vatican, chapitre qui traite de l'admirable présence de la Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église. En effet, sur l'arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus Christ. Réunis en mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils (1961), pp.641-647: La Documentation catholique 58 (1961), col. 1265-1271.nous mettent en communion vivante avec Jésus à travers le cœur de sa Mère, pourrions-nous dire. En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, de l'humanité, c'est-à-dire nos événements personnels ou ceux de notre prochain, et en particulier de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur. C'est ainsi que la simple prière du Rosaire s'écoule au rythme de la vie humaine ».5
Par ces paroles, chers frères et sœurs, je mettais dans le rythme quotidien du Rosaire ma première année de Pontificat. Aujourd'hui, au début de ma vingt-cinquième année de service comme Successeur de Pierre, je désire faire de même. Que de grâces n'ai-je pas reçues de la Vierge Sainte à travers le rosaire au cours de ces années: Magnificat anima mea Dominum!Je désire faire monter mon action de grâce vers le Seigneur avec les paroles de sa très sainte Mère, sous la protection de laquelle j'ai placé mon ministère pétrinien: Totus tuus!
Lire la suite