De Constance Roques sur zenit.org :
De l’euthanasie des enfants, par Lucetta Scaraffia
L’Osservatore Romano évoque le « protocole de Groningen »
« La vague de solidarité et de protection que le cas de Charlie Gard a suscitée ne doit (…) pas s’épuiser dans un moment d’émotion isolée, bien qu’intense, mais devenir une occasion de dénoncer des cas encore plus graves. Afin d’inciter les responsables à réfléchir sur la gravité de ce qui se passe sous leurs yeux, dans une illégalité non seulement tolérée mais carrément justifiée », estime Lucetta Scaraffia, dans L’Osservatore Romano en italien du 8 juillet 2017.
« Tandis que l’on se mobilise de différentes parties pour empêcher ou au moins éloigner le moment de la mort du petit Charlie Gard, cas tragique mais éloigné de l’euthanasie, dans le silence le plus absolu des nouveau-nés jugés gravement malades sont habituellement tués », affirme cette plume bien connue du quotidien du Vatican.
Elle rappelle que « celui qui a proposé de règlementer cette pratique, en 2005, est le médecin hollandais Eduard Verhagen, en partant du présupposé que, sur 200.000 enfants qui naissent chaque année aux Pays-Bas, environ 1000 meurent dans les douze premiers mois, dont 600 suite à une décision médicale, en général relative à l’opportunité de ne pas continuer ou de ne pas initier un traitement lourd, c’est-à-dire pour éviter l’acharnement thérapeutique » : « Verhagen inspire ainsi le fameux protocole de Groningen, selon lequel la possibilité d’une intervention s’étend aussi à une véritable euthanasie pour des enfants qui « peuvent avoir une qualité de vie très basse, sans perspective d’amélioration ». Le concept extrêmement vague de « qualité » de la vie s’ouvre donc à diverses possibilités qui dépassent largement l’acharnement thérapeutique. »
Lucetta Scaraffia analyse le processus de légitimation de cette pratique : « Pour rendre légitime ce procédé, qui requiert évidemment aussi le consensus des parents, le protocole prévoit une procédure bureaucratique complexe, à remplir avant et après la mort de l’enfant.
Même si l’euthanasie est légale aux Pays-Bas, et à partir de douze ans, ce protocole élaboré à l’hôpital universitaire de Groningen, et approuvé peu après par l’Association hollandaise de pédiatrie, n’a pas été voté comme loi. Qui le met en œuvre peut donc être légalement poursuivi mais, de fait, cela ne se produit pas parce que les tribunaux hollandais se sont jusqu’ici toujours exprimés en faveur des médecins qui ont accompli des actes euthanasiques y compris sur des nouveau-nés. »
Elle souligne le flou dont ces procédés s’entourent : « Le statut d’illégalité des pratiques explique pourquoi il n’est pas possible de découvrir le nombre des enfants soumis à ce procédé : en effet, les médecins découragés par la longueur de la procédure bureaucratique proposée, préfèrent déclarer un décès naturel même quand ils interviennent à des fins euthanasiques. Il suffit de penser qu’aucun rapport conforme au protocole n’a été remis en 2012 et en 2013, même s’il est plus que probable que des euthanasies ont été pratiquées. »
Mais elle épingle aussi le consentement tacite de la société, mêlé de manque d’espérance dans les capacités des personnes et de la science : « Cela se produit parce qu’au fond, l’opinion publique est en grande partie favorable au protocole et l’accepte bien qu’il ne soit pas légalisé. Il y a pourtant des médecins qui ont émis des critiques, surtout relatives à la possibilité d’émettre des pronostics sur la « qualité de vie future » en ignorant les ressources de chaque patient et les éventuels progrès scientifiques. »
Quant au consentement des parents, les conditions de discernement sont problématiques : « Les critiques signalent aussi que le consensus des parents se base sur un concept très ambigu : leur réponse, en effet, est toujours conditionnée par la manière dont a été présentée la situation des enfants par les médecins, sans compter l’état de dépression émotionnelle dans laquelle ils se trouvent. »
Et l’on masque la réalité derrière des mots : « Deux philosophes sont récemment intervenus dans le « Journal of Medical Ethics », toujours en faveur de l’euthanasie des nouveau-nés, la motivant à propos de nouveau-nés dont la condition aurait « justifié » l’avortement, au point de dénommer leur euthanasie un « avortement post-natal ». »
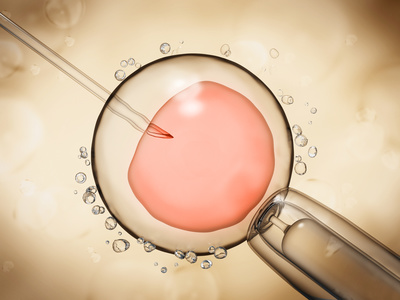 Nouveau DOSSIER :
Nouveau DOSSIER :  Fiche didactique pour comprendre en 2 pages :
Fiche didactique pour comprendre en 2 pages : 