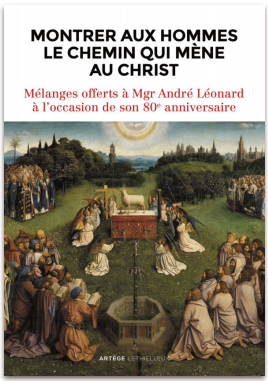On a pu voir récemment, lors de la journée contre l'homophobie, l'un ou l'autre ecclésiastique de notre pays s'afficher sur facebook ou ailleurs, nimbé des couleurs arc-en-ciel, pour y affirmer sa militance contre les discriminations dont sont victimes les différentes catégories LGBT, avec un message comme celui-ci : "Lutter contre l'homophobie, la transphobie, l'interphobie, la queerphobie, etc., c'est lutter contre la haine. "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés." "Ne jugez pas." Dieu nous appelle à aimer, pas à haïr; il nous appelle à accueillir l'autre, pas à le rejeter. Soyons signes de l'amour de Dieu pour chaque personne de notre monde!" Mais le contexte invite à s'interroger s'il s'agit vraiment de promouvoir l'amour et la tolérance à l'égard du prochain ou bien de rejoindre très ouvertement la militance homosexuelle dont on arbore ostensiblement les symboles. Ainsi sont bannis les distinctions et le discernement auxquels invite la morale catholique : de cette façon on ne distinguera plus la personne (objet d'amour inconditionnel) et ses actes (éventuellement répréhensibles). L'article paru aujourd'hui (25 mai) sur le site de la Nuova Bussola Quotidiana sous la plume de Riccardo Cascioli pose, nous semble-t-il, les bonnes questions.
Catho-Gay Connection, comment je te fais la promotion de l'homosexualité

Avvenire, le cardinal Zuppi, l'éditeur San-Paolo : tous ensemble pour lancer une nouvelle offensive pour la légitimation de l'homosexualité dans l'Église. Un livre, avec la bénédiction de l'archevêque de Bologne, qui rassemble les voix des théologiens, des psychologues, qui poussent tout le monde du même côté. Sous prétexte d'accueillir les gens, on efface la différence entre l'orientation sexuelle et les actes homosexuels, allant jusqu'à s'ouvrir à une certaine reconnaissance des unions homosexuelles. Ratzinger avait déjà mis en garde il y a 34 ans : dans l'Eglise, un lobby gay veut subvertir l'enseignement sur la sexualité.
Elle mène la croisade catholique-gay. A présent, ce n'est même plus un scoop. Mais lorsqu'on ouvre une page du journal de la Conférence épiscopale italienne et que l'on y trouve le titre "Zuppi : les homosexuels ? La diversité est une richesse", cela fait toujours un certain effet, aussi parce que c'est une affirmation qui implique presque la nécessité de l'homosexualité, étant donné que sans elle nous serions plus pauvres. Ce qui contraste assez nettement avec le Catéchisme de l'Eglise catholique et toute la tradition. Il suffit de rappeler que le Catéchisme fait figurer la sodomie parmi les quatre "péchés qui crient au ciel", une langue modernisée par rapport aux "péchés qui crient à la vengeance devant Dieu", en usage auparavant.
Mais pour bien voir la page en question, il y a plus : les déclarations de l'archevêque de Bologne, le cardinal Matteo Zuppi, font partie de la préface-interview du livre du journaliste de l'Avvenire Luciano Moia (qui s'est fait de la croisade catholique-gay une raison de vivre) intitulé "Eglise et homosexualité. Une enquête à la lumière du Magistère du Pape François". Dans le livre, explique-t-on, il y a place pour une série d'interviews réalisées par l'équipe d'Avvenire "Nous, famille et vie" au tournant de 2018 et 2019, qui vont évidemment tous dans la même direction. Et pour y apposer le sceau de l'autorité, il y a aussi la préface du directeur de l'Avvenire, Marco Tarquinio. Il ne s'agit donc pas d'un travail d'intérêt personnel d'un journaliste, mais d'une véritable opération qui catalyse autour de l'organe officiel de la CEI : des théologiens, des psychologues, un cardinal considéré comme dans la manche du Pape et donné pour le prochain président de la CEI, et l'éditeur San Paolo, pilier de l'édition catholique.
En tout cas, l'interview du cardinal Zuppi suffit à mettre en évidence les mensonges et les ambiguïtés qu'un certain cléricalisme utilise pour promouvoir les modes de vie homosexuels. Pour le reste, on se souvient que le cardinal Zuppi avait déjà signé la préface du livre du père James Martin "Un pont à construire - Une nouvelle relation entre l'Église et les personnes LGBT", véritable manifeste de l'homosexualisme (autoproclamé) catholique.
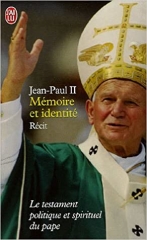 En relisant « Mémoire et Identité » qui constitue le testament spirituel (l’ouvrage fut publié chez Flammarion en 2005) de ce grand pape, on comprend mieux encore ses affinités avec son proche collaborateur le futur Benoît XVI, et la distance qui les sépare, l’un et l’autre, des intellectuels post-modernes sévissant aujourd’hui, plus que jamais, en Europe. Extraits choisis d’une pensée qui fâche un monde qui a cessé d’être chrétien :
En relisant « Mémoire et Identité » qui constitue le testament spirituel (l’ouvrage fut publié chez Flammarion en 2005) de ce grand pape, on comprend mieux encore ses affinités avec son proche collaborateur le futur Benoît XVI, et la distance qui les sépare, l’un et l’autre, des intellectuels post-modernes sévissant aujourd’hui, plus que jamais, en Europe. Extraits choisis d’une pensée qui fâche un monde qui a cessé d’être chrétien :
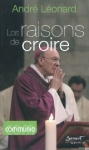 En concluant son essai apologétique « Les raisons de croire » publié chez Fayard (1e édition en 1987) Mgr André Léonard, alors professeur de métaphysique et de philosophie à l’UCL, illustre ces questions que posent déjà des enfants eux-mêmes lorsque leur conscience s’éveille à l’étrangeté de la condition humaine :
En concluant son essai apologétique « Les raisons de croire » publié chez Fayard (1e édition en 1987) Mgr André Léonard, alors professeur de métaphysique et de philosophie à l’UCL, illustre ces questions que posent déjà des enfants eux-mêmes lorsque leur conscience s’éveille à l’étrangeté de la condition humaine :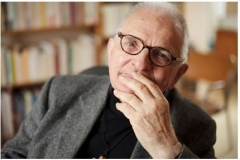 Dans la nuit de Pâques, dimanche dernier 12 avril 2020, le Père jésuite André Manaranche nous a quittés à l’âge de 93 ans, emporté par l’épidémie de coronavirus.
Dans la nuit de Pâques, dimanche dernier 12 avril 2020, le Père jésuite André Manaranche nous a quittés à l’âge de 93 ans, emporté par l’épidémie de coronavirus. 

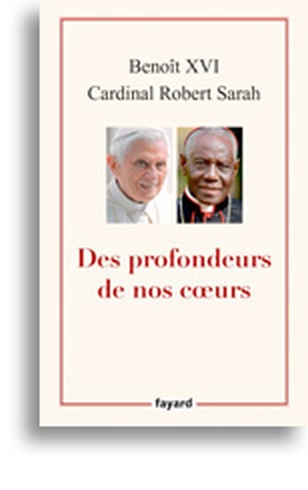

![La « conversion écologique », une énième tentative <br>de se concilier le monde [fr, eng, it]](https://www.hommenouveau.fr/medias/moyenne/images/blog/billets-2015/Res_Novae_carre.jpg)