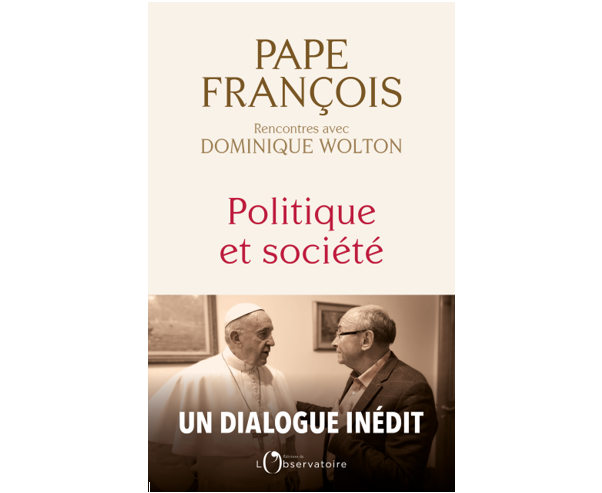UN PAPE DEBORDE (source)
L’analyse d'Hubert Windisch, professeur émérite de théologie à la faculté de théologie de l’Université de Freiburg (D), parue sur Kath.net.
« Lorsque le pape émérite Benoît XVI a publié son émouvant hommage au Cardinal Meissner récemment décédé, on a pu lire, entre les lignes, une certaine critique de la situation dans laquelle se trouve actuellement l’Eglise. Et on ne peut pas exclure non plus, que dans ces critiques était incluse la façon dont l’actuel pontificat est exercé.
De fait, de nombreux prêtres et laïcs se disent inquiets en considérant certains événements dont l’écho nous parvient de Rome : ce pape ne serait-il pas dépassé par sa charge ? Les réflexions qui suivent justifient largement qu’on se pose certaines questions :
Lorsque Jorge Mario Bergoglio fut élu pape le 13 mars 2013, comme successeur du pape Benoît XVI, il se rendit tout d’abord, comme le veut la tradition, dans cette pièce qu’on appelle la Chambre des Larmes (camera lacrimatoria) qui se situe à côté de la chapelle Sixtine. C’est là qu’il devait revêtir les insignes de sa charge pontificale : la mozette de velours rouge garnie d’hermine blanche, la croix dorée des papes et les traditionnelles chaussures rouges. Mais il refusa de porter ces insignes. Il aurait ajouté : “C’en est fini à présent de ce carnaval”. Quoiqu’il en soit, ce pape ne semble pas avoir saisi la signification symbolique de ces insignes : la mozette rouge rappelle la souffrance et le sang du Christ ; la croix dorée symbolise à la fois la dignité et la lourdeur de la charge pontificale ; les mules rouges font référence à Constantin XI, le dernier empereur byzantin - le rouge était le symbole du pouvoir des empereurs byzantins - qui trouva la mort lors de la conquête de Constantinople en 1453 par les musulmans.
Lorsque Bergoglio entra ainsi dans la loggia des bénédictions, le monde entier a pu vivre en direct la prise de fonction de la charge pontificale la plus banale qu’il n’y ait jamais eue depuis que la radio et la télévision sont là pour en témoigner. Bergoglio dit à ces milliers de gens rassemblés sur la place Saint Pierre non pas : “Laudetur Jesus Christus” ou “In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti”, mais : “Buona sera”. Dès cet instant, une inquiétude s’est installée. La crainte qu’un pontificat banal allait peut-être faire suite à cette entrée banale ; la crainte de l’émergence d’un autre type de “carnaval”, comme cela semblera d’ailleurs se confirmer quelques jours plus tard lorsqu’on vit le pape se mettre un nez rouge de clown lors d’une audience générale sur la place Saint Pierre.
Lucrecia Rego de Planas, une catholique mexicaine qui connait personnellement Bergoglio depuis de nombreuses années, écrivait quelques mois seulement après l’élection du pape François une lettre ouverte aux accents tragiques : “Le pape aime être aimé de tous”. Voilà qui permet de comprendre certains faux-pas de Bergoglio quant à sa manière de gérer le style et le contenu de sa charge : une inflation de mots au cours de nombreux interviews, des coups de téléphones et des homélies matinales, ou encore des postures officielles affectées et artificielles qui, certes, sont efficaces pour faire la une des magazines, mais s’avèrent déplacées dès lors qu’il s’agit du salut des âmes des fidèles.
Un collègue protestant m’écrivait un jour : “Il ne suffit pas d’aller à pied chez le coiffeur ou chez le dentiste, de se servir soi-même à la cantine du Vatican ou de se rendre en Fiat 500 à un rendez-vous avec le président des Etats-Unis pour être un bon pape. J’ai bien peur que par les trous de sa soutane ne suinte un peu de vanité”.
Celui qui aime être aimé des autres se voit souvent contraint, en tant que pasteur de l’Eglise, à mettre une partie de l’annonce de l’Evangile sous le boisseau. S’il s’agit du pape, il risque alors fort de cesser d’être ce rocher qui résiste fermement aux tempêtes de la vie : il peut alors ressembler davantage à une dune de sable se mouvant sous le vent de l’esprit du temps ; il peut être amené à exprimer des positions et des opinions serviles, se pliant aisément à tout et à chacun, et qui aboutissent finalement à un affaiblissement inadmissible de la conscience que l’Eglise catholique a d’elle-même.
On verra ainsi dans une vidéo, lors d’une invitation à la prière initiée par le pape en janvier 2016, des représentants du bouddhisme, du judaïsme, de l’islam et de la chrétienté se présenter côte à côte. Devant eux, les symboles religieux de leurs communautés respectives, à savoir : une statue de Bouddha, un chandelier à sept branches, un tasbih musulman (sorte de chapelet), et… non pas la croix du Christ, mais un simple petit enfant-Jésus de la crèche.
On verra ainsi le pape, en la fête du Jeudi Saint 2016, laver les pieds de prisonniers, et parmi eux des musulmans, geste aboutissant par là non seulement à affadir la symbolique attachée à l’action de Jésus lors de la dernière Cène, mais même à en fausser le sens.
On verra ainsi le pape, un samedi, veille de la Pentecôte 2014, inviter des représentants des trois religions monothéistes à une prière pour la paix dans les jardins du Vatican, et se laisser littéralement montrer du doigt (en même temps d’ailleurs que le rabbin présent) par le représentant musulman lorsque celui-ci se met à citer, en conclusion de sa prière, la sourate 2 du Coran, celle qui supplie Allah de donner aux fidèles musulmans la victoire sur les peuples infidèles (c’est-à-dire les juifs et les chrétiens).
On verra ainsi le pape, dans l’avion qui le ramène de la Journée Mondiale de la Jeunesse de Cracovie, interviewé au sujet de la violence dans l’islam - rappelons que c’est durant le séjour du pape à Cracovie, le 26 Juillet 2016, que le Père Hamel avait été assassiné par deux musulmans pendant qu’il célébrait la messe dans une paroisse proche de Rouen - répondre aux journalistes en évoquant l’histoire d’une catholique italienne tuée par son gendre. Les journalistes ont dû se demander en eux-mêmes s’ils ne venaient pas d’être témoins d’un bug papal.
On verra ainsi le pape s’envoler sur l’île de Lesbos pour visiter un camp de réfugiés : il en ramènera quelques-uns à Rome, mais uniquement des musulmans ; pas un seul chrétien.
On entendra ainsi, en avril 2017, une comparaison terrible entre les conditions de vie dans les actuels camps de réfugiés et celles qu’avaient connu les prisonniers des camps de concentration nazis.
Et l’on pourrait trouver de nombreux autres exemples dans le domaine de la politique qui, tous, tendent à confirmer la platitude de ce pontificat. Ce dernier est, de plus, caractérisé par les nombreuses contradictions qu’il véhicule : si vers l’extérieur, le discours est imprégné de la notion de miséricorde, à l’interne, l’exercice de la charge pontificale est souvent marqué par une réelle dureté. Qu’on se souvienne par exemple de l’attitude irrespectueuse du pape envers les cardinaux ayant émis les “dubia”, ou encore récemment du limogeage silencieux du cardinal Müller comme Préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi.
L’exemple le plus flagrant de cette tendance aux propos contradictoires nous vient sans doute du document post-synodal “Amoris laetitia” : d’une part ce document met en avant une ferme volonté de continuité avec les enseignements du passé pour ce qui concerne le mariage et, d’autre part, dans une simple note de bas de page, met à mal tout l’édifice de la doctrine sacramentelle en lien avec le mariage, la confession et l’Eucharistie.
La formule la plus souvent citée au cours de ce pontificat : “Qui suis-je, moi, pour juger ? (Chi sono io per giudicare)”, prononcée par François fin juillet 2013 dans l’avion qui le ramenait du Brésil, concentre tout le malheur qui s’est abattu sur l’Eglise à travers ce pontificat à ce point unique, à savoir l’avènement dans l’Eglise, par le fait du pape lui-même, du règne du relativisme sur le plan doctrinal et pastoral.
Avec tout le respect que je dois à la personne du pape et à sa fonction pontificale, il me faut malheureusement constater que l’image de l’Eglise catholique est aujourd’hui celle d’une communauté fragilisée et déchirée. De nombreux catholiques à travers le monde se sentent dorénavant déracinés dans leur propre Eglise, une Eglise ébranlée dans ses fondements. Où cela doit-il nous mener ? »
Source : Kathnet (trad. MH/APL)
Et, sur "Benoît-et-moi" : "Les incroyables propos d'un pape"
...mais tout le monde ne voit pas les choses de cette façon : http://www.belgicatho.be/archive/2017/09/08/francois-un-pape-fabuleux-5977814.html