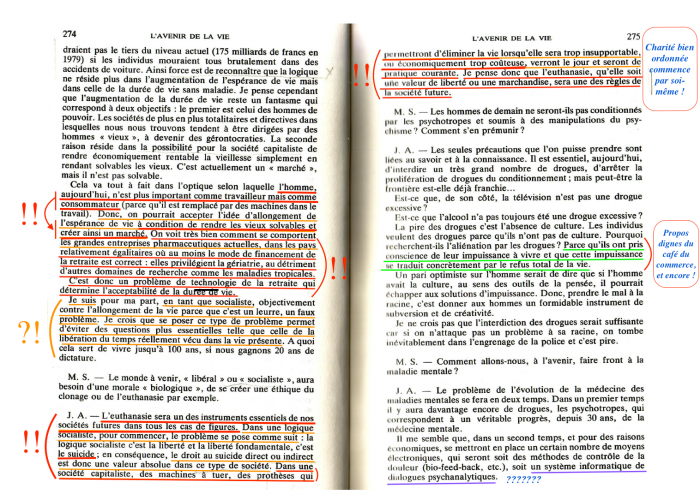MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2018
[14 janvier 2018]
« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer
les migrants et les réfugiés »
Chers frères et sœurs,
« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34).
Durant les premières années de mon pontificat, j’ai exprimé à maintes reprises une préoccupation spéciale concernant la triste situation de nombreux migrants et réfugiés qui fuient les guerres, les persécutions, les catastrophes naturelles et la pauvreté. Il s’agit sans doute d’un ‘‘signe des temps’’ que j’ai essayé de lire, en invoquant la lumière de l’Esprit Saint depuis ma visite à Lampedusa le 8 juillet 2013. En créant le nouveau Dicastère pour le Service du Développement humain intégral, j’ai voulu qu’une section spéciale, placée ad tempus sous mon autorité directe, exprime la sollicitude de l’Église envers les migrants, les personnes déplacées, les réfugiés et les victimes de la traite.
Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté (cf. Mt 25, 35.43). Le Seigneur confie à l’amour maternel de l’Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la recherche d’un avenir meilleur (Cf. Pie XII, Constitution apostolique Exsul Familia, Titulus Primus, I, 1er août 1952). Cette sollicitude doit s’exprimer concrètement à chaque étape de l’expérience migratoire : depuis le départ jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au retour. C’est une grande responsabilité que l’Église entend partager avec tous les croyants ainsi qu’avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, qui sont appelés à répondre aux nombreux défis posés par les migrations contemporaines, avec générosité, rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun selon ses propres possibilités.
À ce sujet, nous souhaitons réaffirmer que « notre réponse commune pourrait s’articuler autour de quatre verbes fondés sur les principes de la doctrine de l’Église : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » (Discours aux participants au Forum International ‘‘Migrations et paix’’, 21 février 2017).
En considérant la situation actuelle, accueillir signifie avant tout offrir aux migrants et aux réfugiés de plus grandes possibilités d’entrée sûre et légale dans les pays de destination. En ce sens, un engagement concret est souhaitable afin que soit étendu et simplifié l’octroi de visas humanitaires et pour le regroupement familial. En même temps, je souhaite qu’un plus grand nombre de pays adoptent des programmes de patronage privé et communautaire et ouvrent des corridors humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables. En outre, il serait opportun de prévoir des visas temporaires spéciaux pour les personnes qui fuient les conflits dans les pays voisins. Les expulsions collectives et arbitraires de migrants et de réfugiés ne constituent pas une solution adéquate, surtout lorsqu’elles sont exécutées vers des pays qui ne peuvent pas garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux (Cf. Intervention du Représentant permanent du Saint-Siège à la 103ème Session du Conseil de l’OIM, 26 novembre 2013). J’en viens encore à souligner l’importance d’offrir aux migrants et aux réfugiés un premier accueil approprié et digne. « Les programmes d’accueil diffus, déjà lancés dans différentes localités, semblent au contraire faciliter la rencontre personnelle, permettre une meilleure qualité des services et offrir de plus grandes garanties de succès » (Discours aux participants au Forum International ‘‘Migrations et paix’’, 21 février 2017). Le principe de la centralité de la personne humaine, fermement affirmé par mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI (Cf. Lettre encyclique Caritas in veritate, 47), nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle avant la sécurité nationale. Par conséquent, il est nécessaire de former adéquatement le personnel préposé aux contrôles de frontière. Les conditions des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, postulent que leur soient garantis la sécurité personnelle et l’accès aux services élémentaires. Au nom de la dignité fondamentale de chaque personne, il faut s’efforcer de préférer des solutions alternatives à la détention pour ceux qui entrent sur le territoire national sans autorisation (Cf. Intervention du Représentant permanent du Saint-Siège à la 20ème Session du Conseil des droits humains, 22 juin 2012).
Le deuxième verbe, protéger, se décline en toute une série d’actions pour la défense des droits et de la dignité des migrants ainsi que des réfugiés, indépendamment de leur statut migratoire (Cf. Benoît XVI, Lettre encyclique Caritas in veritate, 62). Cette protection commence dans le pays d’origine et consiste dans la mise à disposition d’informations sûres et certifiées avant le départ et dans la prévention contre les pratiques de recrutement illégal (Cf. Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Itinérants, Instruction Erga migrantes caritas Christi, n. 6). Elle devrait se poursuivre, dans la mesure du possible, dans le pays d’immigration, en assurant aux migrants une assistance consulaire adéquate, le droit de garder toujours avec soi les documents d’identité personnels, un accès équitable à la justice, la possibilité d’ouvrir des comptes bancaires personnels et la garantie d’une subsistance minimum vitale. Si elles sont reconnues et valorisées de manière appropriée, les capacités et les compétences des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, représentent une vraie ressource pour les communautés qui les accueillent (Cf. Benoît XVI, Discours aux participants au 6ème Congrès mondial pour la pastorale des migrants et des réfugiés, 9 novembre 2009). C’est pourquoi, je souhaite que, dans le respect de leur dignité, leur soient accordés la liberté de mouvement dans le pays d’accueil, la possibilité de travailler et l’accès aux moyens de télécommunication. Pour ceux qui décident de retourner dans leur pays, je souligne l’opportunité de développer des programmes de réintégration professionnelle et sociale. La Convention internationale sur les droits de l’enfant offre une base juridique universelle pour la protection des mineurs migrants. Il faut leur éviter toute forme de détention en raison de leur status migratoire, tandis qu’on doit leur assurer l’accès régulier à l’instruction primaire et secondaire. De même, quand ils atteignent l’âge de la majorité il est nécessaire de leur garantir une permanence régulière et la possibilité de continuer des études. Pour les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille, il est important de prévoir des programmes de garde temporaire ou de placement (Cf. Benoît XVI, Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, 2010, et S. Tomasi, Intervention du Représentant permanent du Saint-Siège à la 26ème Session ordinaire du Conseil pour les Droits de l’Homme sur les droits humains des migrants,13 juin 2014). Dans le respect du droit universel à une nationalité, celle-ci doit être reconnue et opportunément assurée à tous les enfants à la naissance. L’apatridie dans laquelle se trouvent parfois des migrants et des réfugiés peut être facilement évitée à travers « une législation sur la citoyenneté conforme aux principes fondamentaux du droit international » (Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Itinérants et Conseil Pontifical Cor Unum, Accueillir le Christ dans les réfugiés et dans les personnes déracinées de force, 2013, n. 70). Le status migratoire ne devrait pas limiter l’accès à l’assistance sanitaire nationale et aux systèmes de pension, ni le transfert de leurs contributions en cas de rapatriement.
Promouvoir veut dire essentiellement œuvrer afin que tous les migrants et les réfugiés ainsi que les communautés qui les accueillent soient mis en condition de se réaliser en tant que personnes dans toutes les dimensions qui composent l’humanité voulue par le Créateur (Cf. Paul VI, Lettre encyclique Populorum progressio, n. 14). Parmi ces dimensions, il faut reconnaître à la dimension religieuse sa juste valeur, en garantissant à tous les étrangers présents sur le territoire la liberté de profession et de pratique religieuse. Beaucoup de migrants et de réfugiés ont des compétences qui doivent être adéquatement certifiées et valorisées. Puisque « le travail humain est par nature destiné à unir les peuples » (Jean-Paul II, Lettre encyclique Centesimus annus, n. 27), j’encourage à œuvrer afin que soit promue l’insertion socio-professionnelle des migrants et des réfugiés, garantissant à tous – y compris aux demandeurs d’asile – la possibilité de travailler, des parcours de formation linguistique et de citoyenneté active ainsi qu’une information appropriée dans leurs langues d’origine. Dans le cas des mineurs migrants, leur implication dans des activités productives doit être règlementée de manière à prévenir des abus et des menaces à leur croissance normale. En 2006, Benoît XVIsoulignait comment, dans le contexte de migration, la famille est « lieu et ressource de la culture de la vie et facteur d’intégration des valeurs » (Benoît XVI, Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, 2007). Son intégrité doit être toujours promue, en favorisant le regroupement familial – y compris des grands-parents, des frères et sœurs et des petits-enfants – sans jamais le soumettre à des capacités économiques. Une plus grande attention et un plus grand soutien doivent être portés aux migrants, aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en situation de handicap. Tout en considérant louables les efforts déployés jusqu’ici par de nombreux pays en termes de coopération internationale et d’assistance humanitaire, je souhaite que dans la distribution de ces aides, soient pris en compte les besoins (par exemple l’assistance médicale et sociale ainsi que l’éducation) des pays en développement qui reçoivent d’importants flux de réfugiés et de migrants et, également, qu’on inclue parmi les destinataires les communautés locales en situation de pénurie matérielle et de vulnérabilité (Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Itinérants et Conseil Pontifical Cor Unum, Accueillir le Christ dans les réfugiés et dans les personnes déracinées de force, 2013, nn. 30-31).
Le dernier verbe, intégrer, se place sur le plan des opportunités d’enrichissement interculturel général du fait de la présence de migrants et de réfugiés. L’intégration n’est pas « une assimilation, qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. Le contact avec l'autre amène plutôt à en découvrir le ‘‘secret’’, à s'ouvrir à lui pour en accueillir les aspects valables et contribuer ainsi à une plus grande connaissance de chacun. Il s'agit d'un processus de longue haleine qui vise à former des sociétés et des cultures, en les rendant toujours davantage un reflet des dons multiformes de Dieu aux hommes » (Jean-Paul II, Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié (2005), 24 novembre 2004). Ce processus peut être accéléré à travers l’offre de citoyenneté dissociée des capacités économiques et linguistiques et l’offre de parcours de régularisation extraordinaire pour des migrants qui peuvent faire valoir une longue présence dans le pays. J’insiste encore sur la nécessité de favoriser, dans tous les cas, la culture de la rencontre, en multipliant les opportunités d’échange interculturel, en documentant et en diffusant les ‘‘bonnes pratiques’’ d’intégration et en développant des programmes visant à préparer les communautés locales aux processus d’intégration. Je dois souligner le cas spécial des étrangers forcés à quitter le pays d’immigration à cause de crises humanitaires. Ces personnes demandent que leur soient assurés une assistance adéquate pour le rapatriement et des programmes de réintégration professionnelle dans leur pays d’origine.
En conformité avec sa tradition pastorale, l’Église est disponible pour s’engager en première ligne en vue de réaliser toutes les initiatives proposées plus haut ; mais pour obtenir les résultats espérés, la contribution de la communauté politique et de la société civile, chacun selon ses responsabilités propres, est indispensable.
Durant le Sommet des Nations Unies, célébré à New York le 19 septembre 2016, les dirigeants du monde ont clairement exprimé leur volonté d’œuvrer en faveur des migrants et des réfugiés pour sauver leurs vies et protéger leurs droits, en partageant ces responsabilités au niveau global. À cet effet, les États se sont engagés à rédiger et à approuver avant la fin de l’année 2018 deux accords globaux (Global Compacts), l’un consacré aux réfugiés et l’autre concernant les migrants.
Chers frères et sœurs, à la lumière de ces processus engagés, les prochains mois représentent une opportunité privilégiée pour présenter et soumettre les actions concrètes dans lesquelles j’ai voulu décliner les quatre verbes. Je vous invite, donc, à profiter de chaque occasion pour partager ce message avec tous les acteurs politiques et sociaux qui sont impliqués – ou intéressés à participer – au processus qui conduira à l’approbation des quatre accords globaux.
Aujourd’hui, 15 août, nous célébrons la solennité de l’Assomption de la très Sainte Vierge Marie au Ciel. La Mère de Dieu a fait elle-même l’expérience de la dureté de l’exil (cf. Mt 2, 13-15) ; elle a suivi avec amour l’itinéraire de son Fils jusqu’au Calvaire et maintenant elle partage éternellement sa gloire. Confions à sa maternelle intercession les espérances de tous les migrants et réfugiés du monde et les aspirations des communautés qui les accueillent, afin que, selon le plus grand commandement de Dieu, nous apprenions tous à aimer l’autre, l’étranger, comme nous-mêmes.
Vatican, le 15 août 2017
Solennité de l’Assomption de la B.V. Marie
François
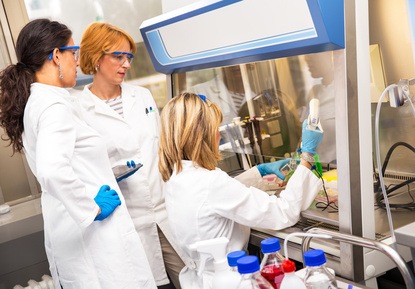 Au cours des dernières années, on constate une augmentation considérable du nombre de traitements de l'infertilité en Belgique. Le nombre de cycles de traitement par FIV / ICSI a plus que doublé entre 2004 et 2014, passant de 14.652 à 33.370 durant cette période. On a de plus enregistré une augmentation inexpliquée de presque 20% du nombre des traitements chez les moins de 36 ans.
Au cours des dernières années, on constate une augmentation considérable du nombre de traitements de l'infertilité en Belgique. Le nombre de cycles de traitement par FIV / ICSI a plus que doublé entre 2004 et 2014, passant de 14.652 à 33.370 durant cette période. On a de plus enregistré une augmentation inexpliquée de presque 20% du nombre des traitements chez les moins de 36 ans.  Au Congo, La « Lucha » (la lutte pour le changement) et d’autres mouvements citoyens sont en pointe dans le combat pour l’alternance en RDC. Hubert Leclerq interroge ici Marcel Héritier Kapitene pour Lalibreafrique.be :
Au Congo, La « Lucha » (la lutte pour le changement) et d’autres mouvements citoyens sont en pointe dans le combat pour l’alternance en RDC. Hubert Leclerq interroge ici Marcel Héritier Kapitene pour Lalibreafrique.be :