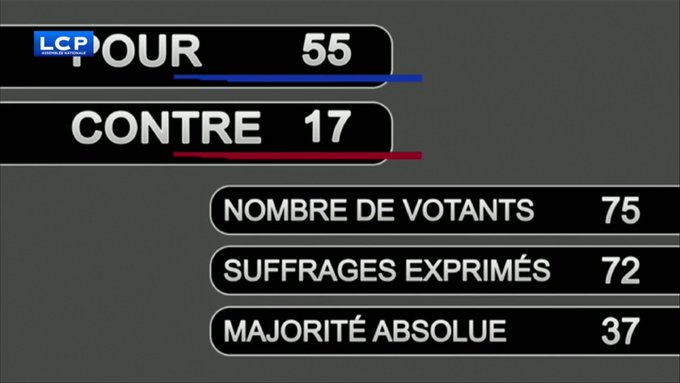C’est un événement inédit au Parlement européen. Le 19 septembre, l’hémicycle de Strasbourg, en France, a vu l’adoption d’une résolution sur l’Importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe. Pour la première fois, une organisation internationale juge officiellement le national-socialisme et le communisme selon les mêmes principes moraux. Bien sûr, tout le monde sait à quel point le nazisme était maléfique, et à quel point toute résurgence néo-nazie est odieuse. Partout dans le monde, on apprend, dès le plus jeune âge, à haïr et à combattre l’idéologie du nazisme et à lutter contre le néo-nazisme. Il n’en va pas de même du communisme, qui a longtemps été présenté comme un moindre mal, pour deux raisons principales. Premièrement, parce que l’Union soviétique communiste a rejoint les Alliés occidentaux dans l’effort militaire contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, parce que les régimes dirigés par les Soviétiques étaient au pouvoir dans de nombreux pays d’Europe centrale et orientale après la défaite de l’Allemagne nazie en 1945 et qu’ils ont ainsi pu contrôler la mémoire historique d’une grande partie du monde non soviétique en utilisant intelligemment la propagande.
Le communisme, un système maléfique
Mais le communisme n’est pas un moindre mal. Des êtres humains innocents ont été harcelés, tourmentés, injustement emprisonnés, torturés et tués à cause du communisme, tout comme sous le nazisme. Des populations entières ont été déportées, des pays souverains démembrés, des nations indépendantes occupées militairement. Le goulag soviétique a égalé le camp de concentration nazi en termes de cruauté. En temps de guerre comme en temps de paix, le cynisme a toujours été la règle pour les deux idéologies. Toutes deux ont géré de manière totalitaire des sociétés occupées. Et la persécution des Juifs a aussi eu lieu en Russie soviétique. Svetlana Alliluyeva (née Svetlana Iosifovna Stalina, 1926-2011), fille de Staline (Iosif Vissarionovič Džugašvili, 1878-1953), l’a reconnu dans son livre publié en 1969 intitulé En une seule année : un Mémoire. Louis Rapoport (1942-1991), écrivain américain et rédacteur en chef du Jerusalem Post, a documenté la persécution dans son ouvrage La guerre de Staline contre les Juifs : le complot des médecins et la solution soviétique (New York : Free Press, 1990). L’écrivain et journaliste allemand Arno Lustiger (1924-2012) a confirmé que les Juifs avaient été persécutés dans la Russie stalinienne dans son livre Staline et les Juifs : le Livre rouge (New York : Enigma, 2004). Plusieurs chercheurs ont insisté, en faisant valoir des arguments différents, sur la parenté intellectuelle entre les deux visages du socialisme européen du XXe siècle, le socialisme « national », c’est-à-dire le nazisme, et le socialisme « international », c’est-à-dire le communisme. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène particulier, voire marginal, l’existence de l’idéologie dite « nazie-bolchevique », une tentation résurgente et un syncrétisme entre nazisme et communisme, en témoigne de manière significative.
Il est d’autant plus important que l’institution politique la plus influente d’Europe, la terre où le nazisme et le communisme soviétique ont montré leurs pires couleurs, ait mis ces deux idéologies monstrueuses au même niveau en « […] cette année » qui « […] marque le 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, qui a causé des souffrances humaines d’une ampleur sans précédent et conduit à l’occupation des pays européens pendant de nombreuses décennies. »
De fait, « si les crimes du régime nazi ont été jugés et punis lors du procès de Nuremberg, il reste urgent de sensibiliser l’opinion publique, de dresser un bilan moral de cette période et de mener des enquêtes judiciaires sur les crimes du stalinisme et d’autres dictatures. »
Se souvenir de tous les crimes politiques
C’est pourquoi la résolution appelle à revisiter la mémoire historique en arrêtant de séparer les « crimes majeurs » et les « crimes mineurs » et en établissant non pas une mais deux journées de commémoration. L’une d’elles est le 23 août, Journée européenne de commémoration des victimes des régimes totalitaires ; elle est célébrée tant au niveau de l’UE qu’au niveau national. Cette date a été choisie parce qu’elle marque l’anniversaire du pacte de non-agression de 1939 signé par l’Union soviétique communiste et l’Allemagne nazie. Cet accord était connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop, dont les protocoles secrets partageaient l’Europe et les territoires d’États indépendants entre les deux régimes totalitaires selon des sphères d’influence et ouvrant ainsi la voie au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième journée de commémoration est le 25 mai, date anniversaire de l’exécution de l’officier polonais Witold Pilecki (1901-1948), qui sera proclamée Journée mondiale des héros de la lutte contre le totalitarisme.
Le commandant Pilecki était un grand héros, malheureusement souvent méconnu. C’était un héros de l’humanité, de la décence et de la miséricorde, ainsi que du christianisme. Issu d’une famille noble, c’était un fervent catholique qui était apprécié par ses paysans pour son traitement humain des travailleurs. Il s’est enrôlé dans l’armée polonaise au nom de l’idéal patriotique le plus pur : combattre l’occupant nazi. Puis il a voulu entrer en secret dans l’horrible camp de concentration nazi d’Auschwitz en Pologne pour recueillir des informations de l’intérieur. C’est ce qu’il l’a fait en réussissant aussi, contrairement aux autres, à s’échapper. Il a transmis les renseignements qu’il avait recueillis au gouvernement polonais légitime exilé à Londres, mais la bureaucratie britannique est restée inerte ; Auschwitz n’est jamais devenu un objectif prioritaire des armées alliées. Pilecki a combattu dans la résistance polonaise antinazie, prenant part à la fameuse et malheureuse insurrection de Varsovie en 1944 avec l’Armia Krajowa ou AK, l’armée nationale polonaise clandestine. Puis lorsque les Soviétiques sont arrivés après la guerre, ils ont considéré que Pilecki était un ennemi ; il était trop patriotique, trop catholique, trop anticommuniste. Il a continué à rassembler des preuves, cette fois sur les brutalités du régime communiste. On l’a donc poursuivi mais une fois de plus, il a su duper ses ennemis pendant longtemps. Au printemps 1948, les Soviétiques l’ont néanmoins attrapé et tué en lui tirant une balle dans la nuque dans une prison secrète de Varsovie après un simulacre de procès. Ils l’ont enterré dans un lieu inconnu, probablement près des poubelles du cimetière Powazki de Varsovie.
Quid de la Chine ?
Devant ces horreurs égales, qui oserait à présent montrer, brandir et porter une croix gammée nazie ou un marteau et une faucille communistes ? Après que le Parlement européen a condamné le nazisme et le communisme, l’histoire révisionniste ne devrait plus avoir sa place en Europe.
Mais qu’en est-il de la Chine ? Le maoïsme et le stalinisme étaient des régimes frères et enchaînés l’un à l’autre. Officiellement, la Chine continue d’adopter une idéologie communiste. En Chine, les symboles communistes sont affichés en toute impunité et les communistes gouvernent fièrement et se disent communistes sans la moindre honte. Bitter Winter ne traite pas de sujets politiques, car consacre sa mission à la défense de la liberté religieuse et des droits humains. Mais c’est bien au nom du communisme, aujourd’hui assimilé au nazisme par le Parlement européen, que la Chine persécute durement les minorités ethniques et les groupes religieux de tous horizons, emprisonne les gens sans procès, certains dans des camps de concentration, les harcèle, les torture, les déporte par millions, cherche à éliminer des peuples entiers, les massacre et utilise même, à l’image des nazis qui ont massacré les Juifs, le concept de « solution finale » pour ceux qui sont persécutés.
Comment la Chine peut-elle se vanter d’être communiste alors même que le communisme n’est que l’autre nom servant à désigner des horreurs similaires au nazisme ?

 Élu président de la Commission doctrinale de l’épiscopat français en avril 2019, Mgr Laurent Camiade est évêque de Cahors. En qualité de pasteur, il estime que le célibat sacerdotal est bien plus qu’un simple règlement disciplinaire dans l’Église latine.
Élu président de la Commission doctrinale de l’épiscopat français en avril 2019, Mgr Laurent Camiade est évêque de Cahors. En qualité de pasteur, il estime que le célibat sacerdotal est bien plus qu’un simple règlement disciplinaire dans l’Église latine.