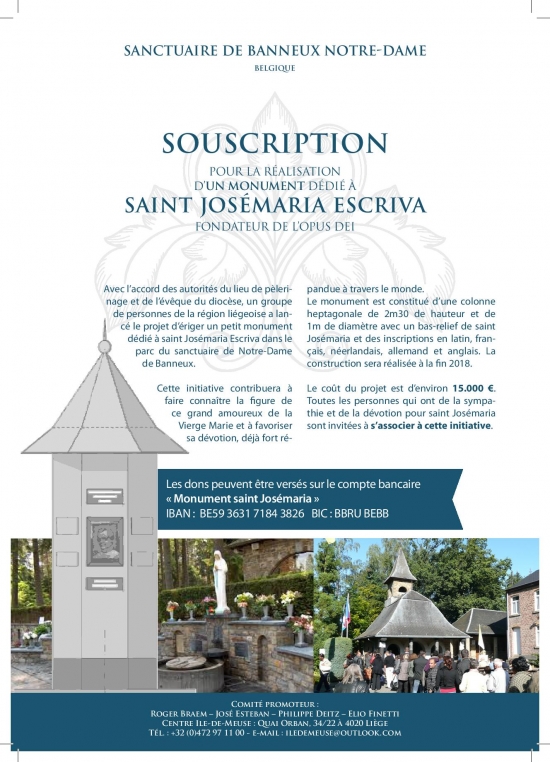De Sandro Magister ("L'Espresso") traduit sur le site Diakonos.be :
« Oremus » pour la paix au Moyen-Orient. Mais pour l’Ukraine, c’est la guerre entre les orthodoxes
Le Pape François a invité les chefs des églises du Moyen-Orient, catholiques, orthodoxes et protestants à une journée de prière commune pour la paix dans cette région, le 7 juillet à Bari.
Mais l’ombre d’un autre conflit en Orient plane sur ce sommet. Il s’agit du conflit qui se joue en Ukraine et qui fracture le monde orthodoxe de manière dramatique, avec d’un côté Bartholomée, le patriarche œcuménique de Constantinople et de l’autre Cyrille, le patriarche de Moscou « et de toutes les Russies ».
Bartholomée viendra à Bari. Mais pas Cyrille qui, lui, sera représenté par son responsable des relations extérieures, le métropolite Hilarion de Volokolamsk. Ce dernier vient il y a quelques jours de rejeter pour l’énième fois avec la plus grand fermeté l’idée de créer une Église orthodoxe autonome en Ukraine, allant jusqu’à dire que « le sang coulera » si jamais elle été légitimée et donc soustraite à la juridiction du patriarcat de Moscou. Et légitimée par qui ? Précisément par le patriarche de Constantinople, qui en aurait la faculté puisqu’il est traditionnellement le « primus inter pares » parmi tous les chefs de l’orthodoxie.
Il y a un mois, peu après la visite au Vatican du métropolite Hilarion, Settimo Cielo avait déjà fourni les données essentielles de la controverse qui, même si elle est avant tout interne à l’orthodoxie, implique fortement l’Église catholique elle-même, surtout depuis que le Pape François ai lourdement pris le parti de l’Église orthodoxe russe :
> En Ukraine, entre orthodoxes et catholiques, François se rallie à Moscou
Les communautés orthodoxes en Ukraine sont actuellement au nombre de trois. La seule à être canoniquement reconnue par toute l’orthodoxie, avec à sa tête le métropolite Onufry, est celle qui dépend du patriarcat de Moscou. Mais il y a également un patriarcat indépendant créé et toujours dirigé à l’heure actuelle par un autre ex-hiérarque de l’Église russe, Philarète. Et il y a enfin une autre Eglise orthodoxe ukrainienne autoproclamée, avec comme métropolite Méthode.
Depuis un certain temps, il y a en Ukraine une forte volonté de rassembler ces trois branches en une unique Eglise orthodoxe ukrainienne autocéphale qui serait non plus sous la houlette de Moscou mais sous celle du patriarche de Constantinople, Bartholomée.
Sur le terrain politique, le gouvernement de Kiev soutient lui aussi très activement l’idée de cette nouvelle Eglise orthodoxe autonome. Tout comme l’Eglise grecque-catholique ukrainienne, forte de 4 millions de fidèles, et son archevêque majeur Sviatoslav Shevchuk, que le Pape a reçu en audience il y a deux jours.
Mais l’un comme l’autre de ces soutiens externes ne font qu’accroître l’hostilité du patriarcat de Moscou contre toute cette opération. On est au courant de la guerre russo-ukrainienne. Quant aux grecs-catholiques, Hilarion a été jusqu’à les accuser de vouloir phagocyter la nouvelle structure en la transformant d’orthodoxe en catholique en voulant la placer sous l’autorité du Pape de Rome. Et François a pratiquement donné raison au puissant métropolite russe en le recevant au Vatican le 30 mai dernier, si l’on s’en tient à la sévère réprimande adressée ce jour-là par le Pape aux catholique ukrainiens qui « s’immiscent dans les affaires internes de l’Église orthodoxe russe ».
Aussi bien Bartholomée qu’Hilarion sont en train de passer le monde orthodoxe au peigne fin pour connaître la position de chaque Eglise et les rallier à leur cause. Le 7 juillet, tous deux se verront à Bari et deux jours plus tard, le patriarche de Constantinople sera à Moscou pour ce qui pourrait bien être le face à face décisif avec Cyrille.
A l’heure actuelle Bartholomée n’a toujours pas découvert son jeu, même s’il est évident que lui et ses plus proches collaborateurs – avec en tête le métropolite Jean de Pergame, l’un des plus grands théologiens vivants – ont la volonté de voir naître une Eglise orthodoxe ukrainienne unifiée et autonome.
Le patriarcat de Moscou n’a quant à lui jamais fait mystère de ses intentions. Il a déjà dit et répété de la manière la plus dure son « non » à l’opération. Et on peut comprendre ses raisons. L’Église ukrainienne sous la juridiction de Moscou compte un bon 40% des paroisses du patriarcat russe tout entier, soit 12.000 sur environ 30.000. Les perdre serait un drame pour Moscou. Et si un autre millier de paroisses provenant des deux autres Églises ukrainiennes existant actuellement venait s’y ajouter, la nouvelle Église orthodoxe unifiée deviendrait numériquement la deuxième Église orthodoxe au monde et serait à même de pouvoir rivaliser avec le patriarcat de Moscou, qui est à l’heure actuelle le premier par nombre des fidèles.
Et ce n’est pas tout. Il ressort d’un un sondage fiable que la création d’une Église orthodoxe unifiée et autonome recueille l’opinion favorable de 31,3% de la population tandis qu’il sont 19,8% à s’y opposer, 34,7% a y être indifférents et 14,2% à être sans opinion. Naturellement, avec des différences d’une région à l’autre, avec le plus grand nombre d’opinions favorables, soit 58%, à l’Ouest et le plus grand nombre d’opposants, soit 28,2%, à l’Est.
Même chez les 85 évêques de l’Église ukrainienne qui dépendent du patriarcat de Moscou, l’idée de se mettre à leur compte fait son chemin. Leur position officielle, adoptée à l’unanimité le 25 juin dernier, est que l’autocéphalie ne fait pas partie des objectifs actuels. Mais tout de suite après, à Athènes, alors qu’il rendait une visite officielle aux orthodoxes de Grèce, l’évêque Victor a précisé que « l’Église orthodoxe ukrainienne ne s’oppose pas catégoriquement à l’idée de l’autocéphalie ».
Une autocéphalie qui correspondrait en fait à l’état d’origine de l’Église orthodoxe ukrainienne si l’on s’en tient à la reconstruction historique réalisée par le métropolite Jean de Pergame, le « cerveau » théologique de Bartholomée, selon qui le passage de la métropole de Kiev de la juridiction de Constantinople à celle de Moscou en 1685 n’aurait été qu’une mesure provisoire et révocable.
Il est inutile d’ajouter que le patriarcat de Moscou a réagi violemment face à cette thèse en affirmant qu’elle était fausse.
En plus de la paix au Moyen-Orient, espérons qu’à Bari il faudrait peut-être prier discrètement pour davantage de paix au sein de l’orthodoxie.
Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.