Alors qu'au Vatican on semble s'obstiner à vouloir obtenir à tout prix un accord avec le gouvernement chinois, la répression contre les chrétiens s'intensifie en Chine, particulièrement dans la province de Henan : du site EDA des Missions Etrangères de Paris :
La liberté religieuse à nouveau menacée dans la province de Henan
Les chrétiens de la province de Henan, dans le centre-est de la Chine, craignent l’arrivée d’une nouvelle répression après avoir été interdits d’afficher les traditionnels distiques ou couplets (poèmes composés de deux vers), du nouvel an chinois, affichés devant les maisons chaque année.
Les chrétiens de la province de Henan ont été interdits, cette année, d’afficher les traditionnels distiques (poésies formées de deux vers) à l’occasion du nouvel an chinois. Les autorités ont visité les villages et les villes de la province pour ordonner aux gens de ne pas continuer, cette année, cette pratique devenue traditionnelle durant le festival. Les catholiques locaux s’inquiètent d’une nouvelle répression de la liberté religieuse dans la province.
Ces distiques, ou couplets, formés de caractères noirs et or sur papier rouge, sont affichés verticalement sur les portes des maisons, avec un parchemin composé de quatre caractères fixés au-dessus. Ces poèmes expriment la joie populaire durant le festival et l’espoir d’une vie meilleure durant l’année à venir.
Le père Peter confie qu’il a vu des chefs de villages interdire les catholiques d’afficher ces couplets dans la ville de Xuliang, dans le comté de Bo’ai de la province de Henan. « Ils criaient dans la rue en diffusant des tracts à toutes les familles catholiques. J’ai demandé à l’un d’entre eux : ‘Quand l’article 36 de la constitution chinoise a-t-il été réécrit pour restreindre la liberté religieuse ?’ Il s’est contenté de continuer sans me répondre. » Le prêtre, qui officie dans la région, ajoute : « La situation est plus tendue cette année, ainsi que la situation des libertés religieuses. »
« La situation est plus tendue cette année »
Ses proches, qui travaillent pour les autorités municipales, lui ont dit que ces tracts ont été distribués dans plusieurs villes. Selon le père Peter, les quelques catholiques de la région sont éparpillés dans plusieurs communautés. Leur influence est donc assez faible et ils n’ont aucun moyen de s’opposer à cette interdiction : « Les croyants s’inquiètent aussi de devoir faire face à des représailles s’ils ignorent l’interdiction. » Le père John, du diocèse de Puyang, affirme que les catholiques de sa région n’ont reçu que des ordres de vive voix, et non des interdictions écrites.
Thomas, un catholique de la province, précise qu’il s’agit d’une violation de la constitution qui protège la liberté religieuse. Il s’inquiète que la province de Henan doive à son tour, cette année, faire face à une répression religieuse, d’autres problèmes du même type ayant déjà eu lieu. Une source du diocèse de Luoyang explique que les petites assemblées, dans le cadre des rassemblements non enregistrés, sont interdites – en particulier concernant les Églises protestantes.
Un prêtre, qui a demandé à rester anonyme, confie qu’une petite église du village de Gao Mao « a été sanctionnée par les autorités qui ont noté, en visitant le village, beaucoup de problèmes de sécurité ».Pour lui, il s’agit d’une excuse pour pouvoir agir, car l’église n’avait pas été enregistrée auprès du gouvernement pour des activités religieuses. Le prêtre explique que les autorités ont visité beaucoup de lieux avant le nouvel an chinois « en demandant aux prêtres de présenter leurs cartes d’immatriculation, faute de quoi ils ne pourront organiser aucune célébration à l’avenir ». Il pense que la province de Henan est la nouvelle cible du gouvernement, parce qu’elle abrite des protestants, des bouddhistes, des catholiques, des musulmans et des taoïstes.
Le père John, du diocèse d’Anyang, dans la province de Henan, confirme qu’il a été demandé à son diocèse « qu'aucun catholique n’était autorisé », spécifiant que « les classes de mineurs, en particulier, étaient absolument interdites ». De plus, le Parti Communiste a interdit l’entrée dans les églises à tous les fonctionnaires, les enseignants et les étudiants. Le père John ajoute que les temples protestants de la province semblent être la cible principale, parce que le gouvernement craint un nombre croissant de baptêmes : « Indirectement, l’Église catholique est victime de cette répression. »
(Ucanews, Hong-Kong)

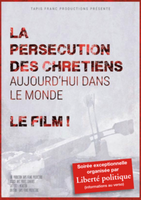



 Mgr Fridolin Ambongo, nommé par le Pape archevêque coadjuteur de Kinshasa, au côté de Mgr Laurent Monsengwo, a indiqué dans une interview à la Deutsche Welle diffusée vendredi qu’il était dans la droite ligne du cardinal. Un article de Marie-France Cros sur le site de « La Libre Afrique » :
Mgr Fridolin Ambongo, nommé par le Pape archevêque coadjuteur de Kinshasa, au côté de Mgr Laurent Monsengwo, a indiqué dans une interview à la Deutsche Welle diffusée vendredi qu’il était dans la droite ligne du cardinal. Un article de Marie-France Cros sur le site de « La Libre Afrique » : " Aujourd’hui, les chrétiens du Proche-Orient sont confrontés à des défis si redoutables qu’on peut les qualifier d’existentiels car c’est la survie du christianisme lui-même dans les territoires marqués par l’histoire biblique qui est en jeu. Face à ces épreuves, nos frères orientaux manifestent à la face du monde un héroïsme impressionnant et admirable. Les témoignages abondent. Des familles entières et nombre de religieux ont préféré tout quitter, tout perdre, y compris parfois la vie, pour ne pas renier leur foi en Jésus-Christ. Les médias nous renvoient les images d’une ferveur inhabituelle. Le contraste est frappant avec l’atrophie spirituelle de l’Europe post-chrétienne.
" Aujourd’hui, les chrétiens du Proche-Orient sont confrontés à des défis si redoutables qu’on peut les qualifier d’existentiels car c’est la survie du christianisme lui-même dans les territoires marqués par l’histoire biblique qui est en jeu. Face à ces épreuves, nos frères orientaux manifestent à la face du monde un héroïsme impressionnant et admirable. Les témoignages abondent. Des familles entières et nombre de religieux ont préféré tout quitter, tout perdre, y compris parfois la vie, pour ne pas renier leur foi en Jésus-Christ. Les médias nous renvoient les images d’une ferveur inhabituelle. Le contraste est frappant avec l’atrophie spirituelle de l’Europe post-chrétienne.