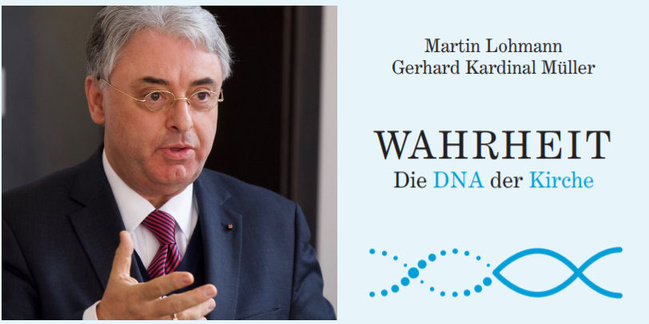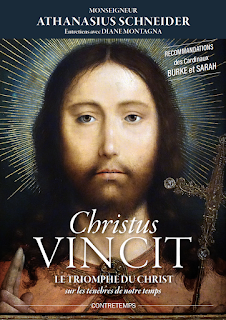De sur le site Orthodoxie.com (publié lors de la première vague de la pandémie, le 8 avril 2020) :
L’origine, la nature et le sens de la pandémie actuelle. Une interview de Jean-Claude Larchet
Jean-Claude Larchet, vous êtes un des premiers à avoir développé une réflexion théologique sur la maladie, la souffrance, la médecine. Votre livre « Théologie de la maladie » paru en 1991 a été traduit en de nombreuses langues, et en relation avec l’épidémie du covid-19, il va paraître prochainement en traduction japonaise. Vous avez publié aussi une réflexion sur la souffrance : « Dieu ne veut pas la souffrance des hommes », qui a paru également dans divers pays.
Tout d’abord quelle est votre opinion générale sur l’épidémie que nous connaissons actuellement ?
Je n’en suis pas étonné : il y a, depuis des millénaires, environ deux grandes épidémies par siècle, et plusieurs autres épidémies de moindre importance. Leur fréquence s’accroît cependant de plus en plus, et la concentration de population dans notre civilisation urbaine, la circulation favorisée par la mondialisation, ainsi que la multiplicité et la rapidité des moyens de transport modernes les transforment facilement en pandémies. La présente épidémie était donc prévisible, et annoncée par de nombreux épidémiologistes qui ne doutaient pas de sa venue, ignorant seulement le moment précis où elle surviendrait et la forme qu’elle prendrait. Ce qui est surprenant, c’est le manque de préparation de certains États (l’Italie, l’Espagne et la France notamment), qui au lieu de prévoir le personnel médical, les structures hospitalières et le matériel nécessaire pour affronter le fléau, ont laissé se dégrader l’hôpital et laissé externaliser (en Chine, comme tout le reste) la production de médicaments, de masques, de respirateurs, dont on manque aujourd’hui cruellement.
Les maladies sont omniprésentes dans l’histoire de l’humanité, et il n’est pas d’homme qui ne les rencontre pas au cours de sa vie. Les épidémies sont simplement des maladies qui sont particulièrement contagieuses et se répandent rapidement jusqu’à atteindre une part importante de la population. La caractéristique du virus covid-19 est qu’il affecte gravement le système respiratoire des personnes âgées ou fragilisées par d’autres pathologies, et qu’il a un haut degré de contagiosité qui sature rapidement les systèmes de soins intensifs par le grand nombre de personnes atteintes simultanément dans un court laps de temps.
Les Églises orthodoxes ont réagi par étapes, à des vitesses et sous des formes variables. Qu’en pensez-vous ?
Il faut dire que les différents pays n’ont pas été atteints par l’épidémie au même moment ni au même degré, et chaque Église locale a adapté sa réaction à l’évolution de la maladie et aux mesures prises par les États. Dans les pays les plus atteints, la décision d’arrêter la célébration des offices a été prise rapidement, à quelques jours de différence seulement. Ne prévoyant pas un tel arrêt dans l’immédiat, certaines Églises (comme l’Église russe) ont pris des mesures pour limiter la contamination possible au cours des services liturgiques ou de la dispensation des sacrements ; aujourd’hui elles sont contraintes de demander aux fidèles de ne pas venir à l’église.