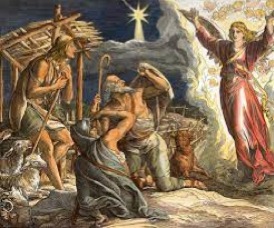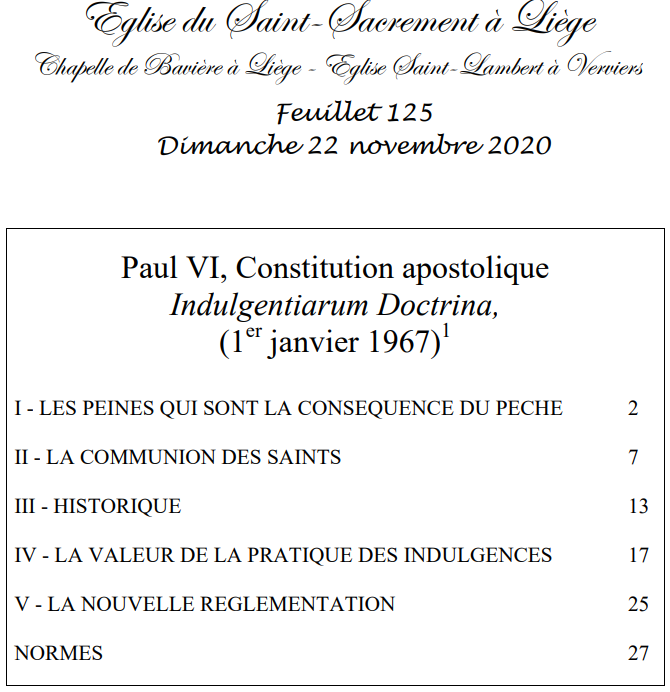Lu sur le site web du bimensuel « L’Homme Nouveau » :
« L’interdiction actuelle d’assister à la messe, les manifestations pour demander son rétablissement, les réactions de certains évêques, révèlent une crise beaucoup plus profonde sur ce qu’est réellement la messe et la sainte eucharistie. Une crise qui n’est pas nouvelle et dont les manifestations les plus fortes sont apparues après le Concile Vatican II et qui sont le fruit d’une mauvais enseignement de la foi, d’une conception moderniste et de ce que Benoît XVI a dénoncé sous le terme de relativisme.
Dans le Figaro (23 novembre), Jean-Marie Guénois constate que cette crise touche jusqu’au plus haut de la hiérarchie de l’Église :
« Il existe une division plus profonde dans l’Église. Elle n’est pas tactique, mais théologique. Elle porte sur la foi en « l’eucharistie », à savoir l’hostie consacrée donnée lors de la communion.
Les catholiques - on le constate avec cette crise, tous n’y croient pas vraiment - sont avec les orthodoxes et certains protestants luthériens [point à nuancer, ndlrHN], les seuls à croire dans « la présence réelle ». C’est-à-dire en la « présence du Christ », sous « les espèces consacrées » du pain et du vin, par le prêtre, lors de la messe. Ce sont ces « hosties consacrées » qui sont données comme une nourriture lors de la communion et qui sont ensuite conservées dans le tabernacle. Selon leur foi, « l’eucharistie », c’est « Dieu qui est présent ».
Un évêque très au fait des débats internes à l’épiscopat quand il s’est agi, pour l’Église catholique, d’aller ou non plaider le retour de la messe en public au Conseil d’État, ou de se déterminer pour les manifestations de rue, s’est dit « douloureusement » étonné de constater « une foi catholique eucharistique théologiquement divergente » jusque chez les évêques. Un état de fait qui reflète un débat tabou dans l’Église catholique : une partie des théologiens, prêtres, évêques et certains cardinaux, a épousé les thèses du protestantisme qui considère la « présence » eucharistique du Christ comme « symbolique » et non « réelle ». Donc non absolument « sacrée » au point de se battre pour elle.
La grande surprise, dans ce registre, est venue de Rome cette semaine. Et d’un futur cardinal - il le deviendra le 29 novembre - choisi par le pape François pour piloter l’important synode des évêques. Mi-novembre, il a taxé ceux qui se plaignaient de ne pouvoir accéder à la messe « d’analphabétisme spirituel » dans la revue jésuite de référence mondiale, La Civilta Cattolica. Il a demandé à l’Église de profiter de cette crise pour rompre avec une pastorale visant à « conduire au sacrement » pour passer, « par les sacrements, à la vie chrétienne ».
Un cardinal très proche du pape, relativisant l’importance de la messe… Ces propos ont choqué beaucoup d’évêques mais pas tous. Une partie de l’Église catholique doute sur la foi eucharistique, qui est pourtant l’un de ses fondements ».
Ref.« Ils » ne croient plus dans la sainte eucharistie
Une vieille tentation qui émerge avec le nominalisme au XIIe siècle, enflamme la Réforme protestante au XVIe et repasse les plats avec la crise moderniste contemporaine : une sorte d’épidémie récurrente qui n’a pas encore trouvé son vaccin.
JPSC