De BENOÎT XVI, lors de l'AUDIENCE GÉNÉRALE du mercredi 10 février 2010 (source) :
Chers frères et sœurs,
Il y a deux semaines, j'ai présenté la figure de saint François d'Assise. Ce matin, je voudrais parler d'un autre saint, appartenant à la première génération des Frères mineurs: Antoine de Padoue ou, comme il est également appelé, de Lisbonne, en référence à sa ville natale. Il s'agit de l'un des saints les plus populaires de toute l'Eglise catholique, vénéré non seulement à Padoue, où s'élève une splendide basilique qui conserve sa dépouille mortelle, mais dans le monde entier. Les images et les statues qui le représentent avec le lys, symbole de sa pureté, ou avec l'Enfant Jésus dans les bras, en souvenir d'une apparition miraculeuse mentionnée par certaines sources littéraires, sont chères aux fidèles.
Antoine a contribué de façon significative au développement de la spiritualité franciscaine, avec ses dons marqués d'intelligence, d'équilibre, de zèle apostolique et principalement de ferveur mystique.
Il naquit à Lisbonne dans une famille noble, aux alentours de 1195, et fut baptisé sous le nom de Fernando. Il entra chez les chanoines qui suivaient la Règle monastique de saint Augustin, d'abord dans le monastère Saint-Vincent à Lisbonne, et successivement dans celui de la Sainte-Croix à Coïmbra, centre culturel de grande renommée au Portugal. Il se consacra avec intérêt et sollicitude à l'étude de la Bible et des Pères de l'Eglise, acquérant une science théologique qu'il mit à profit dans son activité d'enseignement et de prédication. A Coïmbra eut lieu l'épisode qui marqua un tournant décisif dans sa vie: c'est là qu'en 1220, furent exposés les reliques des cinq premiers missionnaires franciscains, qui s'étaient rendus au Maroc, où ils avaient subi le martyre. Leur vie suscita chez le jeune Fernando le désir de les imiter et d'avancer sur le chemin de la perfection chrétienne: il demanda alors de quitter les chanoines augustins et de devenir Frère mineur. Sa requête fut acceptée et, ayant pris le nom d'Antoine, il partit lui aussi pour le Maroc, mais la Providence divine en décida autrement. A la suite d'une maladie, il fut contraint de rentrer en Italie et, en 1221, participa au célèbre « Chapitre des nattes » à Assise, où il rencontra également saint François. Par la suite, il vécut pendant quelques temps caché de la manière la plus totale dans un couvent près de Forlì, au nord de l'Italie, où le Seigneur l'appela à une autre mission. Invité, dans des conditions fortuites, à prêcher à l'occasion d'une ordination sacerdotale, il se révéla être doté d'une telle science et éloquence que ses supérieurs le destinèrent à la prédication. C'est ainsi que commença en Italie et en France une activité apostolique si intense et efficace qu'elle conduisit de nombreuses personnes qui s'étaient détachées de l'Eglise à revenir sur leurs pas. Antoine fut également parmi les premiers maîtres de théologie des Frères mineurs, sinon le premier. Il commença son enseignement à Bologne, avec la bénédiction de saint François, qui, reconnaissant les vertus d'Antoine, lui envoya une brève lettre qui commençait par ces paroles: « Il me plaît que tu enseignes la théologie aux frères ». Antoine posa les bases de la théologie franciscaine qui, cultivée par d'autres éminentes figures de penseurs, devait connaître son apogée avec saint Bonaventure de Bagnoregio et le bienheureux Duns Scot.
Devenu supérieur provincial des Frères mineurs du nord de l'Italie, il poursuivit son ministère de la prédication, l'alternant avec des charges de gouvernement. Ayant conclu la charge de provincial, il se retira près de Padoue, où il s'était déjà rendu trois fois. A peine un an après, il mourut aux portes de la Ville, le 13 juin 1231. Padoue, qui l'avait accueilli avec affection et vénération pendant sa vie, lui rendit pour toujours honneur et dévotion. Le Pape Grégoire IX lui-même, qui, après l'avoir écouté prêcher, l'avait défini « Arche du Testament », le canonisa un an seulement après sa mort, en 1232, notamment à la suite de miracles survenus par son intercession.
Au cours de la dernière période de sa vie, Antoine écrivit deux cycles de « Sermons », intitulés respectivement « Sermons du dimanche » et « Sermons sur les saints », destinés aux prêcheurs et aux enseignants des études théologiques de l'Ordre franciscain. Dans ces Sermons, il commente les textes de l'Ecriture présentés par la Liturgie, en utilisant l'interprétation patristique et médiévale des quatre sens, le sens littéral ou historique, le sens allégorique ou christologique, le sens tropologique ou moral, et le sens anagogique, qui conduit vers la vie éternelle. Aujourd'hui, on redécouvre que ces sens sont des dimensions de l'unique sens de l'Ecriture Sainte et qu'il est juste d'interpréter l'Ecriture Sainte en recherchant les quatre dimensions de sa parole. Ces Sermons de saint Antoine sont des textes théologiques et homilétiques, qui rappellent la prédication vivante, dans lesquels Antoine propose un véritable itinéraire de vie chrétienne. La richesse d'enseignements spirituels contenue dans les « Sermons » est telle que le vénérable Pape Pie XII, en 1946, proclama Antoine Docteur de l'Eglise, lui attribuant le titre de « Docteur évangélique », car de ces écrits émanent la fraîcheur et la beauté de l'Evangile; aujourd'hui encore, nous pouvons les lire avec un grand bénéfice spirituel.
Dans ces Sermons, saint Antoine parle de la prière comme d'une relation d'amour, qui pousse l'homme à un dialogue affectueux avec le Seigneur, créant une joie ineffable, qui enveloppe doucement l'âme en prière. Antoine nous rappelle que la prière a besoin d'une atmosphère de silence, qui ne coïncide pas avec le détachement du bruit extérieur, mais qui est une expérience intérieure, qui vise à éliminer les distractions provoquées par les préoccupations de l'âme, en créant le silence dans l'âme elle-même. Selon l'enseignement de cet éminent Docteur franciscain, la prière s'articule autour de quatre attitudes indispensables, qui, dans le latin d'Antoine, sont définies ainsi: obsecratio, oratio, postulatio, gratiarum actio. Nous pourrions les traduire de la façon suivante: ouvrir avec confiance son cœur à Dieu; tel est le premier pas de la prière: pas simplement saisir une parole, mais ouvrir son cœur à la présence de Dieu; puis s'entretenir affectueusement avec Lui, en le voyant présent avec moi; et – chose très naturelle – lui présenter nos besoins; enfin, le louer et lui rendre grâce.
Dans cet enseignement de saint Antoine sur la prière, nous saisissons l'un des traits spécifiques de la théologie franciscaine, dont il a été l'initiateur, c'est-à-dire le rôle assigné à l'amour divin, qui entre dans la sphère affective, de la volonté, du cœur et qui est également la source d'où jaillit une connaissance spirituelle, qui dépasse toute connaissance. En effet, lorsque nous aimons, nous connaissons.
Antoine écrit encore: « La charité est l'âme de la foi, elle la rend vivante; sans l'amour, la foi meurt » (Sermones, Dominicales et Festivi, II, Messaggero, Padoue 1979, p. 37).
Seule une âme qui prie peut accomplir des progrès dans la vie spirituelle: tel est l'objet privilégié de la prédication de saint Antoine. Il connaît bien les défauts de la nature humaine, notre tendance à tomber dans le péché, c'est pourquoi il exhorte continuellement à combattre la tendance à l'avidité, à l'orgueil, à l'impureté, et à pratiquer au contraire les vertus de la pauvreté et de la générosité, de l'humilité et de l'obéissance, de la chasteté et de la pureté. Aux débuts du XIIIe siècle, dans le cadre de la renaissance des villes et du développement du commerce, le nombre de personnes insensibles aux besoins des pauvres augmentait. Pour cette raison, Antoine invite à plusieurs reprises les fidèles à penser à la véritable richesse, celle du cœur, qui rend bons et miséricordieux, fait accumuler des trésors pour le Ciel. « O riches – telle est son exhortation – prenez pour amis... les pauvres, accueillez-les dans vos maisons: ce seront eux, les pauvres, qui vous accueilleront par la suite dans les tabernacles éternels, où résident la beauté de la paix, la confiance de la sécurité, et le calme opulent de l'éternelle satiété » (ibid., n. 29).
N'est-ce pas là, chers amis, un enseignement très important aujourd'hui également, alors que la crise financière et les graves déséquilibres économiques appauvrissent de nombreuses personnes et créent des conditions de pauvreté? Dans mon encyclique Caritas in veritate, je rappelle: « Pour fonctionner correctement, l'économie a besoin de l'éthique; non pas d'une éthique quelconque, mais d'une éthique amie de la personne » (n. 45).
Antoine, à l'école de François, place toujours le Christ au centre de la vie et de la pensée, de l'action et de la prédication. Il s'agit d'un autre trait typique de la théologie franciscaine: le christocentrisme. Celle-ci contemple volontiers, et invite à contempler les mystères de l'humanité du Seigneur, l'homme Jésus, de manière particulière le mystère de la Nativité, Dieu qui s'est fait Enfant, qui s'est remis entre nos mains: un mystère qui suscite des sentiments d'amour et de gratitude envers la bonté divine.
D'une part la Nativité, un point central de l'amour du Christ pour l'humanité, mais également la vision du Crucifié inspire à Antoine des pensées de reconnaissance envers Dieu et d'estime pour la dignité de la personne humaine, de sorte que tous, croyants et non croyants, peuvent trouver dans le crucifié et dans son image une signification qui enrichit la vie. Saint Antoine écrit: « Le Christ, qui est ta vie, est accroché devant toi, pour que tu regardes dans la croix comme dans un miroir. Là tu pourras voir combien tes blessures furent mortelles, aucune médecine n'aurait pu les guérir, si ce n'est celle du sang du Fils de Dieu. Si tu regardes bien, tu pourras te rendre compte à quel point sont grandes ta dignité humaine et ta valeur... En aucun autre lieu l'homme ne peut mieux se rendre compte de ce qu'il vaut, qu'en se regardant dans le miroir de la croix » (Sermones Dominicales et Festivi III, pp. 213-214).
En méditant ces paroles nous pouvons mieux comprendre l'importance de l'image du Crucifix pour notre culture, pour notre humanisme né de la foi chrétienne. C'est précisément en regardant le Crucifié que nous voyons, comme le dit saint Antoine, à quel point est grande la dignité humaine et la valeur de l'homme. En aucun autre lieu on ne peut comprendre combien vaut l'homme, pourquoi précisément Dieu nous rend aussi importants, nous voit aussi importants, au point d'être, pour Lui, dignes de sa souffrance; ainsi toute la dignité humaine apparaît dans le miroir du Crucifié et le regard vers Lui est toujours une source de reconnaissance de la dignité humaine.
Chers amis, puisse Antoine de Padoue, si vénéré par les fidèles, intercéder pour l'Eglise entière, et surtout pour ceux qui se consacrent à la prédication; prions le Seigneur afin qu'il nous aide à apprendre un peu de cet art de saint Antoine. Que les prédicateurs, en tirant leur inspiration de son exemple, aient soin d'unir une solide et saine doctrine, une piété sincère et fervente, une communication incisive. En cette année sacerdotale, prions afin que les prêtres et les diacres exercent avec sollicitude ce ministère d'annonce et d'actualisation de la Parole de Dieu aux fidèles, en particulier à travers les homélies liturgiques. Que celles-ci soient une présentation efficace de l'éternelle beauté du Christ, précisément comme Antoine le recommandait: « Si tu prêches Jésus, il libère les cœurs durs; si tu l'invoques, il adoucit les tentations amères; si tu penses à lui, il illumine ton cœur; si tu le lis, il comble ton esprit » (Sermones Dominicales et Festivi, p. 59).
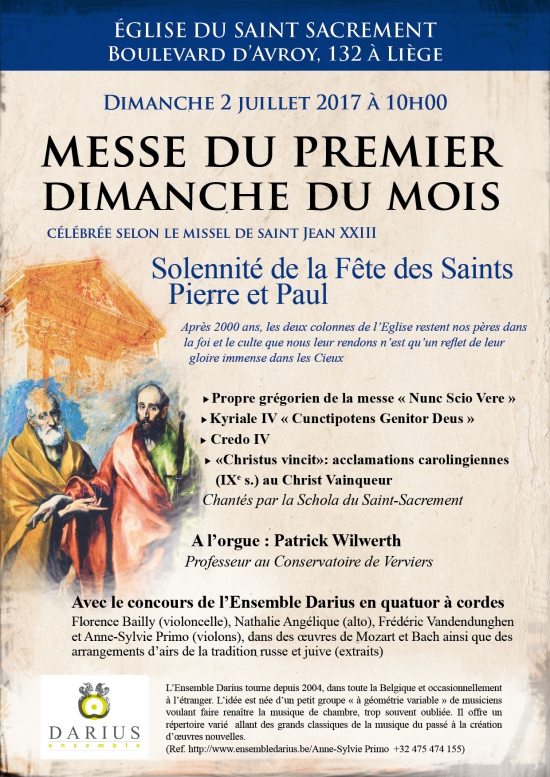

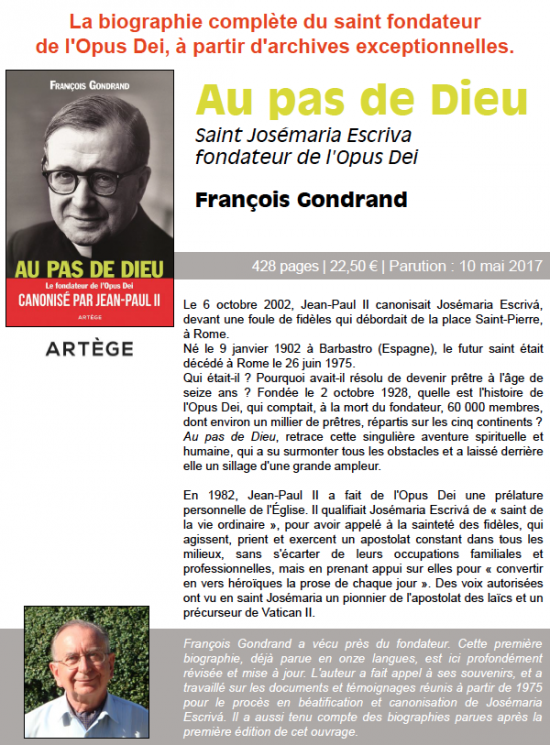




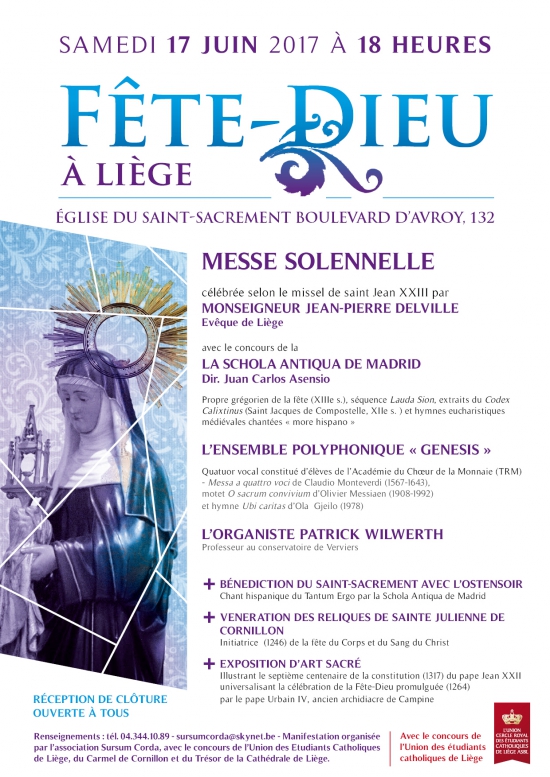








 "
"

 Dirigée depuis 1997 par Olga Roudakova, sa branche féminine, Voix de femmes, rassemble une douzaine de chanteuses de nationalités et formations musicales variées, couronnées des prix décernés par divers conservatoires et concours musicaux. Multipliant les concerts et tournées internationales, l’Ensemble s’est produit, notamment, aux Festivals de Musique Sacrée de la Ville de Paris ou « Voix et Route romane » à Strasbourg , au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers , aux Festivals internationaux de Chant Grégorien du Luxembourg, de Watou (Belgique) ou de Tomar (Portugal), aux Estivales de l’Orgue à Rennes, au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers et d’année en année à Saint-Pétersbourg (Russie). Depuis 2004 les « Voix de femmes » résident à l’église Saint-Germain l’Auxerrois de Paris pour y animer les messes grégoriennes de dimanche soir.
Dirigée depuis 1997 par Olga Roudakova, sa branche féminine, Voix de femmes, rassemble une douzaine de chanteuses de nationalités et formations musicales variées, couronnées des prix décernés par divers conservatoires et concours musicaux. Multipliant les concerts et tournées internationales, l’Ensemble s’est produit, notamment, aux Festivals de Musique Sacrée de la Ville de Paris ou « Voix et Route romane » à Strasbourg , au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers , aux Festivals internationaux de Chant Grégorien du Luxembourg, de Watou (Belgique) ou de Tomar (Portugal), aux Estivales de l’Orgue à Rennes, au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers et d’année en année à Saint-Pétersbourg (Russie). Depuis 2004 les « Voix de femmes » résident à l’église Saint-Germain l’Auxerrois de Paris pour y animer les messes grégoriennes de dimanche soir.  des week-ends consacrés à des formations thématiques de perfectionnement dont la direction est
des week-ends consacrés à des formations thématiques de perfectionnement dont la direction est