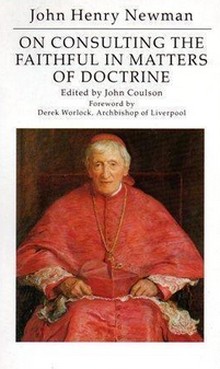De Jean-Pierre Denis, directeur de l’hebdomadaire « La Vie » :
 « Aux hargneux, aux anxieux et aux pointilleux du laïcisme, donnons raison sur un point : le discours qu’Emmanuel Macron a prononcé lundi soir au Collège des Bernardins à l’invitation de la Conférence des évêques de France fera date. Il décrispe les relations entre l’Église catholique et l’État et il déplace l’axe de la laïcité. Après les désillusions de la présidence bling-bling et les tensions de la présidence sociétale, les Bernardins ouvrent l’ère de la considération. À bon droit, les responsables catholiques affichaient, en fin de soirée, une mine réjouie. Ils ont réussi leur opération de communication, peut-être mieux qu’ils ne l’auraient cru. On passe de la fausse ignorance à la reconnaissance distante.
« Aux hargneux, aux anxieux et aux pointilleux du laïcisme, donnons raison sur un point : le discours qu’Emmanuel Macron a prononcé lundi soir au Collège des Bernardins à l’invitation de la Conférence des évêques de France fera date. Il décrispe les relations entre l’Église catholique et l’État et il déplace l’axe de la laïcité. Après les désillusions de la présidence bling-bling et les tensions de la présidence sociétale, les Bernardins ouvrent l’ère de la considération. À bon droit, les responsables catholiques affichaient, en fin de soirée, une mine réjouie. Ils ont réussi leur opération de communication, peut-être mieux qu’ils ne l’auraient cru. On passe de la fausse ignorance à la reconnaissance distante.
Le discours d'Emmanuel Macron au Collège des Bernardins
Fausse ignorance, car la République n’a jamais pu complètement nier le christianisme. La loi de 1905 ne « reconnaît » aucun culte, selon son célèbre article 2, mais elle monte à l’échelle pour régler la sonnerie des cloches. Aumôneries de prison, enseignement sous contrat, jours fériés… les liens sont variés. Et cependant la reconnaissance selon Macron reste distante. Sous les voûtes médiévales, on n’a d’ailleurs noté aucun geste concret. Ni sur les migrants, où le Président se tient droit dans ses bottes. Ni sur la bioéthique, où sa majorité sinue avec une trouble habileté. Ni sur les inégalités, ni… On l’aura compris : la causerie n’engage que ceux qui sont sensibles à la flatterie. Et après tout, c’est bien normal, car dans un État laïque, le Président reste légitimement libre. Au moins peut-on se parler, ce qui est un progrès ou bien un retour à la raison.
Le Président invite les catholiques à redevenir eux-mêmes, assumant une histoire exemplaire et un présent contributif. Rarement, on leur a si clairement signifié que la France a besoin d’eux, y compris en politique. Cela fait un bien fou. Vous me direz qu’ils n’ont pas attendu la permission de Jupiter pour s’épanouir. Parfois pourtant, s’excusant de s’excuser, ils semblent raser les murs et porter fardeau. Ou alors ils tombent par réaction dans l’excès inverse, entre vice identitaire et délire de persécution. Si la rencontre des Bernardins marque rupture, c’est bien pour cela, comme une sortie de ce faux dilemme. Le cœur du discours tient dans une expression que Macron s’est retenu de prononcer, et que l’on entend pourtant : « N’ayez pas peur ! » Il fait écho au « France, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ? » lancé en 1980 par Jean Paul II, et qui fut d’ailleurs diversement apprécié.
La contradiction ou la contrainte de Macron est de dénoncer le relativisme, mais de s’y inscrire au nom des « évolutions de la société », ce concept mou.
Macron convoque le syndicalisme chrétien, les Justes, le père Hamel… Son discours fourmille d’évocations exaltantes et de références pertinentes à la réalité du terrain. En parole et presque sans omission, il adresse le salut de la Nation aux curés et aux religieuses, aux contemplatifs et aux caritatifs, aux penseurs d’hier, aux écrivains d’aujourd’hui, à Benoît et à François… Tout l’enjeu sera de réduire l’écart entre mots et action. Le Président des Bernardins n’est-il point ce chef d’État qui dînait la veille encore au Louvre avec le prince saoudien pour lui vendre des armes dont il fera si bon usage ? Qui aura entendu des allocutions comparables, par exemple à l’occasion des 500 ans de la Réforme, ne pourra qu’en saluer cette fois encore l’ambition spirituelle, littéraire, intellectuelle. Tout le monde critique l’aplatissement du discours politique.
Reconnaissons ici la hauteur de vue. Mais ensuite ? Peut-on convoquer le personnalisme sans en tirer les conséquences quant aux maux de l’individualisme ? La contradiction ou la contrainte de Macron est de dénoncer le relativisme, mais de s’y inscrire au nom des « évolutions de la société », ce concept mou. Le Président a compris que la France avait besoin de retrouver un corps et une âme, mais sa politique ne s’accorde pas toujours. Jusqu’où ce grand écart est-il tenable ? C’est aussi cette question qui reste, à tête reposée, après le moment inspiré des Bernardins. »
Ref. Catholiques, n'ayez plus peur !
Une chose est d’inviter, par un discours bienveillant, l’Eglise catholique à apporter, sans complexe, sa contribution à la vie en société, une autre de la reconnaître sur le plan légal comme un acteur à part entière de la vie publique, auquel l’Etat accorde son aide et sa coopération.
L’article 1er de la constitution française de 1958 proclame que la France est un Etat laïc, sans définir ce qu’il entend par là.
Rien n’est simple. Ainsi, le concept de laïcité n’est pas forcément synonyme de séparation des Eglises et de l’Etat. De ce point de vue même, la célèbre loi de 1905 expulsant l’Eglise de la sphère publique française n’a pas empêché la République d’entretenir des liens avec elle : loi sur les édifices publics mis à la disposition du culte (1907), rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège (1921), applicabilité du concordat de 1801 en Alsace-Moselle (1925), loi Debré sur les rapports entre l’Etat et les établissements scolaires privés (1959), accord avec le Saint-Siège sur la reconnaissance des diplômes délivrés par l’enseignement supérieur catholique (2008) etc.
Ajoutant à la perplexité de l’observateur étranger, le Président Nicolas Sarkozy, lors de sa réception paradoxale (pour le Chef d’un Etat séparé de l’Eglise) comme chanoine honoraire de l’archi-basilique du Latran à Rome (2007), a appelé de ses vœux l’avènement d’une laïcité positive reconnaissant que les religions constituent un atout sociétal et aujourd’hui (2018) le Président Macron lui emboîte allégrement le pas dans son discours au Collège des Bernardins.
Faut-il aller plus loin ?
En Belgique, l’Etat n’est pas laïc en ce sens qu’il serait porteur de valeurs publiques transcendant les religions privées, ni obligatoirement agnostique devant le phénomène religieux. Parler de séparation des cultes et de l’Etat serait inapproprié, si l’on entend par là que ceux-ci n’ont rien à voir ensemble. Les dispositions constitutionnelles et légales organisent plutôt une certaine indépendance dans le respect mutuel, et même un peu plus.
On comprend aussi pourquoi la neutralité des pouvoirs publics n’est pas mentionnée, comme telle, dans la constitution même si certains la déduisent de l’interdiction des discriminations et du principe d’égalité qui y sont inscrits : face à la pluralité des religions, cette neutralité est en effet toute relative puisque l’Etat (et à sa suite les autres pouvoirs publics) soutient le libre développement des activités religieuses et apporte son aide et sa protection légale à sept cultes (laïcité comprise) qu’il subsidie et dont il rémunère les ministres : il faut donc, à tout le moins, parler d’une neutralité « positive ».
En Europe, comme ailleurs, le statut des cultes varie et l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise que :
- « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres » ;
-« L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles » ;
-« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations ».
Il en résulte que :
- de la laïcité de l’Etat (France) aux religions d’Etat (Danemark, Grèce, Norvège, Royaume-Uni), en passant par les régimes concordataires (du type espagnol, italien, polonais, portugais, allemand, alsacien-mosellan) ou sui generis (comme en Belgique ou en Irlande), l’Union européenne respecte et s’accommode des divers statuts conférés aux cultes par les droits nationaux de ses Etats membres ;
- dans sa propre relation avec les cultes, l’Union est plus proche du modèle belge que de la laïcité républicaine à la française : celle-ci demeure une exception historiquement datée et sans doute appelée à évoluer.
Il est intéressant de noter que, dans son allocution au Collège des Bernardins, Emmanuel Macron a clairement rejeté le concept archaïque selon lequel la laïcité française serait une sorte de religion d'Etat civique transcendant, à l'image de celle de la Rome antique, toutes les religions privées tolérées par l'empire. Ce concept ne s'appuie d’ailleurs sur aucun texte légal. "Comme chef de l’État, a déclaré le Président de la France, je suis garant de la liberté de croire et de ne pas croire, mais je ne suis ni l’inventeur ni le promoteur d’une religion d’État substituant à la transcendance divine un credo républicain".
Plus outre, la question pourrait être posée d’une révision de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’ Etat stipulant que la République « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (art. 2). Mais ceci est une autre histoire : déclencher une nouvelle guerre de religion avec l'idéologie laïque pour obtenir une forme de reconnaissance légale ouvrant un droit à l'aide du pouvoir séculier suppose d'évaluer au préalable si un tel statut constitue bien une garantie supérieure à l’existence d’une Eglise libre dans l’Etat libre.
JPSC


 « Aux hargneux, aux anxieux et aux pointilleux du laïcisme, donnons raison sur un point : le discours qu’Emmanuel Macron a prononcé lundi soir au Collège des Bernardins à l’invitation de la Conférence des évêques de France fera date. Il décrispe les relations entre l’Église catholique et l’État et il déplace l’axe de la laïcité. Après les désillusions de la présidence bling-bling et les tensions de la présidence sociétale, les Bernardins ouvrent l’ère de la considération. À bon droit, les responsables catholiques affichaient, en fin de soirée, une mine réjouie. Ils ont réussi leur opération de communication, peut-être mieux qu’ils ne l’auraient cru. On passe de la fausse ignorance à la reconnaissance distante.
« Aux hargneux, aux anxieux et aux pointilleux du laïcisme, donnons raison sur un point : le discours qu’Emmanuel Macron a prononcé lundi soir au Collège des Bernardins à l’invitation de la Conférence des évêques de France fera date. Il décrispe les relations entre l’Église catholique et l’État et il déplace l’axe de la laïcité. Après les désillusions de la présidence bling-bling et les tensions de la présidence sociétale, les Bernardins ouvrent l’ère de la considération. À bon droit, les responsables catholiques affichaient, en fin de soirée, une mine réjouie. Ils ont réussi leur opération de communication, peut-être mieux qu’ils ne l’auraient cru. On passe de la fausse ignorance à la reconnaissance distante.

 « L’Église, combien de divisions ? On connaît la célèbre phrase de Staline, bien révélatrice de son matérialisme et de sa volonté hégémonique qui entendait écarter définitivement l’Église de la face du monde. L’Église, combien de divisions ? Mais, beaucoup, aurait-on tendance à répondre aujourd’hui. Et, même, beaucoup trop ! Non plus, cette fois, en référence aux unités blindées ou, plus largement, aux armées auxquelles pensait le maître du Kremlin, mais à celles qui divisent les catholiques entre eux.
« L’Église, combien de divisions ? On connaît la célèbre phrase de Staline, bien révélatrice de son matérialisme et de sa volonté hégémonique qui entendait écarter définitivement l’Église de la face du monde. L’Église, combien de divisions ? Mais, beaucoup, aurait-on tendance à répondre aujourd’hui. Et, même, beaucoup trop ! Non plus, cette fois, en référence aux unités blindées ou, plus largement, aux armées auxquelles pensait le maître du Kremlin, mais à celles qui divisent les catholiques entre eux.