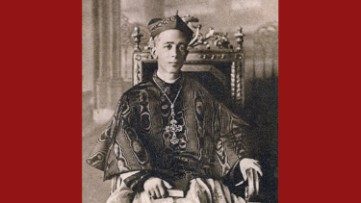L'homélie de l'abbé Christophe Cossement pour le 23e dimanche A (10 septembre 2023) :
Se convertir en communauté
Aujourd’hui, le Seigneur Jésus nous invite à nous mêler de la vie des autres. Il nous demande d’intervenir si nous apprenons que quelqu’un de la communauté chrétienne s’est mal conduit, a commis un péché1. On peut penser à ce genre de péchés qui abîment le témoignage de l’Église, ceux qui font dire à certains : c’est ça, être chrétien ? Par la présence dans la liturgie du texte d’Ézéchiel 33, on peut penser aussi à ce genre de péché qui font craindre pour le salut de tel frère : comment pourra-t-il paraître face à Dieu en ayant ainsi méprisé ses commandements ? Ou plus prosaïquement : il est illusoire, le bonheur qu’il croit trouver en s’engouffrant dans ce chemin de vie sans issue.
Comment Jésus ose-t-il nous demander de nous mêler de la vie des autres ? C’est tellement aux antipodes de la culture contemporaine où il faut professer que chacun fait ce qu’il lui plaît. On va même aujourd’hui jusqu’à penser que la tolérance est une valeur chrétienne. Peut-être l’est-elle un peu si on pense que le Christ a accueilli généreusement les pécheurs. Mais cela n’a jamais été pour leur dire qu’il tolérait leur péché, ou qu’il décrétait qu’il n’y avait plus de péché puisqu’il invitait à ne pas juger, à ne pas condamner. Il pouvait à la fois faire bon accueil au pécheur et avertir sévèrement au sujet du péché, tant en matière d’amour de l’argent, d’orgueil, d’hypocrisie, qu’en matière d’infidélité, d’impureté, de scandale. Et c’est pourquoi aujourd’hui le Christ nous invite à aller trouver notre frère dont nous apprenons qu’il a péché.
Pas question de faire un procès à ce frère en son absence, de casser du sucre sur son dos comme on le fait si souvent. Il faut aller le trouver, lui parler, d’abord seul à seul. Ce n’est qu’ensuite qu’il faudra peut-être se montrer plus insistants, y aller à plusieurs, mais toujours en face, jamais dans le dos. Mais peut-être le frère refusera-t-il toujours de changer de conduite. Jésus demande d’aller alors jusqu’à l’excommunication : « considère-le comme un païen et un publicain ». Mais sans doute faut-il voir tout au long de cette gradation, même dans le cas du dénouement dramatique de l’excommunication, le même objectif : « gagner ton frère ». Car Dieu ne veut pas qu’un seul de ses enfants se perde, et il nous demande de travailler à cela. Considérer l’autre comme un païen, ce n’est pas désespérer pour lui, mais compter sur cet électrochoc pour un retour salutaire… ce qui nécessitera une bonne dose d’humilité.
On travaillerait fort mal à l’œuvre de gagner nos frères si on disait : ne parlons plus de péché, la miséricorde rattrapera tout, même pour ceux qui ont refusé de se convertir. Cette minimisation du mal a conduit à des choses horribles. Elle empêche aussi les hommes d’ouvrir leur cœur à Dieu, ce qui ne présage rien de bon pour le jour où ils paraîtront face à Lui.
On travaillerait également fort mal au salut de nos frères si dans tout cela nous nous laissions guider par un secret désir de mettre les gens au pas, de les faire rentrer dans l’ordre que nous aimons… et qui nous rassure. Le Seigneur Jésus ne veut pas nous faire apôtres de l’ordre, mais de la charité. C’est en aimant nos frères, et non pour qu’il y ait de l’ordre, que nous irons les avertir de leur péché, après avoir retiré la poutre qui est dans notre œil.
Enfin, comment trouver le courage d’entreprendre une telle démarche ? Et comment trouver les mots ? C’est ici qu’intervient la suite de l’évangile : mettons-nous d’accord à deux ou trois pour demander au Seigneur sa grâce afin de ramener à lui notre frère qui s’égare. Soyons tous ensemble une communauté qui se convertit jour après jour et marche toujours plus résolument à la suite du Christ !
1 La nouvelle traduction liturgique, contrairement à la précédente, a suivi la version « a péché contre toi » présente dans plusieurs manuscrits, tandis que d’autres manuscrits, suivis par la Bible de Jérusalem ou Segond, ne porte pas le « contre toi ». Alors, ajout ou perte par une partie des copistes ? La possible contamination avec le verset voisin de Mt 18,21, qui porte fort logiquement le « contre moi », fait pencher pour un ajout fautif.