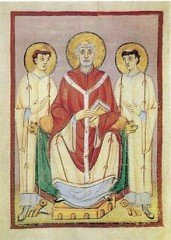D'Ali Bordbar Jahantighi sur The European Conservative :
Le Soudan et la faillite morale de la gauche moderne
Depuis des mois, cette ville antique est assiégée. Des quartiers entiers ont été rasés, des villages réduits en cendres, et des dizaines de milliers de personnes sont mortes de faim dans le désert. Selon les estimations des Nations Unies, près de 25 millions de Soudanais sont confrontés à une famine aiguë, et plus d'un demi-million d'enfants ont déjà péri dans cette famine provoquée par la guerre. Des milices islamistes, armées de drones iraniens, d'armes turques et d'une certitude morale qu'elles prétendent divine, ont transformé la guerre civile soudanaise en un théâtre d'extermination. Des images montrent des soldats dévorant le cœur de leurs victimes. C'est une horreur sans pareille ; non pas primitive, mais absolue ; non pas ancestrale, mais moderne.
Et pourtant, le tumulte moral du monde demeure étrangement silencieux. Aucune grande manifestation à New York ou à Londres, aucun cri de protestation de la part d'universitaires « anticolonialistes » ou de militants des droits de l'homme, pas même le faible écho des hashtags. Seulement un silence, dense et délibéré, un silence d'autoprotection plutôt que d'ignorance.
L'esthétique du silence de la gauche
Ce silence n'est pas l'ignorance ; c'est un mécanisme de défense. La gauche moderne s'est forgée une image de gardienne de la conscience morale, de voix éternelle contre la domination et l'oppression. Mais la souffrance du Soudan ne correspond pas à cette image. Il n'y a pas d'« oppresseur blanc » à condamner, pas de figure coloniale malfaisante à ressusciter. Les coupables sont des islamistes, des Africains, et se positionnent idéologiquement comme victimes de l'Occident. Le cadre moral s'effondre, et la gauche se réfugie dans le silence.
Il ne s'agit pas d'une simple hypocrisie politique ; c'est une question existentielle. La conscience de l'Occident progressiste ne fonctionne que dans le cadre d'une équation bien connue : la souffrance n'a de sens que lorsqu'elle est liée à une culpabilité. Sans ce lien, l'empathie vacille. Le Soudan est insupportable non pas parce qu'il est lointain, mais parce qu'il est idéologiquement inutilisable. La gauche ne peut absorber ce genre de souffrance ; elle ne peut l'intégrer à son discours moral. Reconnaître le Soudan reviendrait à affronter le mal sans le miroir du péché impérial, et cela exigerait une honnêteté que peu sont prêts à risquer.
À notre époque, l'indignation est devenue une forme de monnaie d'échange. La souffrance doit être visible, commercialisable et symbolique pour être reconnue. C'est pourquoi la Palestine est devenue sacrée dans l'économie morale de la gauche occidentale : elle offre des images à consommer, des méchants clairement identifiés et un récit simpliste de la vertu. L'enfant palestinien, le soldat israélien, la démocratie blanche, tous soigneusement mis en scène.
Le Soudan n'offre pas une telle clarté. Point de scènes cinématographiques, point de victimes éloquentes maîtrisant l'anglais, point d'empire commode à accuser. C'est une obscurité sans auteur occidental, et par conséquent, dans l'économie émotionnelle de la gauche, elle ne rapporte aucun profit. L'empathie contemporaine fonctionne comme un capital : elle doit engendrer un retour sur investissement moral. L'indignation doit affirmer l'identité, la pitié doit être un signe de vertu, et le silence devient le prix de la cohérence idéologique.
Ainsi, le massacre d'Al-Fashir, visible depuis l'espace, passe presque inaperçu. Le sang qu'on ne peut instrumentaliser politiquement est ignoré.
La théologie du postcolonialisme
Derrière cette paralysie se cache la théologie de la pensée postcoloniale : la conviction que toutes les souffrances dans les pays du Sud sont une conséquence de la domination occidentale. Cette doctrine, née dans les séminaires des universités occidentales, a substitué la culpabilité à la théologie et le ressentiment à la politique. Elle est incapable d’expliquer pourquoi des musulmans massacrent d’autres musulmans, pourquoi des milices noires persécutent des civils noirs, ou pourquoi des islamistes arabisés réduisent des Africains en esclavage au Darfour.
La même idéologie qui a idéalisé Che Guevara sanctifie aujourd'hui le Hamas. Le silence sur le Soudan est la conséquence logique de cette vision du monde. La gauche occidentale ne peut condamner les auteurs de ces actes sans renier ses propres principes. Le même mécanisme intellectuel qui excuse la violence djihadiste contre les Israéliens l'aveugle désormais face aux atrocités islamistes en Afrique.
C’est ce que la gauche postcoloniale appelle « les opprimés ». Il s’agit d’un renversement complet de l’ordre moral : le bourreau devient victime, le fanatique devient révolutionnaire et la barbarie devient résistance. La boussole morale de toute une culture politique tourne en rond, ne pointant nulle part ailleurs que vers l’intérieur.
Au Soudan, ce qui meurt, ce n'est pas seulement des vies humaines, mais aussi la crédibilité du discours moral occidental. Les intellectuels qui ont consacré leur carrière à condamner l'impérialisme occidental se retrouvent aujourd'hui muets face au racisme arabe, à la suprématie islamique et au despotisme africain. Ce même vocabulaire moral qui prétendait jadis défendre les faibles est devenu un instrument d'aveuglement sélectif.
L'éthique de la gauche ne vise plus la vérité, mais la cohérence narrative. Le mal n'est reconnu que lorsqu'il s'exprime en anglais, l'oppression que lorsqu'elle peut être imputée à l'Europe. L'universalisme a toujours été conditionnel, et la solidarité toujours de façade. Le Soudan révèle cette supercherie : un théâtre de l'empathie dont la scène s'effondre lorsque la réalité refuse de s'y conformer.
Un monde sans témoins
Le plus terrifiant concernant Al-Fashir, ce n'est pas seulement son déclin, mais le fait qu'il se déroule sans témoins. La gauche, jadis obsédée par le langage de la conscience, ne peut même plus feindre d'en posséder un. Elle a troqué le réalisme moral contre une théâtralité morale, faisant de la compassion un costume qu'elle ne porte que par opportunisme.
Quand la famine fauche un demi-million d'enfants, quand des milices islamistes dévorent les corps de leurs victimes, quand le sang tache la terre au point d'être visible depuis l'orbite, la conscience autoproclamée de l'humanité détourne le regard. Non par ignorance, mais par incapacité à croire.
Le silence de la gauche dans l'affaire Al-Fashir n'est pas une absence de parole ; c'est l'effondrement du sens.