Homélie de l'abbé Christophe Cossement pour le Dimanche de la Pentecôte :
Disciples de l’Envoyé
28 mai 2023
Si nous sommes ici ce matin, c’est parce qu’il y a eu cet événement raconté dans l’évangile d’aujourd’hui : après sa mise au tombeau, Jésus se montre vivant, avec les marques des plaies de sa passion, au milieu de ses disciples, et il leur donne l’Esprit Saint pour les envoyer en mission. S’il n’y avait pas eu ce don de l’Esprit Saint, s’il n’y avait pas eu cet envoi en mission, nous serions encore en train d’adorer les dieux celtes ou romains, ou la lune et le soleil, et nous ne connaîtrions rien de ce Dieu qui aime les êtres humains et qui veut les tirer des chaînes du mal.
Avec ce qui nous est raconté, nous sommes à un tournant de l’histoire des religions : le christianisme envoie des messagers en mission. Le peuple juif n’avait pas de messagers de la bonne nouvelle. Sa vocation était de vivre avec Dieu, d’être quelque part sur la Terre le peuple qui apprend à vivre l’amour de Dieu, qui fait voir que Dieu s’intéresse à l’humanité, nous appelle, nous guide, nous apprend les chemins du bien, de la justice, de l’amour. Le peuple juif vivait cela, tant bien que mal, comme nous tous vivons tant bien que mal notre foi.
Mais voilà que Dieu a voulu passer la vitesse supérieure, créer des liens plus intenses avec tous les hommes. Alors paraît Jésus. Il est l’envoyé du Père, et assez vite les apôtres comprendront qu’il est Dieu lui aussi, ce qu’on comprendra en disant qu’il est la deuxième personne de la Trinité.
Dieu a donc un envoyé. Qui vient tout changer dans notre conception de la vie. Nous découvrons que le sens de la vie c’est l’amour. L’amour des amis mais aussi des ennemis. Nous découvrons que Dieu nous aime personnellement, et qu’il peut guérir nos cœurs blessés par le mal. Nous découvrons que la mort n’est pas le point final, mais que Dieu nous appelle à une vie éternelle près de lui, dans le bonheur d’aimer et d’être aimé. Nous découvrons que nous pouvons prier, nous retirer dans le secret pour être avec notre Dieu, pour passer du temps à penser à lui en l’aimant, pour tisser ce lien avec notre Créateur.
Jésus, le Christ, est l’envoyé, et aujourd’hui il dit : « de même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La paix soit avec vous ! » Et c’est comme ça que les apôtres sont partis annoncer l’Évangile de proche en proche, et qu’un jour au IIIe siècle (Piat) puis au Ve siècle (les disciples de saint Martin, Éleuthère, etc.) et encore au VIIe siècle (Amand, Ghislain, Aldegonde, Waudru et Vincent, etc.) l’Évangile s’est implanté chez nous.
Les apôtres ont été envoyés avec l’Esprit Saint. Et nous aussi, nous sommes envoyés avec l’Esprit Saint, pour faire connaître l’amour de Dieu. L’Esprit Saint c’est Dieu lui-même qui se communique à nous et vient habiter en nous. Il nous fait comprendre que l’Évangile ce n’est pas d’abord un message, même un beau message de paix, mais que c’est un amour à vivre, que c’est entrer dans une vie où on se donne soi-même, où on s’engage par amour.
Qui veut se consacrer aux autres et à Dieu ? Qui veut prendre du temps pour sortir de lui-même, de ses projets, pour ouvrir son cœur, aider, consoler, encourager, défendre ? Quand nous abandonnons notre smartphone ou notre console pour regarder autour de nous, nous voyons bien quel bonheur nous pouvons donner en nous consacrant aux autres : une visite à quelqu’un qui est malade, un service à rendre, un effort pour arrêter de râler, etc. Ce n’est pas facultatif, ce n’est pas pour ceux qui en ont spontanément envie tandis que les autres font comme ils veulent. Si nous ne le faisons pas, l’Esprit Saint en nous est vivement contrarié. Il faut qu’on sache qu’il y a un Dieu qui aime le monde. Et nous, nous nous occupons de ses affaires, comme il nous l’a demandé. Nous sommes envoyés, et nous disons : notre Père, que ton Nom soit sanctifié !
Pour qu’on le sache, il faudra le montrer, et aussi qu’on le dise, il faudra ajouter le décodeur à tout le bien qu’on peut faire au nom de Dieu. Trouver un moyen pour que les gens avec qui nous sommes bons comprennent : il y a un Dieu qui veille sur toi encore plus que moi ! Invitons les gens à goûter l’amour de Dieu, invitons-les aux célébrations, à aller prier dans une église, à lire l’évangile, à aller se confesser pour entrer dans le pardon de Dieu, etc. Même aux gens des autres religions, nous devons annoncer : Dieu se fait proche de nous, il nous aime tendrement, il nous libère du mal. Il ne s’agit pas de chercher à convertir, mais à simplement faire savoir. Nous ne le faisons pas pour faire du chiffre, pour qu’il y ait du monde dans les églises. Mais parce que l’amour du Christ nous presse, lui qui dit : je suis l’envoyé, et je t’envoie.

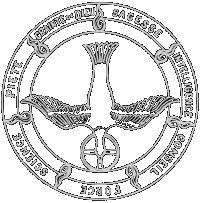

 La situation est toujours bloquée entre Rome et Mgr Rey, ce dernier n’étant pas disposé à abandonner ses brebis. Mais les ordinations, déjà annulées l’an dernier, de six futurs diacres et de quatre futurs prêtres, sont toujours en suspens. Dans un message adressé ces derniers jours aux paroisses, le diocèse indique :
La situation est toujours bloquée entre Rome et Mgr Rey, ce dernier n’étant pas disposé à abandonner ses brebis. Mais les ordinations, déjà annulées l’an dernier, de six futurs diacres et de quatre futurs prêtres, sont toujours en suspens. Dans un message adressé ces derniers jours aux paroisses, le diocèse indique :

