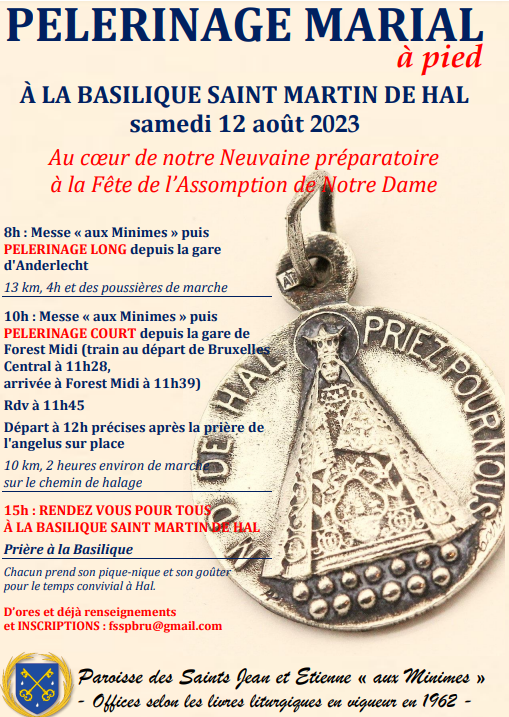L'homélie de l'abbé Christophe Cossement pour le 20e dimanche du temps ordinaire (A), 20 août 2023 (source) :
Offrir à Dieu des sacrifices
Les apôtres voudraient que Jésus remballe la femme étrangère, mais Jésus en profite pour faire découvrir ce qu’il dira aussi à la Samaritaine une autre fois : le salut vient des juifs ; ce sont eux qui ont reçu les promesses de Dieu. La Syro-phénicienne se glisse dans cette réalité de l’alliance, en argumentant qu’il y a place pour ceux qui cherchent les miettes. Jésus saluera sa foi. Cette femme exprime une attitude assez répandue, où on attend de Dieu une intervention pour soulager notre vie. Aujoud’hui, bien des gens continuent de crier ainsi vers le ciel, et certains s’adressent au Fils de Dieu.
Isaïe décrit, de la part des païens, des étrangers au peuple juif, c’est-à-dire nous, une attitude plus noble, où on sert Dieu, où on l’honore, et il dit que nos sacrifices sont agréés par Dieu. Cela me suggère de parler un peu de cette belle attitude d’offrir des sacrifices. Mais qu’est-ce qu’un sacrifice ? On pense spontanément à quelque chose de pénible, qui coûte. On aimerait que cela soit dépassé par le Christ, que ce soit un vieux machin de l’Ancien Testament, et voilà que la nouvelle traduction de la liturgie remet ce mot en valeur !
Pour comprendre ce qu’est un sacrifice, il faut oublier l’aspect de pénibilité et le regarder comme une offrande. C’est un don que l’on fait à Dieu parce qu’il est Dieu, pour l’honorer. Certes, il y a une certaine dépossession, un coût, mais qui est compensé par la joie de témoigner à Dieu reconnaissance, amour, attachement. Un peu comme lorsqu’on fait un cadeau à quelqu’un : il y a bien un trou dans notre portefeuille, si nous avons dû le lui acheter, mais c’est largement compensé par la joie d’offrir et par la joie de voir notre cadeau accueilli.
Dans cet ordre d’idée, on peut penser au sacrifice que vous avez fait de votre temps pour venir ici. Ou celui que vous faites par ce que vous donnez à la collecte, et à la St-Vincent de Paul, etc.
Faire un sacrifice, c’est prendre quelque chose pour en faire un chant d’amour. Cette disposition intérieure de celui qui fait le sacrifice est capitale ; les prophètes ont dénoncé les sacrifices formels, ceux que l’on fait alors que notre cœur est ailleurs, centré sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu. Un sacrifice fait à contre-cœur ou pour un motif intéressé n’est plus un sacrifice. Le sacrifice valable est centré sur Dieu, sur la recherche de son amour.
Jésus a fait de sa vie un sacrifice. Non pas d’abord dans le sens que sa vie a été détruite sur la croix. Mais parce que sa vie a été un don total de lui-même à son Père, par amour. Il vivait pour lui, il existait pour lui, parce qu’il l’aimait. Ce sacrifice a pris une tournure sanglante à cause du péché des hommes, qui ne supportaient pas quelqu’un qui vit tout entier pour Dieu alors qu’eux voulaient vivre selon leurs propres vues, leurs projets, leurs intérêts. À cause du mal, le choix de Jésus de vivre sa vie comme un don d’amour à son Père l’a conduit à connaître la croix. Mais le caractère sanglant n’est pas inclus dans l’idée de sacrifice ; il a lieu à cause de l’emprise du mal sur le monde.
Puisque Jésus est allé jusqu’au bout de l’offrande de lui-même, son sacrifice a détruit la puissance du diable ; son sacrifice nous rend la vie, il nous sauve. Jésus devient l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Son sacrifice trouve son dernier mot sur la croix, il remporte la victoire, et sa vie triomphe par son amour.
Alors nous célébrons ce sacrifice dans chaque messe. Mieux, nous le revivons. Ce n’est pas comme si Jésus était crucifié une nouvelle fois, mais la victoire de son don total est rendue présente devant nous, re-présentée, dit-on, et pour employer un terme courant on pourrait dire que la messe est une mise à jour de la passion pour nous. Le sacrifice de la messe fait un avec le sacrifice de la croix. Dans la prière eucharistique qui suit l’offertoire, le Christ nous introduit dans son attitude d’amour, de don, de reconnaissance envers son Père, et il nous enrichit ainsi de sa vie. Vivons cette partie de la messe comme un grand élan d’amour, c’est-à-dire un sacrifice.
Dans l’Ancien Testament, c’était les prêtres qui offraient les sacrifices. Jésus, en s’offrant lui-même au Père, alors qu’il est le Fils unique de Dieu, devient le Grand Prêtre unique et définitif. Si on parle de prêtres aujourd’hui, c’est parce qu’ils sont au service de ce don que le Christ a fait. Mais il y a plus : en nous prenant comme ses disciples, Jésus rend tous les baptisés capables d’offrir leur vie à Dieu. C’est ce qu’on appelle le sacerdoce baptismal, ou sacerdoce commun. Parfois on dit que nous sommes tous prêtres. Parce que le Christ nous a donné un accès direct à Dieu, et que nous pouvons lui offrir tout ce que nous touchons et notre vie même comme un chant d’amour et de reconnaissance1.
1On parle alors du «sacrifice d’action de grâce», notamment au Ps 50,14 ou en He 13,15. Il était jadis codifié comme sacrifice dans le livre du Lévitique, parmi les autres formes de sacrifice au temple (Lv 3).