De Dorothy Cummings McLean sur le site LifeSiteNews.com :
Les évêques allemands proclament que l’homosexualité est «normale», et l’adultère «pas grave»
BERLIN, 9 décembre 2019 (LifeSiteNews) - La Commission du mariage et de la famille de la Conférence épiscopale allemande est parvenue à un consensus sur le fait que l'homosexualité est une «forme normale de prédisposition sexuelle».
Deux prélats allemands ont également affirmé qu'Amoris Laetitia enseigne que les relations sexuelles formées après un divorce ne sont ni gravement coupables ni un obstacle à la réception de la sainte communion.
Le 5 décembre, la Conférence épiscopale allemande a publié un communiqué de presse détaillant les résultats d’une «consultation d’experts sur le thème « La sexualité de l’homme: comment en discuter scientifiquement et théologiquement et comment l’évaluer ecclésiastiquement? »
La consultation, qui comprenait un panel d'évêques, de sexologues, de théologiens moralistes, de théologiens dogmatiques et d'avocats en droit canon, s'est déroulée à Berlin et s'est terminée le 4 décembre. Le moment de l'événement a coïncidé avec le départ des évêques allemands sur leur propre «voie synodale».
Selon le communiqué de presse, les experts ont convenu que «la sexualité humaine englobe une dimension de désir, de procréation et de relation».
Ils ont également convenu que l'homosexualité est aussi «normale» que l'hétérosexualité et qu'aucune attirance sexuelle ne devrait être modifiée.
«Il a également été convenu que la préférence sexuelle de l'homme s'exprime lors de la puberté et suppose une orientation hétéro ou homosexuelle. Les deux appartiennent aux formes normales de prédisposition sexuelle, qui ne peuvent ou ne doivent pas être modifiées à l'aide d'une socialisation spécifique », a déclaré le communiqué de presse.
Le communiqué proposait ce statut de normalité comme la raison pour laquelle "toute forme de discrimination à l'égard des personnes ayant une orientation homosexuelle doit être rejetée", un enseignement qui, selon lui, a été demandé "pendant un certain temps" par le bureau d'enseignement de l'Église et a été «explicitement souligné par le pape François» dans Amoris Laetitia.
L'accord a cependant ses limites : il n'y a pas de consensus sur le fait de savoir «si l'interdiction magistrale de l'homosexualité pratiquée est toujours actuelle». Les experts ne sont pas non plus d'accord sur le fait que les personnes mariées et non mariées devraient ou non être autorisées à utiliser des contraceptifs artificiels.
Le communiqué de presse des évêques allemands mentionne en particulier l’archevêque Heiner Koch de Berlin, le chef de la Commission de la famille, et l’évêque Franz-Joseph Bode d’Osnabrück. Tous deux étaient présents au Synode sur la famille à Rome en 2015. Selon le communiqué, les deux hommes ont souligné «l'importance d'une discussion solide basée sur les sciences humaines et la théologie et ont souligné les développements qui peuvent déjà être trouvés dans Amoris Laetitia».
Comme exemple d'un «développement» à Amoris Laetitia, les évêques allemands déclarent que le document dit «une relation sexuelle après un divorce et un remariage n'est plus généralement considérée comme un péché grave et, par la suite, une exclusion générale de la réception de l'Eucharistie n'est pas prévue. »
Les autres prélats allemands du panel étaient Mgr Wolfgang Ipolt de Görlitz, Mgr Peter Kohlgraf de Mayence et plusieurs évêques auxiliaires de la Commission pour la famille.
Le Catéchisme de 1992 de l'Église catholique déclare clairement que les actes homosexuels sont «intrinsèquement désordonnés» et «contraires à la loi naturelle» (CCC 2357).
«Ils ferment l'acte sexuel au don de vie», poursuit-il. «Ils ne procèdent pas d'une véritable complémentarité affective et sexuelle.»
"En aucun cas, ils ne peuvent être approuvés."
Cependant, le Catéchisme souligne en effet que la souffrance des personnes ayant une attirance pour le même sexe ne devrait pas être augmentée par un traitement dur:
"Le nombre d'hommes et de femmes ayant des tendances homosexuelles profondément ancrées n'est pas négligeable. Cette inclinaison, objectivement désordonnée, constitue pour la plupart une épreuve. Ils doivent être acceptés avec respect, compassion et sensibilité. Tout signe de discrimination injuste à leur égard doit être évité. Ces personnes sont appelées à accomplir la volonté de Dieu dans leur vie et, si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer de leur condition." (CEC 2358)
Le Catéchisme souligne également que «les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté» et peuvent «approcher la perfection chrétienne» par la maîtrise de soi, l'amitié, la prière et la grâce sacramentelle (CEC 2359).
Cependant, il y a une rébellion généralisée dans l'Église catholique en Allemagne contre la doctrine constante de l'Église sur les questions sexuelles, y compris parmi les membres de la Conférence épiscopale allemande. L’insistance de la Conférence épiscopale allemande à tenir son propre synode, ou «voie synodale», sans la permission du Vatican, inquiète les catholiques allemands plus traditionnels.
Le cardinal Walter Brandmüller, président émérite du Comité pontifical des sciences historiques, a averti qu'avancer sur cette voie - une question qui remet en question les enseignements de l'Église sur le sacerdoce célibataire et masculin; sur l'homosexualité et le mariage - pourrait conduire à une «église nationale» sans «presque aucun lien avec Rome». Le cardinal des dubia a déclaré que ce serait «certainement le chemin le plus sûr vers le déclin final» de l'Église allemande.


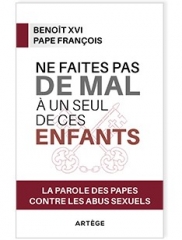

 « Le cardinal Gerhard Ludwig Müller, théologien dogmatique, a été évêque de Ratisbonne (2002-2012), en Allemagne, puis préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi de 2012 à 2017. Il a été chargé par Benoît XVI de l’édition de ses œuvres complètes. Il nous parle ici du synode sur l’Amazonie et de la situation de l’Église en Allemagne. Entretien exclusif.
« Le cardinal Gerhard Ludwig Müller, théologien dogmatique, a été évêque de Ratisbonne (2002-2012), en Allemagne, puis préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi de 2012 à 2017. Il a été chargé par Benoît XVI de l’édition de ses œuvres complètes. Il nous parle ici du synode sur l’Amazonie et de la situation de l’Église en Allemagne. Entretien exclusif. Une provocation de plus dans l’agitation qui déstabilise l’Eglise universelle ? Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au Figaro, responsable des affaires religieuses, a suivi tout le synode sur l’Amazonie à Rome. Il témoigne pour le mensuel « La Nef » dans son numéro de décembre 2019 :
Une provocation de plus dans l’agitation qui déstabilise l’Eglise universelle ? Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au Figaro, responsable des affaires religieuses, a suivi tout le synode sur l’Amazonie à Rome. Il témoigne pour le mensuel « La Nef » dans son numéro de décembre 2019 : 